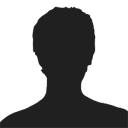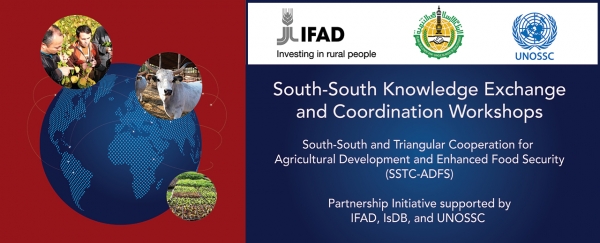Solutions SSDA
South-South Development Academy
Solutions SSDA
South-South Development Academy
Blog
Résumé
Le programme vise une gestion coordonnée plus efficace et viable au niveau des institutions nationales des aires protégées du complexe WAP (comprenant les parcs W, Arly et Pendjari) et de leurs ressources animales et végétales.
L’objectif est d’assurer la conservation et la promotion du potentiel naturel en tant que source de valeur ajoutée susceptible de contribuer à la réduction de la pauvreté en renforçant la conservation durable et efficace des écosystèmes complexes du WAP d’un point de vue régional avec une optimisation des avantages pour la région. population riveraine.
Dans le cadre de cette coopération Sud-Sud, la planification et la mise en œuvre conjointe d’actions pour la régionalité de cette région commune ont été lancées.
Problème
Le complexe WAP (parcs W-Arly-Pendjari) reste une unité écologique majeure en Afrique de l'Ouest, constituant la principale zone d'écosystèmes soudanais dans un bon état de conservation. Le complexe est organisé autour de deux unités, centrées respectivement sur le parc W (qui couvre les trois pays) et sur l'ensemble d'Arly (Burkina Faso) et de Pendjari (Bénin). Près de 3 000 000 ha sont protégés, dont environ la moitié sous le statut de parc national (W et Pendjari).
Ce complexe régional est confronté aux défis croissants posés par l'instabilité climatique, la fragilité des ressources naturelles ainsi que la croissance démographique et les besoins sans cesse croissants de la société, qui exerce une pression continue sur les ressources, la diversité biologique et l'habitat.
Ce réseau d'aires protégées témoigne de la volonté des trois États de relever les défis environnementaux et de renforcer leur faible capacité institutionnelle et les moyens financiers pour les résoudre.
En outre, le défi de la sécurité est l’un des défis majeurs auxquels les trois pays sont confrontés. En effet, les prévisions d'augmentation des recettes touristiques liées aux divers aménagements réalisés dans le complexe WAP, censées contribuer à améliorer la mobilisation de ressources financières supplémentaires pour la gestion des actifs du complexe, ont été très fortement influencées par les menaces enregistrées dans deux pays. des trois pays couverts.
Solution
Mis en place entre décembre 2011 et juin 2014, l'objectif du programme est de renforcer durablement la conservation des écosystèmes complexes WAP (parcs W, Arly et Pendjari) dans une perspective régionale et avec des avantages optimisés pour la population riveraine.
La coopération a mis en place un plan directeur pour le développement du complexe transfrontalier d’aires protégées WAP, sur la base duquel chaque pays élabore un plan de gestion du parc et des stratégies de lutte contre le braconnage et la protection des grands carnivores. Cette initiative a également entrepris un plaidoyer avec le gouvernement du Burkina Faso pour la révision du statut juridique et des limites du parc d'Arly afin de mieux gérer les écosystèmes du complexe WAP et d'influencer les autres pays.
Cette coopération Sud-Sud a permis aux 3 pays d’avoir 2 plans de développement et un plan de gestion concertée pour les deux blocs de parcs et de coordonner leurs efforts d’investissement pour la promotion des parcs et la protection de leur biodiversité. (Bloc écologique PAG des 3 parcs des parcs à blocs écologiques W et PAG Arly et Pendjari). Cette coopération a permis de mieux préserver la biodiversité faunique des trois pays.
Il a également permis aux trois pays de mettre en place / de disposer d’un cadre de planification unique et commun pour leurs interventions en matière de gestion durable des ressources naturelles du complexe de l’AEP. La signature par ces États d'un accord tripartite pour la gestion conjointe à la fin du programme est une réalisation majeure, un accomplissement considérable indiquant la volonté de ces États de s'approprier et de mettre en commun leurs ressources humaines, techniques et financières pour la gestion durable et conjointe de ce programme. patrimoine commun.
Appuyé par: l' UE, l'UEMOA, le PNUD, les gouvernements du Bénin, du Niger et du Burkina Faso
Agence d’exécution: PNUD, Centre national de gestion des réserves d’espèces sauvages (CENAGREF) - Bénin; Direction générale des forêts et de la faune sauvage et Office national des aires protégées (OFINAP) - Burkina Faso; Direction de la faune, de la chasse et des zones protégées (DFC / AP) et Direction générale de l'environnement et des eaux et forêts (DGEEF) - Niger
Contact:
PNUD Bénin: Elisabeth Tossou Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
PNUD Burkina Faso: Clarisse Coulibaly Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
PNUD Niger: Elhadj Mahamane Lawali - Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Résumé
Avec le soutien du PNUD, le Conseil national de l'environnement pour le développement durable au Niger a organisé en mars 2015 un atelier international sur le partage d'expériences sur la sécurité alimentaire et la résilience, réunissant 11 pays. Le résultat est la création d'une communauté de praticiens.
Problème
Mettre fin à la faim, assurer la sécurité alimentaire et améliorer la nutrition sont au cœur des objectifs de développement durable. Le monde s'est engagé à éliminer l'extrême pauvreté et la faim d'ici 2030.
L’Afrique subsaharienne est l’une des régions du monde les plus touchées par l’insécurité alimentaire. Les changements climatiques, en particulier les aléas météorologiques de plus en plus extrêmes et fréquents, ont un impact sur les agro-écosystèmes, la production agricole et les moyens de subsistance dont dépend en grande partie la population rurale la plus vulnérable.
Assurer la sécurité alimentaire face au changement climatique est donc l'un des défis les plus importants auxquels sont confrontés les décideurs cherchant à hiérarchiser les actions visant à réduire la vulnérabilité et à accroître la résilience des systèmes alimentaires afin d'assurer la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance. bonne nutrition pour tous.
Créé par le décret n ° 96-004 / PM du 9 janvier 1996, modifié et complété par le décret n ° 2000-272 / PRN / PM du 4 août 2000, le CNEDD est rattaché au cabinet du Premier ministre. Sa mission en relation avec toutes les parties prenantes est de développer, de coordonner la mise en œuvre, de suivre et d'évaluer le Plan national de l'environnement pour le développement durable (PNEDD), un cadre de référence pour les politiques au Niger. C'est le point focal national pour toutes les conventions post-Rio (CCD, CDB, CCNUCC).
Solution
Le Conseil national pour l'environnement et le développement durable au Niger a organisé début mars 2015 un atelier international dans le but de partager les expériences, les enseignements tirés et les succès émergents en termes de sécurité alimentaire et de résilience. L'atelier, organisé dans le cadre du projet régional "Adaptation aux changements climatiques pour la sécurité alimentaire en Afrique", a réuni 11 pays du sud à Niamey.
L’objectif est de promouvoir la promotion de la coopération Sud-Sud et d’améliorer la compréhension des initiatives d’adaptation basées sur les communautés, en particulier la dimension de genre, des systèmes d’information climat pour une prise de décision en connaissance de cause. et approches de planification intégrée.
Les résultats obtenus sont la mise en place d'une communauté de praticiens entre les projets, offrant ainsi la possibilité de partager leurs expériences.
Soutenu par: PNUD
Agence d’exécution: Conseil national de l’environnement pour le développement durable (CNEDD) Niger
Contact:
PNUD Niger.
Amata Diabaté
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Résumé
Renforcement des capacités des pays les moins avancés pour lutter contre les effets néfastes du changement climatique grâce à la formulation et à la mise en œuvre du Plan national d'adaptation au changement climatique (PAN).
Problème
À l'occasion de la Conférence sur le climat de Cancún en 2010, les États parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) ont adopté le processus des plans nationaux d'adaptation (PAN). Ce processus définit les adaptations à moyen et à long terme nécessaires pour réduire la vulnérabilité des États et de leurs citoyens au changement climatique. Avec le processus PAN, les États ancrent l'adaptation au changement climatique dans leurs plans de développement nationaux. L'accord de Paris sur le climat signé en 2015 à la COP21 souligne l'importance du processus des PAN pour les efforts internationaux d'adaptation au changement climatique. Cependant, le processus de formulation des PAN nécessite des compétences et des structures organisationnelles, participatives et de gouvernance qui ne sont pas toujours disponibles et / ou suffisamment consolidées dans les pays les moins avancés d’Afrique subsaharienne.
Solution
Dans le cadre de la mise en œuvre du processus des PAN, le Bénin a choisi de participer à une série d'activités de formation et d'échange d'expériences pour les PMA:
- Un atelier régional de formation de formateurs organisé en novembre 2013 à l'intention de quatre-vingts (80) participants de dix-sept (17) pays africains. tenue à Addis-Abeba (Ethiopie). L’objectif général de cet atelier de formation de formateurs est de favoriser la compréhension de l’Initiative commune de renforcement des capacités du Partenariat mondial pour l’eau / PNUD-FEM sur les aspects économiques de l’adaptation et de la sécurité en eau. pour un développement résilient au changement climatique.
- Depuis mars 2016, le Bénin fait partie d'un groupe de neuf pays en développement qui partagent leurs expériences en matière de renforcement des capacités d'intégration des changements climatiques dans les outils et instruments de la politique de développement dans le cadre de la préparation au développement du Bénin. accès au Fonds vert pour le climat. Dans le cadre de ce projet, un guide méthodologique a été élaboré pour intégrer les considérations relatives au changement climatique dans les documents de planification.
- Échange de connaissances dans le cadre de l'atelier régional d'évaluation des niveaux de préparation des PMA d'Éthiopie, en avril 2014, formation de formateurs à l'appui de l'État pour l'élaboration de PAN. Cette formation a eu lieu au Maroc en juin 2016 dans le cadre du programme de soutien global au processus des PAN. Cette formation a permis aux participants, qui sont désormais formateurs, de maîtriser les directives du PAN, l’évaluation des compétences pour un plan national d’adaptation, les enjeux du PAN, le processus de formulation, de mise en œuvre et de suivi.
Évaluation des PAN. Le but de ces activités était de transférer des connaissances et des compétences en tirant parti des expériences d’autres pays africains. L'expertise du Bénin en matière de formulation de PAN a été renforcée avec la participation d'experts en matière de changement climatique et de spécialistes des bureaux de pays.
Soutenu par: PNUD
Je mplémentant l'agence:
Bénin: Ministère de l'environnement, du logement et de l'urbanisme
Contact:
Isidore Agbokou,
Chef d'équipe environnement,
PNUD Bénin,
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Résumé
Visites d'échange effectuées en 2011 et 2012 entre la Chambre de commerce et d'industrie de Madagascar et le Centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation de Ouagadougou (CAMC-O) du Burkina Faso dans le but de mettre en place un centre d'arbitrage et de médiation soutenu par une structure durable à Madagascar. L'initiative vise à contribuer au renforcement de la compétitivité des entreprises malgaches par l'amélioration du climat des affaires, notamment en ce qui concerne l'exécution de contrats commerciaux et l'adoption de modes alternatifs de résolution des conflits (ADR) dans le pays.
Problème
Classé parmi les pays les moins avancés, Madagascar est reconnu pour son fort potentiel, notamment en ressources naturelles, qui ne peut malheureusement pas inverser la courbe d’appauvrissement. En moyenne, la croissance économique (2,3% en moyenne entre 2010 et 2015) reste bien inférieure à la croissance démographique (2,8% en moyenne) et traduit une baisse du revenu par habitant de la population et un taux de pauvreté atteignant plus de 80%.
Aussi, la mise en place d'un cadre favorable à la promotion du secteur privé, dans son rôle de créateur de richesse, a toujours été au cœur des différentes stratégies successives mises en œuvre à Madagascar.
Concernant l'amélioration de l'exécution des contrats commerciaux en particulier, un Centre d'arbitrage et de médiation a été créé à Madagascar (CAMM) en 2000, sous la forme d'une association privée. Le centre a pu bénéficier du soutien de certains partenaires techniques et financiers. Si le CAMM avait le mérite d’exister, en tant que centre d’arbitrage voulu et souhaité par le monde des affaires et le secteur privé, il n’en reste pas moins que le recours à ce centre a été limité: une douzaine de cas d’arbitrage et de médiation ont été réglés par le CAMM depuis sa création - et le centre n'était pratiquement plus opérationnel en 2011. Cependant, une étude réalisée la même année avec des entreprises locales a montré que 65% d'entre elles avaient une perception positive de la médiation et de l'arbitrage, 70% considèrent leur impact positif l’environnement juridique des entreprises et 53% sont disposés à prévoir une clause de médiation et / ou d’arbitrage dans leur contrat.
Le défi consiste donc à relancer les modes de commerce alternatifs à Madagascar, en tirant les leçons du passé pour assurer la durabilité de la fourniture de services.
Répondre au besoin de renforcer la gouvernance et le fonctionnement de l'esprit d'entreprise et du climat des affaires par la prévention et la résolution des conflits commerciaux. L'objectif est d'encourager la recherche de solutions amiables aux différends nés ou en cours de médiation et d'arbitrage par le biais d'un mécanisme de règlement des différends et des différends entre les parties avec l'intervention d'une tierce partie, l'arbitre (ou plusieurs arbitres).
Solution
Afin de relever le défi de la relance des MARC, mais surtout de leur durabilité, l’importance de soutenir l’entité promotrice dans une structure durable, dirigée par le secteur privé (utilisateur principal), a été privilégiée.
Des études et des consultations ont identifié la Chambre de commerce et d'industrie d'Antananarivo (CCIA) comme une institution potentielle pour amener le nouveau CAMM, à l'instar de nombreuses expériences réussies ailleurs.
Afin de garantir la pleine appropriation de la vision et de l'approche par le secteur privé, le PNUD a soutenu l'organisation d'un séjour d'initiation et de formation pour les représentants de haut niveau de la CCIA au Centre. Médiation et arbitrage de Paris (CAMP) et le Centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation de Ouagadougou (CMAC-O).
La solution de coopération Sud-Sud adoptée consiste en une série d'échanges en 2011 et 2012 dans le but de préparer les dirigeants de la CCIA et le secteur privé en général à s'approprier pleinement le concept et le rôle qu'ils vont jouer. jouer dans la nouvelle configuration du CAMM pour donner plus de profondeur à la médiation et à l'arbitrage à Madagascar.
À la fin de la mission, un groupe de travail composé des missionnaires a été mis en place pour piloter la revitalisation du CAMM soutenue par le CCIA.
Le groupe a supervisé la révision de la constitution et des statuts du CAMM, le recrutement d'un nouveau SG ainsi que le renforcement de ses capacités au sein du CMAP et du CAMC-O et la formation de médiateurs pour le centre (un pool d'arbitres hérité de l'ancien ).
La CAMM, soutenue par la CCIA, est opérationnelle depuis 2012. En 2013, elle a lancé le réseau "Business Bridge OI", qui regroupe les centres de gestion des conflits commerciaux des îles de l'océan Indien, afin de faciliter les relations commerciales entre ces centres.
Soutenu par: PNUD
Agence d’exécution: Chambre de commerce et d’industrie d’Antananarivo
Contact:
Hasina Ramarson,
Gestionnaire de programme,
Réduction de la pauvreté / secteur privé,
PNUD Madagascar,
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Résumé
Echange d'expériences régionales sur la construction d'infrastructures de paix lors d'un atelier de lancement et d'orientation animé par des experts du Réseau ouest-africain pour la consolidation de la paix (WANEP), qui comprenait des structures nationales de consolidation de la paix et de la sécurité et des organisations de la société civile placées sous la haute autorité Consolidation de la paix (HACP).
Problème
Le Niger est caractérisé par une multiplicité de facteurs de risque de conflit qui compromettent ses efforts de développement. En 2014, une étude a identifié la pression de l'accès aux ressources naturelles et la faible redistribution des ressources publiques (ressources des industries extractives), les risques liés à la croissance démographique, l'instabilité politique et institutionnelle ainsi que les problèmes frontaliers. facteurs de conflit au Niger. En outre, l’étude a montré que malgré l’existence de divers acteurs s’occupant de différents types de conflits, la coordination et les capacités de prévention / gestion des conflits restent faibles.
Solution
Echange d'expériences régionales sur la mise en place d'une infrastructure de paix lors d'un atelier de lancement et d'orientation animé par des experts du Réseau ouest-africain pour la consolidation de la paix (WANEP), avec l'appui du PNUD et auquel ont participé les structures nationales de consolidation de la paix et de sécurité et les organisations de la société civile relevant de la Haute Autorité pour la consolidation de la paix (HACP).
L’atelier a été organisé à la suite des recommandations de l’étude sur les facteurs de conflit au Niger de 2014. Le partage des expériences des pays de la région (le Ghana en particulier) a convaincu la Haute Autorité de consolider la paix (HACP), jusqu'alors réticente à la nécessité de mieux coordination des structures nationales pour la consolidation de la paix et la sécurité. À la fin de l'atelier, un comité de suivi a été créé sous l'égide du HACP pour diriger le processus.
Soutenu par: PNUD
Agence d’exécution: Haute autorité pour la consolidation de la paix (HACP)
Contact:
Amata DIABATE,
Conseiller économique,
PNUD Niger,
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Résumé
Dans le cadre du Programme régional d'adaptation pour l'Afrique et la sécurité alimentaire (TICAD V. CC), des actions de partage des connaissances ont été mises en place avec le Kenya. L'objectif était de renforcer les capacités du personnel de la Direction générale de la météorologie (DGM) dans les domaines de l'administration et de la maintenance des stations ADCON, du fonctionnement et de la constitution d'une base de données sur les stations météorologiques automatiques. Deux missions d'échange au Kenya pour promouvoir l'utilisation des données climatiques. Cette mission visait à faciliter le développement de l'assurance climat au Burkina Faso. Il a été financé par le Japon. Cette initiative a exposé les partenaires du Burkina Faso à la collecte, à la gestion et à l'utilisation pratique de données climatologiques et à une meilleure planification des activités de développement liées au changement climatique.
Les enseignements tirés de ces échanges ont permis aux partenaires du Burkina de guider la formulation de leur initiative d’assurance climat en préparation avec le PNUD et le FEM.
Problème
Les impacts négatifs du changement climatique sur les rendements agricoles et la situation de la sécurité alimentaire en Afrique sont préoccupants. Les réductions de rendement prévues dans certains pays pourraient atteindre 50% d'ici 2020 et les recettes nettes des cultures pourraient chuter de 90% d'ici 2100, les petits agriculteurs étant les plus gravement touchés. Les risques liés aux aléas climatiques et climatiques constituent des contraintes majeures pour les ruraux engagés dans des activités agricoles ou dont les moyens de subsistance dépendent fortement du secteur agricole.
Récemment, les produits de transfert de risque indexés tels que l'assurance indicielle sont apparus comme un mécanisme potentiellement efficace de transfert de risque climatique pour les populations rurales.
ACRE-Agriculture et Climate Risk Enterprise Ltd est une entreprise à but lucratif issue du projet Kilimo Salama (créé en 2009) financé par la Fondation Syngenta et du Global Index Insurance Facility (GIIF). ACRE Africa est agréé au Kenya, au Rwanda et en Tanzanie en tant que prestataire de services travaillant avec des assureurs locaux et d’autres parties prenantes de la chaîne de valeur de l’assurance agricole.
Solution
Le PNUD a organisé du 30 mars au 4 avril 2015 un voyage d'étude au Kenya au profit des structures du secteur rural, notamment de l'agriculture, de l'élevage, de l'environnement et de la direction de la météorologie. Ce voyage d’étude a permis d’échanger avec l’équipe technique d’ACRE, d’échanger avec les producteurs ayant souscrit les produits d’assurance, de visiter les stations utilisées pour la surveillance du risque et d’échanger avec les services techniques. impliqués dans le processus de gestion des risques agricoles au Kenya. Cela a également permis de rencontrer et de discuter directement avec les services impliqués dans la problématique de l'assurance climat, y compris l'agriculture et l'élevage et Weather Kenya.
Grâce à ces échanges, l’équipe du voyage d’étude a pu:
- confronter la vision théorique à la réalité de l'assurance agricole;
- contrôler le mode de fonctionnement et le fonctionnement d'une assurance climat au profit des éleveurs ou des agriculteurs;
- acquérir le processus opérationnel de développement de produits d'assurance et d'indicateurs de suivi
- et les principales exigences d'un régime d'assurance agricole.
Soutenu par: PNUD
Agence d'implémentation: Kenya Agriculture and Climate Risk Enterprise (ACRE)
Contact:
Hervé Kouraogo,
Spécialiste en économie,
PNUD Burkina Faso,
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Résumé
Partage avec São Tomé et Principe et le Togo de l'expérience malgache en matière d'efficacité de l'aide au développement, et plus particulièrement sur les thèmes de la transparence et des outils et mécanismes de coordination.
Défi
Garantir la qualité du processus décisionnel des organisations gouvernementales - qu'il s'agisse d'investir dans une infrastructure logistique ou de creuser un puits - nécessite la disponibilité d'informations et de données précises, pertinentes et accessibles. Dans le cadre du programme d’efficacité de l’aide, des solutions technologiques et des outils de gestion de l’information ont été mis au point pour collecter et organiser les données clés de différents projets afin d’améliorer les informations fournies aux responsables de l’efficacité du développement. La plate-forme de gestion de l'aide (AMP) est un outil de partage d'informations permettant aux gouvernements des pays en développement de rationaliser leur gestion de l'aide internationale.
Avec la création en 2008 du Secrétariat permanent à la coordination de l'aide (STPCA), chargé de gérer une base de données appuyée par le bureau du Premier ministre et responsable de la gestion d'une base de données sur l'aide (Plate-forme d'aide: MPA - Madagascar), Madagascar est capables, avec la participation des partenaires au développement, de rassembler et de partager tous les projets de coopération au développement. AMP - Madagascar est une application web à données ouvertes (www.amp-madagascar.gov.mg) qui contient plus de 1000 projets financés par environ 30 collaborations multilatérales et bilatérales, environ 30 collaborations décentralisées et environ 20 ONG internationales.
Solution
Les similitudes entre les outils de gestion et le mécanisme de suivi de l'aide publique au développement, ainsi que l'expertise de Madagascar dans ce domaine, rendent cette expérience très intéressante pour d'autres pays:
Togo: suite à un appui du secrétaire technique permanent chargé de la coordination de l'aide (STP-CA Madagascar) au Togo en 2013, une délégation togolaise s'est rendue à Madagascar du 21 au 25 juillet 2014 pour renforcer ses capacités de gestion de la base de données de suivi de l'aide. grâce à la transmission du savoir-faire des équipes malgaches en charge de la base (AMP) pour le pays. Les bonnes pratiques acquises sont intégrées directement dans la plateforme de gestion de l'aide, principalement en ce qui concerne l'aspect fonctionnel.
São Tomé-et-Principe est actuellement en phase de consolidation du système d'information pour la gestion de l'aide. Dans ce contexte, le pays entretient des contacts avec le Secrétariat technique permanent - Aide à la coordination (STP-CA) afin d'acquérir des connaissances sur l'innovation en matière d'efficacité du développement.
Soutenu par: PNUD
Agence d’exécution: Secrétariat permanent à la coordination de l’aide (STPCA)
Contact:
AUTOMNE, El Hadji Ndji Mamadou.,
Économiste principal,
PNUD Madagascar et Comores,
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Sabina dos Ramos,
Analyste de programme / PMSU,
PNUD São Tomé et Príncipe,
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Résumé
Atelier régional pour renforcer la collaboration régionale entre le bassin du lac Kivu et l'Autorité du fleuve Ruzizi (Abakir) et l'Autorité du lac Tanganyika (ALT) en vue d'une meilleure gestion de l'eau et de la préservation de sa préservation dans le bassin du Lac Kivu
Défi
La raréfaction de l’eau, combinée à la dégradation de l’environnement, à la dégradation des infrastructures et à la croissance rapide de la population, a entraîné un potentiel croissant de conflits violents, ou «guerres de l’eau», entre nations pour des ressources en eau partagées. Les conséquences sociales et sur la santé publique d'un accès insuffisant à l'eau sont très importantes pour les communautés locales.
Afin d'améliorer les conditions de vie des populations vulnérables de la région et de prévenir le risque de catastrophes naturelles, les trois pays riverains sont confrontés au défi commun d'une gestion efficace des ressources en eau. Ainsi, les trois pays de ce bassin tentent depuis 2011 de coordonner la gestion des ressources en eau afin d'assurer l'approvisionnement en eau à long terme des barrages construits dans les cascades de Ruzizi.
Solution
Un atelier régional a été organisé en octobre 2014.
L'atelier a permis d'échanger des points de vue d'experts, de définir des activités prioritaires et de renforcer l'appropriation par les autorités provinciales du Nord-Kivu et du Sud-Kivu en ce qui concerne la gestion durable du lac Kivu et du fleuve Ruzizi. L'atelier a également élargi et renforcé le cadre de coopération et de collaboration entre ABAKIR et ALT afin d'adopter une approche coordonnée de la lutte contre les guerres de l'eau, ainsi que des mesures appropriées et des règles communes pour la réglementation des activités humaines et endogènes du lac Kivu.
Soutenu par: PNUD
Mis en œuvre par: les autorités du bassin du lac Kivu et de la rivière Ruzizi (Abakir) et l'autorité du lac Tanganyika (ALT)
Personne à contacter: Ernest BAMOU, conseiller économique, PNUD RDC, Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Résumé
Partage d'expérience entre le Sénégal et le Togo sur l'utilisation des technologies de l'information dans les chaînes de la justice
Défi
Le Togo est en train de réformer et de moderniser son administration publique. Des efforts sont consacrés à l'amélioration des capacités de coordination et de gestion, au renforcement du système judiciaire et à la consolidation de l'état de droit en tant que facteur essentiel de promotion des investissements et de la croissance économique. La sous-performance et la faible capacité des institutions publiques compromettent le développement durable. Pour ce faire, un système judiciaire performant, efficace et solide est essentiel pour promouvoir avec succès l'accès à la justice pour tous.
Solution
La solution proposée consistait à partager l'expérience du Sénégal en matière d'informatisation du système judiciaire avec des experts togolais à Lomé au cours du mois de juillet 2014. Les experts sénégalais (du Ministère de la justice, de l'Université Cheikh Anta Diop et du barreau des avocats) rencontré leurs homologues togolais pour aider le système de justice togolais à entamer le processus d'informatisation afin d'améliorer la rapidité et la sécurité des procédures et décisions des tribunaux.
À la suite de cet échange, les besoins en équipement, infrastructure de réseau, ressources humaines et formation pour la mise en œuvre de l’informatisation des chaînes judiciaires ont été évalués dans 32 juridictions. Les TIC sont progressivement introduites pour réduire les retards, les frais généraux, la bureaucratie et les obstacles administratifs.
En tant que tel, la productivité et l'efficacité du système judiciaire togolais se sont améliorées grâce à la mise en place d'un réseau informatique permettant une meilleure organisation et un meilleur stockage des données.
Soutenu par: PNUD
Mis en œuvre par : Ministère de la justice et des relations avec les institutions de la République
Personne de contact: Ginette MONDOUGOU CAMARA, conseillère économique, PNUD Togo, Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.