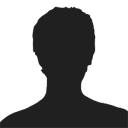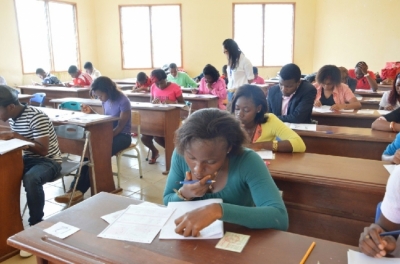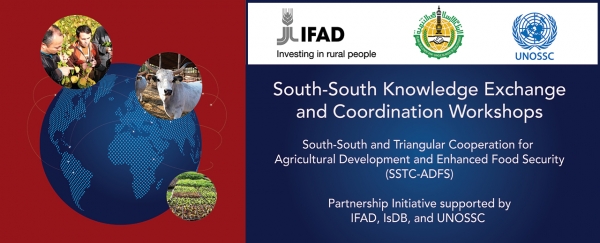Solutions SSDA
South-South Development Academy
Solutions SSDA
South-South Development Academy
Blog
Résumé
Le chômage endémique dans de nombreux pays africains et le secteur informel étant l'un des plus gros employeurs de la région, l'entrepreneuriat et la création de petites et moyennes entreprises sont reconnus comme un moteur majeur du développement panafricain. Le programme EMPRETEC du Ghana a débuté en tant que projet de partenariat public-privé du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), de Barclays Bank Ghana Limited et du gouvernement du Ghana afin de développer les compétences des entrepreneurs, ainsi que les compétences de gestion fonctionnelle et nécessaires à la croissance. Aujourd'hui, la société est entièrement autofinancée et sert de modèle aux autres pays de la région qui souhaitent développer leurs services de conseil en matière d’entreprenariat et de développement d’entreprise.
Défi
L'entrepreneuriat et la création de petites et moyennes entreprises sont reconnus comme un moteur majeur du développement panafricain. Au fur et à mesure que les pays africains renforcent leur capacité de financer leur propre développement, ils dépendent de plus en plus des recettes intérieures et de la consommation privée sur les marchés locaux. Ces deux facteurs ont connu une croissance exponentielle dans de nombreux pays au cours des dernières années. Néanmoins, les emplois décents sont restés à un niveau très bas. Avec des taux de chômage endémiques dans de nombreux pays, le secteur informel reste le plus gros employeur de la région (estimé à 80% en moyenne pour l'Afrique subsaharienne).
Solution
Afin de promouvoir l'esprit d'entreprise et le développement des entreprises, le Ghana a rejoint le programme mondial EMPRETEC, un réseau d'entrepreneuriat technologique mis au point en Amérique latine depuis 1990. Forte de cette expérience, la Gambie a réalisé son propre projet d'entreprise et d'entreprise
projet de développement entre 2014 et 2017. Les efforts visant à consolider les acquis et l'institutionnalisation pour la durabilité se poursuivent pendant le CPD 2017-2021 en cours. EMPRETEC Ghana, considéré comme un modèle de meilleure pratique pour le développement des entreprises, est devenu une agence de premier plan dans le domaine de l'entrepreneuriat et du développement des entreprises, fortement engagée dans le développement d'un secteur privé en bonne santé, avec une attention particulière pour les micro, petites et moyennes entreprises (MPME). . Lancé en tant que projet de partenariat public-privé du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), de Barclays Bank Ghana Limited et du gouvernement du Ghana, son objectif initial était de développer les compétences des entrepreneurs en leur proposant une formation leur permettant d'améliorer les compétences en gestion entrepreneuriale et fonctionnelle nécessaires à croissance. Le programme a depuis été développé pour inclure des services financiers ainsi qu’une gamme complète de services de conseil aux entreprises. Il a été enregistré en tant que société à responsabilité limitée par garantie au Ghana en 19941. L’expérience ghanéenne a servi de modèle pour d’autres pays de la région. . En tant que tel, EMPRETEC Ghana a soutenu la création d’EMPRETEC Gambie, partageant ses meilleures pratiques avec une délégation gambienne au cours d’une mission d’échange de connaissances et d’évaluation réalisée en mai 2014 avec l’appui du PNUD. EMPRETEC-Ghana a fourni des apports techniques pour aider la Gambie à finaliser et à signer un nouveau projet sur «l'entreprenariat et le développement des entreprises» signé avec succès en 2014 par le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Emploi. le soutien à la création d'emplois, plus particulièrement pour les femmes et les jeunes. Plus spécifiquement, il vise à: i) renforcer et renforcer les capacités institutionnelles nécessaires à la mise en œuvre de programmes d’entreprenariat et de développement des entreprises; ii) favoriser l'émergence et le développement d'un secteur privé durable, productif et compétitif en Gambie; et iii) créer une plate-forme pour améliorer le dialogue et le plaidoyer des parties prenantes en faveur du développement des MPME. À la fin du projet en 2017, l'évaluation finale indiquait: * 58 ateliers sur l'esprit d'entreprise achevés, contre 50 prévus; 1980 entrepreneurs formés à EMPRETEC Model sur 1070 projetés; 300 agriculteurs formés sur un total de 270; 3 sessions de formation de formateurs sur un total de 7; 10 cours de recyclage organisés pour les conseillers en entreprise sur un total de 6; 14 formateurs nationaux ont été formés sur un total de 15, dont 12 ont suivi la formation requise et ont été agréés par la CNUCED; 125 conseillers commerciaux ont été formés sur un total de 70; et 900 entrepreneurs et agriculteurs informés des 700 prévisions. Amélioration de la capacité de création d’emplois de 1070 MPME; et * Ces activités contribuent à générer au moins 3 210 nouveaux emplois au niveau local.
Appuyé par: PNUD, Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement
Mis en œuvre par: Ministère du commerce, de l'industrie et de l'emploi / Agence gambienne de promotion des investissements et des exportations - Gambie
Personne de contact: Abdou Touray Spécialiste du programme, Pauvreté et croissance inclusive, PNUD ( Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. ).
Résumé
Le Libéria a réalisé de grands progrès dans la réalisation de ses objectifs de développement social et économique au cours des 15 dernières années. Néanmoins, son processus de transition démocratique n'est pas correctement reflété dans la Constitution nationale. Les tentatives de réforme de la Constitution de 1986 n'ont pas abouti à un consensus public et à une approbation par le biais du quota nécessaire. Le dernier processus de réforme, lancé en 2012, vise à remédier aux goulots d'étranglement du processus de réforme par le biais d'une campagne de sensibilisation et de consultation à l'échelle nationale, inspirée notamment par d'autres pays africains tels que le Ghana et le Kenya.
Défi
Le Libéria a enregistré des progrès impressionnants dans le développement humain depuis sa transition vers la paix et la gouvernance démocratique au début du XXIe siècle. Sa première transition pacifique entre gouvernements élus démocratiquement a eu lieu en 2017. Néanmoins, une réforme de la constitution du pays de 1986 n'a pas fait partie du processus de développement global et les propositions spécifiques de révision de la Constitution se sont multipliées. Lors d’un référendum de 2011, les propositions n’avaient pas reçu l’approbation nécessaire des 2/3 des électeurs. Depuis 2012, un comité de révision de la Constitution nommé par SE Ellen Johnson Sirleaf, président du Libéria entre 2005 et 2017, avait pour objectif de relever les défis posés par un certain nombre de principes fondamentaux et de structures institutionnelles obsolètes fondés sur des consultations préliminaires à l'échelle nationale.
Solution
Le Gouvernement libérien a fait de la réforme constitutionnelle sa priorité et collabore avec le PNUD pour renforcer les capacités nationales dans la mise en œuvre d'un processus d'élaboration de la constitution transparent, impartial, inclusif, participatif et crédible. Dans ce cadre, les responsables libériens ont directement bénéficié des expériences du Kenya et du Ghana, qui ont connu des processus similaires ces dernières années. Le premier processus de réforme constitutionnelle instauré démocratiquement au Ghana a été mis en place en 2010. Conformément à la Constitution Act du Kenya (2008), la réforme constitutionnelle du Kenya a été adoptée par référendum en 2010. Les deux pays ont tenu de vastes consultations publiques sur des questions clés sur l'ensemble de leur territoire. Entre 2014 et 2016, une variété d'interactions et de
deux visites directes ont eu lieu entre des délégations des comités de révision de la constitution (CRC) et d'autres acteurs clés impliqués dans le processus de réforme des trois pays. Les échanges ont renforcé la capacité des différentes institutions participant à ces voyages d’études à se faire connaître, à nouer des partenariats, à tirer des enseignements et à les mettre en pratique au Libéria. Depuis leur retour, par exemple, les membres de la CRC du Libéria ont mené un exercice de consultation publique dans tout le pays, rassemblant les points de vue des citoyens. Plus de 56 000 suggestions ont été recueillies lors de consultations publiques qui ont touché 10 950 Libériens dans 73 districts et la diaspora, ainsi que par le biais d'autres possibilités de contribution (appel à la radio, appel sans frais, visites au siège de la CRC). Les principales suggestions, telles que la réduction de la durée du mandat électoral et le renforcement de la décentralisation, issues d'une majorité des recommandations, ont été regroupées dans un ensemble de propositions soumises au président. Après approbation par le président, ils ont été soumis au Parlement. En novembre 2016, la Chambre des représentants a adopté 7 des 25 propositions qui doivent encore être approuvées par la Chambre du Parlement avant d'être soumises à un référendum public. Les échanges avec le Ghana ont également permis d'intégrer une attention particulière au maintien de l'ordre axé sur le client et au renforcement de la police nationale du Libéria. En 2014 et 2015, dix-sept policiers (13 hommes et 4 femmes) ont été formés au Ghana pendant 8 semaines.
Soutenu par: PNUD
Coordonnées de contact: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Résumé
Le système de gouvernance centralisé du Libéria a contesté la participation populaire et les initiatives de développement local, en particulier dans la fourniture de biens et de services publics. Dans le but de "rapprocher le gouvernement des citoyens" et d'assurer une plus grande participation à leur propre processus de développement ainsi qu'une répartition équitable des ressources du pays, le gouvernement a lancé sa politique nationale de décentralisation et de gouvernance locale en 2012. S'appuyant sur les meilleures pratiques partagées Selon l’Institut local d’administration locale du Kerala indien, les centres de services de comté sont chargés de la mise en œuvre de la politique de décentralisation au niveau local. en coordination avec leurs ministères d’exécution respectifs.
Défi
Le Libéria a enregistré des progrès encourageants dans le développement humain depuis sa transition vers la paix et la gouvernance démocratique. Néanmoins, le système de gouvernance centralisé a mis au défi la participation populaire et les initiatives de développement local, notamment dans la fourniture de biens et de services publics. La récente pandémie d'Ebola de 2014/2015 n'était qu'un exemple très flagrant de la façon dont la faiblesse du système de santé était encore soulignée par le biais du système hautement centralisé.
Solution
La décentralisation accrue du pouvoir, des pouvoirs, des fonctions et des responsabilités est l’un des principaux piliers du vaste programme de réformes du gouvernement du Libéria. Dans le but de "rapprocher le gouvernement des citoyens" et d'assurer une plus grande participation à leur propre processus de développement ainsi qu'une répartition équitable des ressources de la nation, le gouvernement a lancé sa politique nationale de décentralisation et de gouvernance locale en 2012. Cette politique prévoit une révision des institutions administratives et la restructuration de la gouvernance locale et du système d'administration publique. La création de centres de services de comté est un élément important du cadre de mise en œuvre de cette politique. Les centres de services départementaux sont chargés de la mise en œuvre de la politique de décentralisation au niveau local. en coordination avec leurs ministères d’exécution respectifs. Les centres de services sont basés sur de précieux exemples du processus de décentralisation en Inde. Ils ont été conçus et déployés à la suite d’une visite d’étude de la
Ministère de l'Intérieur libérien en 2009 en Inde La délégation a visité l'Institut de l'administration locale du Kerala en Inde, riche de programmes de décentralisation. Immédiatement après son indépendance, il a lancé un grand nombre de projets de développement au niveau local et élargi les services nationaux de développement rural. La participation et la mobilisation de la communauté constituent un élément important de son schéma de développement.
Appuyé par: le PNUD, l'Agence suédoise de développement international (SIDA), l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID)
Mis en œuvre par: Ministère de l'intérieur
Coordonnées de contact: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Résumé
Les stratégies de croissance et de développement III du Malawi définissent des trajectoires de développement ambitieuses pour faire face aux défis de développement du pays dans une enveloppe de ressources restreinte. La réalisation des objectifs de développement dépend donc d'autant plus d'un service public fort à tous les niveaux - politique, institutionnel, individuel. Alors que le gouvernement mettra en œuvre la mise en œuvre de la MGDS III, le service public est le principal moteur de la formulation et de la mise en œuvre de la stratégie de développement du pays et des objectifs de développement durable. Les lois et les politiques proposées favoriseront un secteur public efficace et efficient conduisant à la réalisation de l'objectif 16 des ODD, qui favorise la création de sociétés pacifiques et inclusives et d'institutions efficaces, responsables et inclusives à tous les niveaux. Pour faire face aux difficultés liées à la lenteur des résultats de plusieurs réformes du secteur public au cours des dernières décennies, le gouvernement du Malawi a créé un système de gestion des réformes du secteur public.
Unité au sein du cabinet du président et du cabinet pour accélérer la mise en œuvre de la réforme. Une attention particulière a été apportée à la reproduction d’exemples réussis du Kenya et de Singapour concernant la création de la Malawi School of Government, la passation de marché et la prestation de services locaux.
Défi
Bien que le Malawi ait réalisé d'importants progrès dans la réalisation de plusieurs objectifs du Millénaire pour le développement au cours des dernières décennies, la pauvreté et les inégalités demeurent élevées, en particulier dans les zones rurales où 50% de la population est encore pauvre (Source: Banque mondiale). La plupart des possibilités de travail se situent dans l'agriculture de subsistance, une région fortement touchée par la sécheresse et les chocs liés au climat au cours des dernières années. La stratégie de croissance et de développement du Malawi (MGDS III) 2017-2022 vise à accélérer la transition vers un pays productif, compétitif et résilient. Il s'articule autour de cinq domaines prioritaires: a) agriculture, développement de l'eau et changement climatique; b) éducation et développement des compétences; c) développement de l’énergie, de l’industrie et du tourisme; d) Infrastructures de transport et TIC et; e) Santé et population. La paix, la bonne gouvernance et une décentralisation efficace sont des éléments clés pour parvenir à un développement durable et inclusif. Le Programme de développement durable à l'horizon 2030 (ODD) a été intégré à la MGDS III grâce au plaidoyer et à l'appui technique du PNUD. Étant donné que le Malawi n'a atteint que quatre des huit objectifs du Millénaire pour le développement, la transition vers les objectifs de développement durable nécessitera une coordination et une intégration renforcées tant au niveau de la planification que de la mise en œuvre. Une Commission nationale de planification créée en 2017 est chargée de superviser la mise en œuvre de la MGDS. La réalisation des objectifs de développement est donc d'autant plus subordonnée à un service public fort à tous les niveaux -
politique, institutionnel, individuel. Le gouvernement du Malawi a mené plusieurs réformes du secteur public avant le lancement de sa stratégie de croissance et de développement pour le Malawi II (2012-2016). Ces réformes visaient principalement à améliorer les aptitudes et compétences en matière de leadership, de planification et de gestion des ressources humaines, mais n’ont donné que des résultats mitigés et ont été examinées avec un accent plus fort sur l’éthique et la responsabilité en 2013. Parmi d’autres indicateurs, la MGDS III mesure son succès sur la poursuite de la mise en œuvre des réformes du secteur public grâce à une approche «inhabituelle des entreprises» dans les principaux domaines de réforme L’appui au gouvernement du Malawi se traduira par la mise en œuvre de politiques, lois et systèmes qui transforment le secteur conformément à l’objectif de ces politiques, qui est de formuler «un service public performant et performant d’ici 2022 qui facilite la transformation positive de l’économie et la la modernisation du pays ".
Solution
Au cours de son projet quinquennal de développement des capacités du secteur public (PCSD) lancé en 2012 et mené en collaboration avec le PNUD, les VNU et l'UNDESA, le gouvernement du Malawi s'est concentré sur des objectifs de programme «axés sur les résultats» et des politiques critiques d'amélioration des performances. PCSD cherche à renforcer la capacité de la fonction publique à travers: i) l'examen et la mise en œuvre de politiques, règles et réglementations qui soutiennent une prestation efficace des services publics; ii) accroître les compétences en leadership / gestion, les compétences et les valeurs éthiques pour orienter le programme de développement national; iii) renforcer les capacités de planification et de gestion des ressources humaines dans les différents MDA de la fonction publique; et iv) Promouvoir une application novatrice et intégrée des TIC dans le service public. À la suite d'un vaste scandale de mauvaise gestion financière qui a éclaté en 2013, un échange sur les enseignements tirés de la lutte contre la corruption avec les autorités du Botswana a conduit le gouvernement à demander un audit médico-légal du Malawi.
Du Trésor et des ministères compétents, qui ont bénéficié d’un soutien financier du DFID UK. En 2014, le gouvernement a décidé d'intensifier la mise en œuvre des réformes et a créé une commission des réformes de la fonction publique. Dès leur nomination, une délégation de la Commission. le Groupe de la gestion des réformes du secteur public et le PNUD se sont rendus au Kenya et à Singapour pour évaluer leurs meilleures pratiques en matière de réforme du secteur public et ont reçu deux missions de Singapour pour appuyer la mise en œuvre de la réforme et renforcer la prospective stratégique. Les recommandations générales et les conclusions de ces échanges Sud-Sud ont été résumées dans le rapport «Regard sur l'avenir: faire fonctionner le Malawi: transformer la fonction publique du Malawi» et est disponible ici. Une attention particulière a été accordée aux contrats de performance dans le secteur public, un domaine dans lequel le Kenya a acquis une expérience importante depuis son introduction en 2004. L'expérience pratique du Kenya en matière d'institutionnalisation des contrats de performance dans les systèmes gouvernementaux et sa contribution à une prestation de services efficace ont permis aux responsables malawiens de: concevoir de nouveaux outils de contractualisation des performances et améliorer la gestion de leurs groupes de travail sectoriels. Une méthodologie complète pour les contrats de performance a été mise au point par la Division de l'exécution du gouvernement du Cabinet du Malawi et adoptée dans une circulaire du Secrétaire général en 2015. S'appuyant sur les enseignements tirés de la visite d'évaluation au Kenya, la commission a recommandé la création d'un guichet unique. centres de distribution au niveau local, utilisant les infrastructures des bureaux de poste existants. Soutenus par la Banque mondiale, trois centres situés dans les districts de Lilongwe, Mangochi et Mzimba ont été finalisés en 2017. Plusieurs échanges de suivi, dont la visite d'une délégation du Parlement du Malawi, ont été organisés avec la Kenya School of Governance, un centre d’excellence sur l’intégrité de la fonction publique afin d’établir une relation à long terme permettant au gouvernement de créer une école de gouvernement au Malawi. L’objectif était de transformer, d’innover et de repositionner l’Institut de gestion du développement et du développement du personnel du Malawi, qui est chargé de renforcer les capacités des fonctionnaires à tous les niveaux, créant ainsi un secteur public plus réactif et des services de base de meilleure qualité. Conformément à la feuille de route issue de ces échanges, un projet de loi visant à créer cette école sera soumis aux législateurs en février 2018. De plus, les efforts déployés ces dernières années ont permis de dissiper la confusion entre les rôles des secrétaires principaux et des ministères. conflits de mandats entre la loi sur la fonction publique (1994) et la Constitution. L’élaboration d’une politique de réforme du secteur public et d’une politique de gestion de la fonction publique a des effets transformationnels sur la gestion de la fonction publique.
Rapporté par: PNUD, DFID et Banque mondiale
Mis en œuvre par: le cabinet du président et du cabinet, l'unité de gestion des réformes du secteur public
Personne de contact: Seodi White, directrice en chef, Unité de gestion des réformes du secteur public, courriel: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Résumé
Au cours des dernières décennies, de nombreux pays africains ont été confrontés à des situations instables et à diverses menaces pour la sécurité humaine et le développement. La mise en place d'institutions efficaces ainsi que la consolidation continue de la paix et de la stabilité sont nécessaires pour fournir des mécanismes alternatifs de résolution des conflits et s'attaquer aux causes profondes à long terme. L’expérience ghanéenne en matière de consolidation de la paix et son Conseil national pour la paix ont été des pionniers sur le continent. Son exemple inspire plusieurs autres pays confrontés à des situations de conflit imminentes.
Défi
Au cours des dernières décennies, de nombreux pays africains ont été confrontés à des situations instables et à diverses menaces pour la sécurité humaine et le développement. Plus de la moitié (35) des pays de l'Afrique subsaharienne sont actuellement exposés à des situations de conflit ou à des situations de fragilité face à la violence dans ses différentes dimensions. Les origines ethniques, la religion et les inégalités sociales ne sont que quelques-unes des causes qui déclenchent des flambées de violence. Ils rappellent également que des institutions efficaces ainsi qu'une construction continue de la paix et de la stabilité sont nécessaires pour fournir des mécanismes alternatifs de résolution des conflits et s'attaquer aux causes profondes à long terme. Au Ghana, par exemple, en cas de conflit, les agences de sécurité (paix et armée) ne souhaitent que mettre fin aux hostilités et ensuite punir les auteurs, ce qui crée davantage d'adversité. Sans possibilité d'écouter et de répondre aux préoccupations de toutes les parties en conflit, les causes profondes du conflit sont rarement traitées. Les agences d'État telles que la police sont souvent considérées comme des appendices du gouvernement, ce qui rend leur intervention souvent difficile. Par conséquent, il n’ya aucune possibilité d’écouter et de répondre aux préoccupations de toutes les parties en conflit. Les Conseils de paix nationaux et régionaux (CNPR), créés pour prévenir et régler les conflits, offrent cette plate-forme à toutes les parties, quelles que soient la perception du public et les préjugés à leur encontre, qui doivent s'exprimer à la table des négociations pour trouver une résolution à l'amiable. au conflit. Les N / RPC servent également d’arbitres neutres dans la résolution des conflits. Grâce aux membres éminents qui composent son conseil d'administration, il fait plus confiance que les institutions de l'État.
Solution
Si le Ghana a été un pionnier de la paix et de la stabilité au cours des dernières décennies, le pays est confronté à de nombreuses menaces pour la sécurité humaine en raison de sa situation géographique et de certaines régions du Nord. Bien qu’ils n’aient jamais menacé d’assumer une dimension nationale, de nombreux conflits entre chefferies, ethnies et ressources ont continué. Pour relever ces défis, le Ghana a mis en place une architecture de paix solide aux niveaux national, régional et des districts. Depuis 2011, le Conseil national de la paix a remplacé le Comité consultatif de la paix de la région du Nord (NORPAC), mis en place après le conflit de Dagbon en 2002 (suite à l'assassinat du suzerain de Dagbon et d'une trentaine de ses aînés) comme mécanisme de médiation et de résolution des conflits. favoriser la confiance entre les factions, rétablir la confiance et améliorer les relations. La NORPAC était composée de représentants d'organismes chrétiens et musulmans, de chefs traditionnels, de groupes de femmes et de jeunes et d'agences de sécurité. Suite au succès de la NORPAC, des conseils de paix nationaux et régionaux ont été créés pour faciliter et mettre en place des mécanismes de prévention, de gestion et de règlement des conflits et pour instaurer une paix durable dans le pays. Ils favorisent la résolution coopérative des problèmes liés aux conflits et, en institutionnalisant les processus de réponse aux conflits, produisent des résultats qui conduisent à la transformation des conflits, à la réconciliation sociale, politique et religieuse et aux dialogues transformateurs. À cet égard, le CNP a donc travaillé avec les principaux acteurs pour prévenir la violence lors des élections générales de 2008, 2012 et 2016. Il est également intervenu avec succès dans des conflits tels que le conflit de Tafo, le conflit de longue date entre les chefs Bawku, en aidant les factions à former une paix interethnique.
comité, où les gens peuvent tracer leur chemin vers la gestion et la résolution du conflit entre autres. En effet, le travail des CNPPR est très respecté par le Ghanéen et a toujours suscité une grande confiance lors des sondages Afro-baromètre. Le CNP sert d'exemple à de nombreux autres pays africains et a volontairement partagé son expérience avec les gouvernements de la région. Plusieurs visites, par exemple une visite d'étude de l'ambassadeur ivoirien accompagnée d'un groupe d'étudiants en 2015, un échange avec des responsables du Soudan du Sud et des échanges à plus long terme ont lieu avec des pays de la région. La visite de représentants du gouvernement éthiopien, d'un conseil interreligieux et de chefs religieux, dans le cadre d'un programme visant à renforcer les capacités nationales en matière de prévention des conflits, a permis d'intégrer des éléments importants du voyage d'étude dans un programme qui a soutenu les élections en Éthiopie en 2015. et l'architecture générale de la paix nationale.
Soutenu par: PNUD
Mis en œuvre par: National Peace Council (NPC) - Ghana
Personne de contact: Justice Agbezuge Analyste pour la paix et la gouvernance PNUD-Ghana, Accra - Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Résumé
Pour améliorer la conception et la capacité d'exécution des institutions concernées à intégrer l'adaptation au changement climatique et le développement durable dans l'ensemble des programmes, le gouvernement mauricien a mis en place un programme ambitieux qui met en œuvre non seulement des mesures de protection des plages souples et rigides, mais également un système d'alerte rapide dans les régions les plus touchées. zone côtière menacée, mais met également fortement l’accent sur le renforcement des capacités locales d’ingénierie. Le partenariat avec une importante université indienne d'ingénierie côtière a permis à l'Université de Maurice de mettre en place son propre cours de maîtrise en sciences, permettant aux ingénieurs locaux de développer des solutions techniques adéquates pour chacun des sites côtiers uniques.
Défi
Les côtes époustouflantes de la République de Maurice (ROM), avec son sable blanc, ses eaux transparentes et ses récifs coralliens, ont permis à la petite île de développer une industrie touristique dynamique qui représente une part substantielle de son économie et de son emploi formel. En dépit de sa transformation économique remarquable au cours des 50 dernières années, en tant que petit État insulaire en développement (PEID), le pays (y compris Maurice, Rodrigues, Agalega et divers petits îlots) est particulièrement vulnérable aux effets néfastes du changement climatique, en particulier. dans la zone côtière, où la convergence de l'élévation accélérée du niveau de la mer et de la fréquence et de l'intensité croissantes des cyclones tropicaux (avec des épisodes de précipitations plus intenses, des vents plus forts et des vagues plus fortes en raison de la dégradation des récifs coralliens) risque fortement d'entraîner des conséquences économiques pertes humaines, stress humanitaire et dégradation de l'environnement. Les effets visibles et mesurables du changement climatique sur la zone côtière de la ROM sont devenus plus évidents au cours des dix dernières années, reflétant une augmentation du taux de changements négatifs et une augmentation du nombre de sites vulnérables. L'élévation du niveau de la mer (mesurée à Port Louis) a été en moyenne de 3,8 mm / an au cours des cinq dernières années, contre une moyenne de 2,1 mm / an au cours des 22 dernières années. Les familles locales dépendent fortement des moyens de subsistance côtiers, tels que l'emploi dans le secteur hôtelier et la pêche, mais, en raison du pourcentage extrêmement élevé de propriétés privées, ne peuvent pas se déplacer vers d'autres sites. Ils restent les premiers à être exposés à des conditions climatiques défavorables et à subir les conséquences à long terme du changement climatique. La ROM manque de capacité technique pour convertir la gestion des risques liés à la variabilité climatique en interventions techniques pratiques adaptées à chaque site vulnérable. Chaque site côtier est unique en termes de facteurs déterminants, de taux de changement et d’éventuelles options techniques. Des compétences de haut niveau en ingénierie côtière sont indispensables pour évaluer correctement chaque site et concevoir des interventions appropriées et rentables.
Solution
Afin de protéger les communautés fortement exposées vivant dans les zones côtières de ces effets néfastes, le gouvernement mauricien, avec l'appui technique du PNUD, met en œuvre un programme d'adaptation qui comprend la mise en œuvre de mesures de protection des plages souples et rigides, la mise en place de un système d'alerte rapide pour les tempêtes et les marées, la construction d'un centre de refuge pour fournir un refuge sûr aux communautés côtières en cas d'ondes de tempête, d'autres catastrophes naturelles et l'amélioration du cadre institutionnel pour la gestion et la formation côtières. L’accent est également mis sur le développement de capacités d’ingénierie adaptées au contexte difficile. Compte tenu du manque de capacités adéquates pour faire face aux nouveaux phénomènes et aux conditions uniques de chaque site côtier, un accent particulier a été mis sur la formation et le renforcement des capacités des ingénieurs locaux, ce qui a également permis d'assurer la durabilité du projet. En 2017, 500 fonctionnaires des secteurs public et privé avaient été formés dans les domaines de l'ingénierie côtière et de l'économie du changement climatique.
L’Université de Maurice a mis en place un partenariat avec le département d’ingénierie océanique de l’Institut indien de technologie de Madras (IITM), centre multidisciplinaire de premier plan spécialisé dans les programmes de recherche et d’enseignement dans les domaines de la protection, de la conservation et de la conservation. gestion des écosystèmes marins. Des cours abrégés sur "l'ingénierie côtière" ont été dispensés à environ 50 ingénieurs locaux des secteurs public / privé et universitaires. L’Université de Maurice et l’IITM envisagent donc une collaboration à long terme pour la conception et la mise en œuvre d’autres cours de courte durée sur l’ingénierie côtière et la supervision conjointe d’étudiants au doctorat. Un cours complémentaire sur "Structures d'adaptation côtières (mesures douces) - Une étude de cas de Mon Choisy" a été enseigné par trois professeurs de l'IITM en août 2014 et deux cours de troisième cycle "MSc Coastal Engineering" et MSc "Changement climatique et réduction des risques de catastrophe" ont été montés en collaboration avec l'Université de Maurice. Le volet développement des capacités fait partie d’un programme plus vaste de cours d’ingénierie côtière. Il a également permis de produire trois «Manuels sur l’adaptation des zones côtières» présentés sous forme de modules de formation à l’intention des communautés côtières, des organismes publics concernés et des parties prenantes du secteur privé.
Soutenu par: PNUD et Fonds pour l'adaptation
Mis en œuvre par: Ministère de la sécurité sociale, de la solidarité nationale et de l'environnement et du développement durable
Personne (s) de contact: M. Satyajeet Ramchurn Analyste de programme pour l’environnement PNUD Maurice à Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
MN MN Khedah Chef de projet Projet Adaptation aux changements climatiques dans les zones côtières de Maurice à Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Résumé
La Commission nationale de planification de la Namibie est chargée de la planification macroéconomique du pays, mais dispose d'une exposition pratique limitée aux outils macroéconomiques avancés permettant d'estimer les niveaux de pauvreté aux niveaux national, régional et de circonscription. Des échanges substantiels avec le Centre de politique sociale de l’Université de Stellenbosch et le Social Insight Research Insight d’Afrique australe ont permis de renforcer la capacité de recherche et d’analyse macroéconomique du secrétariat de la Commission. Les formations ont porté sur l’application pratique de techniques appropriées d’analyse et de communication des problèmes socio-économiques. Globalement, le département a acquis une expérience pratique dans la production de recherches socio-économiques empiriquement valables et pertinentes sur le plan politique, sur la base des données du pays. Le chômage des jeunes et le développement humain national.
Défi
Malgré les progrès constants réalisés par la Namibie dans l'amélioration de son développement socio-économique au cours des dernières années et sa classification en tant que pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, le pays est toujours confronté à un niveau élevé d'inégalités. L'incidence de la pauvreté varie considérablement entre les régions et entre les zones rurales et urbaines de la Namibie. Bien qu'aucune analyse n'ait été entreprise pour déterminer les différences régionales, il est plausible de supposer de grandes variations dans l'incidence de la pauvreté dans les régions. La Commission nationale de planification (NPC) de Namibie, qui relève du bureau du président, est chargée de la planification, de la priorisation et de la direction du développement national incluant la planification économique grâce à une coordination, un suivi et une évaluation efficaces. Il dirige l'identification des priorités de développement socio-économique, élabore des plans de développement nationaux à court, moyen et long termes et élabore des mécanismes de suivi et d'évaluation. S'il était vraisemblable de supposer de grandes variations dans l'incidence de la pauvreté dans les régions, la Commission n'avait entrepris aucune analyse susceptible de fournir des données détaillées sur ces différences régionales et son personnel ne disposait pas des outils nécessaires pour estimer les niveaux de pauvreté aux niveaux régional et constitutionnel.
Solution
Cette opération a été réalisée en collaboration avec le Centre de politique sociale de l'Université de Stellenbosch et le Social Insight Research Insight d'Afrique australe, conformément à l'accord de partenariat 2014-2018 conclu entre le gouvernement de la République de Namibie et les Nations Unies. La Commission nationale de planification (CNP) a renforcé les capacités de ses planificateurs de développement nationaux en matière d'analyse de l'indice de Namibie de cartographie des privations multiples et de la pauvreté. En 2014/2015, une délégation de l'Université de Stellenbosch et de Social Insights Research Insight d'Afrique australe a organisé une formation spécialisée de 14 conseillers nationaux en développement du CNP sur le développement d'indices de défavorisation multiple. Cela a permis au personnel technique de la Commission nationale de planification de Namibie (CNP) de mener des études évaluant les niveaux de pauvreté dans les régions, en particulier au niveau des circonscriptions, et d'élaborer une analyse des tendances sur la base des recensements de 2001 et 2011, ainsi que de 2003/2004 et 2009. / 2010 Données sur les revenus et les dépenses des ménages namibiens (NHIES). Les responsables ont maintenant les compétences nécessaires pour présenter les données analysées sur des cartes à l’aide de StatPlanet. En outre, ils seront également en mesure d’enquêter sur des aspects de la pauvreté métrique non monétaire en prélude au travail de métrique monétaire à venir dans le pays. Cela leur permettra de conseiller les décideurs politiques aux niveaux national et régional sur la manière d'institutionnaliser l'affectation de ressources sur la base d'outils de base sur la pauvreté dans différents domaines. Grâce à la formation ultérieure dispensée à Stata, le secrétariat des CNP est désormais en mesure de fournir au gouvernement des orientations en matière de planification du développement et de définition des priorités, à l'aide de travaux analytiques. La Commission nationale de la planification utilise toujours les outils et méthodes d'analyse et à ce jour, trois notes d'orientation ont été produites sur les sujets suivants: i) L'intérieur de l'écart de rémunération entre hommes et femmes: Qu'est-ce qui explique les disparités de rémunération entre hommes et femmes en Namibie? ii) Augmentation du nombre d'inscriptions au développement de la petite enfance (DPE): où en sommes-nous? iii) La ressource inexploitée de la Namibie: analyse du chômage des jeunes. Il est probable que la Namibie (NPC) continuera de collaborer avec l’Université de Stellenbosch. Les compétences techniques améliorées et les capacités améliorées grâce à ce partenariat seront appliquées et utilisées dans la préparation du prochain RNDH.
Soutenu par: PNUD
Mis en œuvre par: Division macroéconomique, Commission nationale de planification (NPC), Namibie, personne à contacter, M. Sylvester Mbangu, conseiller en chef pour le développement national
Personne à contacter: Martha T Naanda, PNUD Namibie - Spécialiste du programme à Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Le Rwanda a réalisé des progrès sociaux et économiques importants au cours des 20 dernières années. S'appuyant sur un ensemble élaboré de stratégies de développement à long et à moyen terme, le pays a maintenu une croissance économique moyenne de 5 à 10% depuis 1995 et a atteint une grande partie des objectifs du Millénaire pour le développement (par exemple, l'éducation, la santé et l'OMD 1 manquant) seulement un peu).
Au début de cette trajectoire de développement positive après la fin du génocide en 1994, le Rwanda était fortement dépendant de l'aide publique au développement, qui, même si elle a été considérablement réduite d'ici 2014, représente encore près de 40% du budget national. En outre, en 2015, environ 15% des ressources extérieures provenaient de la coopération Sud-Sud et hors CAD.
Le grand nombre de partenaires de développement et de fonds consacrés à des objectifs de développement spécifiques a nécessité des efforts de gestion importants de la part de la nouvelle administration et a conduit à la mise en place d'une architecture de coordination du financement du développement innovante afin de garantir l'alignement des financements extérieurs sur les priorités de développement nationales. . Jusqu'à présent, cette architecture inspire les pays et les partenaires de développement de la région.
Pionnier de l'efficacité du développement sur le continent, le Rwanda dispose d'une politique de l'aide nationale bien établie (2006) et d'une architecture de coopération pour le développement, comprenant un mécanisme fiable d'évaluation de la performance des partenaires de développement (DPAF), organisé chaque année. Les performances sont mesurées à l'aide de 14 indicateurs d'efficacité, conformément au plan d'action national pour l'efficacité de l'aide et au programme d'action global pour l'efficacité (déclaration de Paris, cadre de suivi de Busan). Cette revue est publiée avec la revue des performances du gouvernement, évaluée annuellement conformément à la stratégie de développement nationale.
La DPAF et la division du travail (DoL) entre partenaires de développement (PD), qui impose aux PDD de ne travailler que dans trois secteurs au maximum, ont joué un rôle déterminant dans l’introduction d’un changement de comportement entre les PDD.
Un comité de mise en œuvre de la politique d'aide au niveau du cabinet assure la supervision et la direction stratégique de haut niveau dans ce domaine, tandis que le groupe de coordination des partenaires au développement réunit les gouvernements, les PDD, les OSC et les acteurs du secteur privé pour un dialogue de haut niveau. Au niveau sectoriel, le dialogue entre le gouvernement et les partenaires est organisé par le biais de groupes de travail sectoriels (GTS), dirigés conjointement par un ministère principal et un PDD.
À travers sa base de données sur l'aide au développement (DAD), le gouvernement recueille des données officielles sur le financement du développement auprès des partenaires du développement et publie des rapports officiels annuels.
Compte tenu de l'évolution du paysage financier du développement ces dernières années et d'une part croissante des ressources Sud-Sud et du secteur privé, le Gouvernement rwandais a développé de manière proactive sa politique de coopération Sud-Sud et travaille à la mise en œuvre d'un stratégie de financement du secteur privé et sur la mise au point d'un nouveau DPAF capable de mesurer "au-delà des partenariats d'aide" dans les domaines du commerce, de la fiscalité, de l'IDE, des PPP, etc.
Le Rwanda a volontairement partagé les enseignements tirés de la mise en œuvre de ces outils de gestion du financement du développement avec d'autres pays. Chaque année, le ministère des Finances et de la Planification économique accueille des délégations de ministères homologues pour s'informer des meilleures pratiques permettant de s'assurer que les principes d'efficacité sont respectés au niveau national. Pour n'en nommer que quelques-uns, les délégations du Bangladesh, de la Gambie, du Malawi, du Soudan et de Madagascar ont visité les institutions de gestion de l'aide du Rwanda et ont appris les meilleures pratiques pour assurer la coordination, l'alignement et les résultats aux priorités de développement nationales, ainsi que le suivi et la responsabilisation des interventions des PD.
Maurice est confrontée à plusieurs défis en matière d'égalité des sexes et de représentation des femmes au sein du conseil d'administration.
Conformément à la Vision 2030 de Maurice et visant à promouvoir la représentation descriptive et substantielle des femmes, un caucus parlementaire sur l'égalité des sexes a été créé au niveau de l'Assemblée nationale en mars 2017. Les exercices de planification stratégique s'inspirent des meilleures pratiques recensées dans d'autres pays du monde. la région.
Le pourcentage de femmes dans la politique formelle à Maurice est d'environ 12% (2015), tandis que la dernière étude de 2003 sur la représentation des femmes au sein du conseil d'administration à Maurice est restée à 7%. Le gouvernement de Maurice avait adopté en 2008 un cadre de politique nationale sur l'égalité des sexes qui invitait tous les ministères à formuler leurs politiques respectives en matière d'égalité des sexes. À la date actuelle, tous les ministères ont mis en place leur politique d'égalité des sexes, dotée d'un budget de 6 500 USD pour la mise en œuvre de programmes sexospécifiques.
Néanmoins, plusieurs problèmes en matière d'égalité des sexes et de représentation des femmes demeurent:
1) Ni l'état de la mise en œuvre des politiques en matière de genre, ni celui de l'égalité des genres dans le secteur privé n'ont été jusqu'ici abordés.
2) Les observations finales de la CEDAW ont identifié un certain nombre de domaines dans lesquels des solutions pourraient être envisagées pour réaliser l'égalité et l'équité entre les hommes et les femmes à Maurice et promouvoir et protéger les droits fondamentaux des femmes.
3) Le pourcentage de femmes occupant des postes de décision aux échelons supérieurs de la prise de décision doit être pris en compte pour assurer leur représentation sur le fond au niveau du Parlement.
4) La capacité des points focaux pour l'égalité des sexes dans les ministères sectoriels est également limitée en termes d'expertise ou de compétences en matière d'intégration de l'égalité entre les femmes et les hommes dans les politiques et les programmes, ainsi que dans les processus de budgétisation sensibles à l'égalité des sexes.
5) En outre, le nombre de cas de violence signalés est actuellement en augmentation et il est nécessaire que toutes les parties prenantes adoptent une approche globale et coordonnée pour s'attaquer au fléau de la violence.
La Vision 2030 de Maurice fournit le cadre général d'action pour le développement durable.
Un caucus parlementaire sur l'égalité des sexes a été mis en place au niveau de l'Assemblée nationale de Maurice en mars 2017 à la suite d'un amendement au Règlement, à la procédure et au règlement du Parlement, avec l'appui du PNUD.
La vision globale du Caucus est la réalisation de l'égalité des sexes, notamment en permettant la collaboration multipartite pour plaider en faveur de la prise en compte de la problématique hommes-femmes au Parlement; jouer le rôle de gardien de la mise en œuvre des politiques sectorielles en matière d'égalité des sexes; commander des travaux de recherche sur les principales questions liées à l'égalité entre les sexes et renforcer la capacité des membres du Parlement d'intégrer les questions d'égalité entre hommes et femmes dans les projets de loi, débats et autres processus de l'Assemblée législative.
Des activités ont été lancées à la suite de la commande par le caucus sur le genre d'un exercice d'audit du genre participatif dans les secteurs public et privé qui évalue la situation de l'égalité des sexes et identifie les lacunes et les défis en matière de réparation. Le soutien du secteur privé a été sollicité auprès d’une organisation faîtière regroupant environ 1 200 entreprises privées.
Le caucus sur le genre a également commandé une étude sur le profil sociologique des auteurs de violence domestique afin de pouvoir s'attaquer aux causes profondes de la violence entre partenaires intimes. À la suite de cette étude, avec l'appui technique du PNUD, un système d'information en ligne sur la violence domestique est actuellement mis en place au niveau de l'exécutif.
Pour garantir la durabilité à long terme, conformément aux objectifs de développement nationaux, le Gender Caucus élabore actuellement son plan stratégique avec le soutien du PNUD. Il s'inspirera des meilleures pratiques en vigueur en Ouganda, au Rwanda et au Malawi, ainsi que autres pays de la SADC et du Forum parlementaire régional des femmes de la SADC.
Résumé
Visite d’expérience sur le système d’alerte précoce existant au Kenya
Défi
On s'attend à ce que, à mesure que le changement climatique se développe au Bénin, la variabilité de la fréquence et de l'intensité des chocs liés au climat augmente, nécessitant ainsi l'adaptation de divers secteurs socio-économiques. La vulnérabilité du Bénin aux risques météorologiques a été démontrée en 2010, lorsque le Bénin a subi plus de 262 millions USD de pertes dans divers secteurs socio-économiques (par exemple, l'agriculture, le commerce et les infrastructures) en raison des inondations. De même, la région côtière du Bénin, qui compte plus de 3 millions d'habitants et l'un des plus grands marchés commerciaux de l'Afrique occidentale et centrale, a été victime d'un empiétement du littoral atteignant 16 mètres par an, ce qui a eu un impact majeur sur la pêche, les industries portuaires et le tourisme.
Dans un pays en développement comme le Bénin, les impacts du changement climatique sont exacerbés par des mécanismes de sensibilisation limités aux niveaux locaux et par la dépendance d'un pays à l'égard de l'agriculture de subsistance. Pour le Bénin, l'amélioration de la collecte d'informations sur le climat (IC) et la mise en place d'un système d'alerte précoce (SAP) constituent un moyen efficace de sensibiliser la population en général aux risques météorologiques et climatiques afin que les communautés (notamment les agriculteurs pluviaux) puissent se préparer en conséquence. Cependant, à l'heure actuelle, il n'existe pas au Bénin de système d'alerte rapide pour la prévision multirisque (p. Ex. Déferlement côtier et inondations) ainsi que de capacités pour produire et diffuser des informations sur le climat et le climat.
Solution
Cette solution consistait en une mission d'étude au Kenya du 24 au 29 mars 2014. Le Centre de prévision et d'application du climat (ICPAC) de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) basée au Kenya dispose d'un système d'alerte précoce qui couvre tous les pays d'Afrique de l'Est. L'ICPAC est également en contact avec toutes les autres institutions nationales et régionales basées au Kenya impliquées dans l'alerte précoce.
L’objectif principal de la mission était de visiter et d’apprendre sur le fonctionnement et les différentes composantes des systèmes d’alerte précoce au Kenya. Plus précisément, la mission impliquée:
- Acquérir des connaissances sur divers composants techniques (équipements, technologies et infrastructures informatiques) du SAP (de la phase d'acquisition et de transmission des données à la phase de production-diffusion de l'alerte, en passant par la phase de traitement et de prévision des données);
- Rencontrer les principales structures impliquées dans la prévention des risques hydro-climatiques afin de comprendre le modèle organisationnel et le fonctionnement institutionnel des SAP au Kenya et en Afrique de l'Est;
- Se renseigner sur les limites et le niveau de sécurité offerts par les dispositifs existants dans la prévention des risques hydro-climatiques;
- Apprendre à connaître les aspects administratifs, juridiques et financiers des activités d’alerte rapide sur les risques hydro-climatiques au Kenya et en Afrique de l’Est sous la direction de l’IGAD; ainsi que des aspects liés à l'intégration du secteur privé.
L'expérience acquise a permis de renforcer les capacités des structures nationales impliquées dans la mise en œuvre du système d'alerte précoce (SAP). Un SAP transitoire pour la gestion des inondations a été mis en place en 2014. La couverture nationale pour la surveillance du climat / météo a été améliorée de 26%, passant de 30% à 56%. La périodicité de la collecte et de la transmission des données de la station est passée d’une base mensuelle (difficile) à une base quotidienne.
Soutenu par: PNUD
Mis en œuvre par: Direction générale de l'eau, Institut national de l'eau, Agence nationale de météorologie ou de météo-Bénin, Institut de recherches hydrologiques et océanologiques du Bénin (IRHOB)
Centre de prévision géographique de l'Agad, Autorité intergouvernementale pour le développement, Bureau sous-régional de l'OMM pour l'Afrique centrale et Australe, Autorité nationale de gestion de la sécheresse, Centre régional de cartographie des ressources pour Département de la météorologie du Kenya et de la gestion des ressources en eau au ministère de l'environnement, de l'eau et des ressources naturelles
Personne à contacter: Isidore Agbokou, Chef d’équipe, Unité Développement Développement Durable et Croissance Inclus, Programme des Nations Unies pour le développement - Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Résumé
La capacité du Cameroun à élaborer et à mettre en œuvre des stratégies pour la qualité des services fournis aux utilisateurs a été renforcée par des échanges avec des responsables des gouvernements marocain et rwandais.
Défi
Le Cameroun est confronté à des déficits de gouvernance, qui ont des conséquences négatives sous la forme de corruption, d’administration publique médiocre et inefficace et d’un environnement commercial peu attrayant. L’amélioration de la qualité de service contribue à rétablir la relation de confiance entre les administrations et les utilisateurs grâce à la transparence et à l’accès à des informations précises, à la qualité de l’accueil et à la possibilité de recours, dans le but de réduire la corruption et d’améliorer le climat des affaires.
Solution
Renforcer les connaissances de la délégation dans le domaine de l'élaboration et de la mise en œuvre de stratégies pour la qualité des services fournis aux utilisateurs, par le biais d'échanges avec des responsables gouvernementaux marocains et rwandais.Ce voyage d'étude a contribué au développement du capital humain (formation ciblée, réforme des dispositions relatives à la gestion des ressources humaines, etc.). .), le développement des systèmes d’information des utilisateurs, la relecture et la réadaptation du cadre institutionnel (Constitution, lois, etc.). Grâce à ces échanges, le Cameroun a pu élaborer une norme de qualité de service homologue ISO, la première en Afrique subsaharienne. La norme de qualité de service du Cameroun NC 1756: 2017 est actuellement mise en œuvre dans certains services publics.
Soutenu par: PNUD
Mis en œuvre par: le Ministère de la fonction publique et de la réforme administrative du Cameroun par le biais du Programme d'appui à l'amélioration de la qualité des services aux utilisateurs (PAAQSU).
Personne de contact: Cameroun: Jean Paul NLEND NKOTT; Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Résumé
Des échanges d’expériences ont été promus entre le Madagascar, le Togo et l’Afrique du Sud en vue de renforcer les capacités et systèmes de réconciliation nationale au Madagascar.
Défi
Depuis son accession à l’Indépendance, Madagascar a souffert de crises récurrentes (1972, 1991, 2002 et 2009 qui ont fragilisé l’environnement socio-économique du pays et aggravé l’extrême pauvreté de la population. Après la crise politique de 2009, Madagascar affronte le défi de la réconciliation nationale, la remise à niveau des services de l’Etat et la reconstruction du tissu social déchiré par des mois de crises. II s’agit pour le pays de mettre en place un mécanisme durable pour rompre le cycle de crise qui constitue un frein à son développement.
Solution
Des représentants des institutions nationales en charge de la réconciliation ont participé à des échanges d'expériences et bonnes pratiques en matière de processus de réconciliation nationale au Togo et en Afrique du sud.
Les représentants de la Présidence, Primature, Assemblée Nationale, Conseil de Réconciliation et Ministère de la Communication ont participé aux missions d’échanges.
Les missions d’échanges ont eu pour principal objectif de s’enquérir des expériences et des leçons tirées à partir des systèmes de réconciliation nationale sud-africain et togolais en vue d’alimenter les réflexions autour de la réconciliation nationale malgache et du renforcement des capacités des acteurs impliqués dans ce processus.
Des réflexions sont engagées pour valoriser les expériences de ces deux pays, en les adaptant au contexte de Madagascar. Un appui technique par une ONG sud-africaine In transformation Initiative (ITI) qui a effectué plusieurs visites à Madagascar en collaboration avec l'ambassade d'Afrique du Sud qui soutient les efforts visant à soutenir un programme de dialogue national et de réconciliation mené par le président. Ces échanges ont contribué aussi à mieux définir la vision et la démarche de réconciliation que le pays veut mettre en place ; ce qui a abouti à la réforme du cadre légal qui régit ce processus (la loi n°2016-037 relative à la réconciliation nationale) et à la restructuration du Conseil du Fampihavanana Malagasy (CFM), l’entité chargé de conduire la réconciliation.
Après la prise de fonction des nouveaux membres du CFM cette année, le prochain défi pour cette institution et pour Madagascar consiste à engager le processus de réconciliation, surtout dans un contexte où le pays s’apprête à faire face à des nouvelles échéances électorales en 2018.
Soutenu par: PNUD
Implementé par: PNUD, In Transformation Initiative, ONG sud-africaine
Contact:
Lalaina Rakotozandry
Chargé de programme Gouvernance
PNUD Madagascar
Email: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.