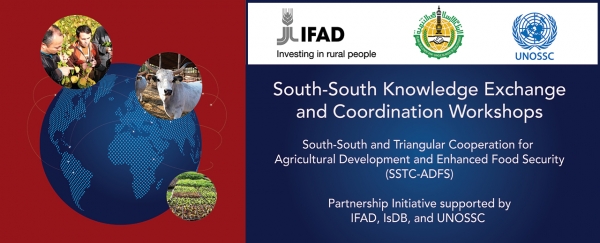Solutions SSDA
South-South Development Academy
Solutions SSDA
South-South Development Academy
Blog
La situation des réfugiés et des migrants dans le pays est influencée négativement par le caractère épidémique de la tuberculose et d'autres maladies transmissibles. La stratégie de lutte antituberculeuse de l'OMS est l'une des solutions d'adaptation et d'application sur le terrain. Les formations de la JICA ont pour objectif de promouvoir la solution de la tuberculose en collaboration avec le programme national de lutte antituberculeuse (PNT), auquel ont été conviés les agents de PNL d'autres pays et les représentants des ministères de la Santé.
En particulier, depuis 2015, la JICA offre des possibilités de formation de quatre semaines en collaboration avec le Programme national de lutte antituberculeuse (PNT) en Égypte afin de:
- Mettre à jour les connaissances sur la tuberculose et son contrôle;
- Améliorer les compétences analytiques nécessaires à la situation en matière de contrôle de la tuberculose;
- Développer des compétences pour améliorer le système d'enregistrement et de notification de la tuberculose dans leurs propres domaines de responsabilité;
- Améliorer leurs connaissances en matière de contrôle de l'infection tuberculeuse;
- Améliorer leurs connaissances en matière de planification stratégique de la lutte antituberculeuse;
- Améliorer leurs connaissances et leurs compétences dans les activités de supervision et de contrôle de la tuberculose;
- Améliorer leurs connaissances de la gestion de la tuberculose M / XDR;
- Améliorer leurs connaissances sur la gestion des médicaments antituberculeux; et
- Améliorer leurs connaissances en plaidoyer, communication et mobilisation sociale (ACSM).
La JICA a invité les agents du PNT des autres pays et les responsables du ministre de la Santé.
Les formations sont organisées en groupe pour le personnel administratif et médical avec des visites sur site et sur la base des directives de l’OMS pour les soins de la tuberculose. La diffusion des informations appropriées tant pour les responsables du ministère de la Santé que pour les personnels médicaux enrichit la qualité des directives mises à jour. Cela leur permet de traiter correctement les patients tuberculeux de manière standardisée.
Réalisations:
Grâce à cette opportunité de formation, les capacités techniques et un réseau multi-pays d'agents de santé de plusieurs pays ont été renforcés et construits pour agir efficacement en moins de temps.
Grâce aux informations et aux connaissances mises à jour obtenues grâce à cette formation du projet JICA, les participants à la formation ont amélioré leurs qualifications pour pouvoir suivre l'évolution récente de la tuberculose et d'autres maladies transmissibles, comme par exemple: Les anciens stagiaires de la JICA ont participé à la politique nationale antituberculeuse planification au Soudan.
Ce cours de formation similaire est organisé depuis 2008 et a accueilli 169 stagiaires jusqu'en 2018 en provenance de l'Iraq, de l'autorité palestinienne, d'Oman, du Soudan du Sud, de la Jordanie, de la Tunisie, de Djibouti, de l'Afghanistan et du Pakistan.
La coopération régionale doit être considérée comme un facteur important pour lutter contre les maladies transmissibles. Dans ce contexte, la participation de plusieurs pays (de la même région) est recommandée afin de favoriser les synergies entre la région ME.
Partenaires : JICA; Ministère de la santé / Gouvernement égyptien;
Budget: 80 000 USD / an (20 stagiaires, 4 semaines)
Détails du contact:
Agence japonaise de coopération internationale (JICA) Égypte
Atsushi Kono
Conseiller en formulation de projet
Bureau de la JICA en Egypte
Email: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Depuis le début de la crise syrienne, 1,5 million de personnes ont trouvé refuge au Liban. La plupart des réfugiés se sont installés dans des camps informels où les conditions de vie sont difficiles et où beaucoup d'entre eux n'ont pas accès à l'infrastructure sanitaire en raison de la localisation géographique, du coût des consultations médicales et d'autres facteurs.
Pour assurer l'accès aux soins de santé de base aux réfugiés dans les camps informels et dans les villages reculés, Amel Association Center, une organisation non gouvernementale libanaise, a mis en place l'Unité mobile médicale (MMU), un véhicule spécial équipé de tous les outils médicaux. Chaque unité est composée d'un médecin, d'une infirmière, d'un travailleur social et d'un chauffeur.
La première MMU a commencé à fonctionner à la fin de l'année 2012 à Bekaa, au Liban-Est. En 2014, d'autres unités ont été mises en place au Sud-Liban pour toucher une plus grande partie de la population.
Afin d'encourager les personnes vulnérables / vulnérables à se faire soigner, l'unité mobile médicale a établi un calendrier avec des changements réguliers. Le contact avec les personnes vulnérables permet d'identifier les personnes souffrant de maladies graves. Dans ce cas, les médecins d'Amel les réfèrent soit aux centres d'Amel, soit à d'autres ONG spécialisées.
Les consultations médicales générales et les médicaments sont fournis gratuitement.
L'autre mission de ces unités est de fournir des séances de sensibilisation sur divers sujets de santé et sociaux. Les sujets couverts sont définis par l'équipe médicale en fonction des besoins. Par exemple, si l'équipe observe que les personnes souffrent de diarrhée, les séances de sensibilisation se concentreront sur les règles sanitaires pour éviter ce phénomène.
Réalisations:
Depuis 2013, 222 612 consultations ont été réalisées avec le soutien des communautés locales (19 983 en 2013, 42 953 en 2014, 50 528 en 2015, 50 717 en 2016 et 58 431 en 2017), permettant d'accéder à un bon système de santé pour les campeurs.
Compte tenu du succès de la mise en œuvre du projet, de nouveaux fonds ont été obtenus pour reproduire le projet dans d'autres régions du Liban.
Budget : 100 000 $ par unité et par an, couvrant notamment:
- Acheter le véhicule;
- Équiper le véhicule;
- Acheter le matériel et l'équipement;
- Couvrant les allocations pour les médecins, les infirmières, les travailleurs sociaux et les chauffeurs.
Partenaires: Agence Française pour le Développement (AFD), MEDICO
Détails du contact:
Liban
Nom et titre: Dr Kamel Mohanna, président
Téléphone: + 961 3 202 270
Email: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
La Hongrie a mis en place des règlements obligatoires sur la nourriture scolaire. La politique alimentaire scolaire (SFP) est intégrée à d'autres politiques en matière de santé ou d'éducation. Un certain nombre d'activités liées à la nutrition sont menées sous les auspices du Programme national de santé publique.
Le programme de volontariat pour les fruits et légumes à l'école offre aux écoliers des fruits et légumes, dans le but de promouvoir la consommation de fruits et légumes et d'encourager de bonnes habitudes alimentaires chez les jeunes. En plus de fournir des fruits et légumes, le programme comprend des initiatives éducatives et de sensibilisation.
95% du groupe cible bénéficie du programme en recevant 3-4 portions de fruits et légumes par semaine à l'école et en participant à des mesures éducatives d'accompagnement. Les principales caractéristiques du régime sont les suivantes:
- Groupe cible: élèves de 6-12 ans
- La portée des produits: fruits et légumes frais et jus de fruits
- Durée: 27 semaines
- Mesures pédagogiques d'accompagnement: cours de dégustation, matériel pédagogique, visites de fermes, concours et récompenses favorisant des habitudes alimentaires saines.
Cette solution fournit un exemple des types d'actions de stratégie pouvant être prises pour la réplication.
Pour plus d'informations:
- http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/agrargazdasagert-felelos-allamtitkarsag/hirek/iskolagyumolcs
Informations de contact du fournisseur de solutions:
Ministère de l'Agriculture de Hongrie
Département des affaires de l'UE et de la FAO
Département des marchés agricoles
Bittsánszky Márton
Tel: +36 1 7953 808
Email: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
{galerie} sud-sud-monde / galeries / schoolfruitshungary {/ gallery}
Avec une population libanaise vulnérable estimée à 1,5 million d'habitants et une population massive de réfugiés syriens (1,5 million en octobre 2016), le Liban est le premier pays au monde pour le nombre de réfugiés par habitant (environ le quart). Cette population est majoritairement pauvre et vit souvent dans des conditions indignes et misérables dans les zones urbaines (surpeuplement, promiscuité, hygiène déplorable, etc.).
Dans les grandes villes, en particulier à Beyrouth, le phénomène du travail et de la mendicité des enfants dans les rues augmente. Les enfants sont souvent poussés par leurs parents, qui n'ont parfois pas le droit de travailler, pour assurer un minimum de subsistance à leur famille. Ces enfants sont très vulnérables et victimes, à grande échelle, d'abus et d'exploitation de toutes sortes: violence familiale, abus sexuel, prostitution, travail forcé. Beaucoup de ces mineurs souffrent de troubles mentaux.
Amel Association Center , une organisation non gouvernementale libanaise, avec le soutien de Samusocial International et le Centre de crise et de soutien du ministère des Affaires étrangères de la France a lancé l'Unité de protection mobile visant à aller directement aux personnes les plus vulnérables et marginalisées dans les rues de Afin de leur apporter un soutien médico-social et de lutter contre la maladie et l'exclusion sociale dans lesquelles ils vivent. Considérant que la réduction de leur marginalisation est la première étape pour sortir ces enfants et leurs familles de la rue, l'un des principaux objectifs du projet est de contribuer à les reconnecter avec la société en les redirigeant vers des organisations compétentes, des institutions étatiques, des associations, etc.
Depuis le début du projet en mai 2017, une équipe mobile composée d'une infirmière, d'une assistante sociale et d'un chauffeur / assistante sociale opère dans les quartiers les plus marginalisés de la banlieue Sud de Beyrouth (Shwayfat, Bir Hassan, Ouzayi, Tarik el Matar, etc.).
Ils sont chargés d'identifier les personnes vulnérables exposées dans la rue (mendier, travailler, errer, vivre ou dormir dans la rue). Après avoir tissé un lien social avec eux et gagné leur confiance, l'équipe offre des premiers soins, des soins infirmiers et un soutien social immédiats. Selon leurs besoins, les bénéficiaires sont référés vers les centres Amel ou vers toute autre organisation compétente pour recevoir le soutien dont ils ont besoin (dans les domaines médical, éducatif, psychosocial).
Le véhicule de l'équipe est spécialement équipé pour assurer les premiers soins, les consultations privées et le transport des bénéficiaires.
L'équipe est chargée d'accompagner les bénéficiaires à leurs rendez-vous / consultations, et assure un suivi régulier avec eux pour s'assurer que la référence a été réussie.
Réalisations: Entre juillet 2017 et décembre 2017 (6 mois d'activité), 301 personnes vulnérables, principalement des enfants, ont été identifiées.
→ 29 personnes ont reçu une première aide médicale dans les rues par l'infirmière de l'équipe,
→ 110 ont été référencés et accompagnés par le centre Amel ou d'autres associations (selon les besoins) :: 27 en éducation sociale, 70 centres médicaux, ...
→ 66% des bénéficiaires ont moins de 12 ans et 20% ont entre 12 et 20 ans.
Budget : 400 000 € couvrant notamment:
- Acheter le véhicule;
- Équiper le véhicule;
- Acheter le matériel et l'équipement;
- L'achat de fournitures médicales et de médicaments;
- Couvrant les consultations médicales / analyses médicales;
- Couvrir les salaires du personnel de coordination et des membres de l'équipe mobile.
Partenaires: Samusocial International (France), Centre de crise et de soutien du Ministère des Affaires étrangères de France
Détails du contact:
Liban
Dr. Kamel Mohanna, Président
Téléphone: + 961 3 202 270
Email: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Résumé:
Le projet d'appui à la modernisation du quartier Chamanculo C dans la capitale mozambicaine a été le fruit d'un accord de coopération signé entre la municipalité de Maputo, le gouvernement brésilien, le gouvernement italien et l'Alliance des villes, avec le soutien de Bank World. Le projet a été inspiré par l'expérience de réhabilitation du quartier d'Alagados à Salvador (Brésil), réalisée par l'ONG italienne AVSI, qui était également un partenaire central de l'initiative mozambicaine. Basé sur la méthodologie utilisée au Brésil, le projet de Chamanculo C consistait en une expérience pilote au Mozambique, contribuant à la consolidation de la politique d'intervention nationale dans les établissements informels, développée parallèlement à l'initiative.
Problème:
Les occupations informelles du territoire et les établissements urbains précaires prévalent dans de nombreux pays du Sud. Parmi les causes de cette situation figurent l'absence de politiques de logement saines dans les contextes d'urbanisation, l'expansion des flux migratoires ruraux-urbains et la persistance de la pauvreté.
Selon ONU-Habitat, plus d'un million de personnes vivent à Maputo, dont 75% dans des quartiers informels dotés d'infrastructures et de services urbains précaires ou inexistants. Ces établissements sont souvent situés dans des zones inappropriées, sujettes aux inondations, générant et exacerbant les situations à risque. L'atténuation de ce cadre nécessite un vaste programme d'amélioration progressive, capable d'impliquer et d'intégrer différentes politiques sectorielles et investissements liés au logement. En effet, la proposition du «Plan de Structure Urbaine de la Municipalité de Maputo» (PEUMM) reconnaît que «l'injustice de cette situation est insoutenable» et qu '«il est indispensable d'attribuer aux opérations informelles de réaménagement des quartiers une priorité absolue mécanismes techniques et organisation institutionnelle nécessaires à la grande bataille pour une ville sans bidonvilles, répondant ainsi aux stratégies globales dont le Mozambique est signataire.
Solution:
Mis en œuvre entre 2008 et 2016, le projet d'appui à la requalification du quartier Chamanculo C visait à transférer expertise et savoir faire pour faire face à la précarité du logement à Maputo et au Mozambique. Plus précisément, le projet visait à contribuer à l'amélioration de la qualité de vie de la population de Chamanculo C, à travers l'élaboration et l'application d'une méthodologie de requalification urbaine intégrée et participative. Le projet était structuré autour de quatre axes principaux:
- Préparation d'études et de plans;
- Promotion du développement local
- Renforcement institutionnel et supervision du projet et
- Exécution des travaux prioritaires.
La méthodologie d'intervention sur le territoire consistait en une combinaison de logements urbains, d'actions environnementales et socio-économiques, développées avec une large participation de la population locale, et comprenant la réalisation d'infrastructures prioritaires et l'exécution du plan de développement local (priorisation des actions à mettre en œuvre, le financement de projets élaborés par des associations locales, des initiatives socio-économiques, éducatives et sanitaires, et le renforcement des associations communautaires).
Parallèlement aux interventions physiques et sociales dans le quartier de Chamanculo C, le projet visait à soutenir le renforcement institutionnel et la structuration de politiques publiques plus larges, centrées sur l'administration municipale, à travers la formation des ressources humaines et la formulation de plans et projets. Plus précisément, le projet a contribué à la conception d'une stratégie d'intervention municipale dans les quartiers informels (en synergie avec le «Plan d'urbanisme de la ville de Maputo») pour l'élaboration de manuels et de procédures, ainsi que pour l'introduction de garanties environnementales et sociales. politiques.
Tout au long du projet, des activités de consultation, de diffusion et d'évaluation de l'expérience avec la communauté ont été menées, en utilisant des groupes focaux, des cartes parlées, des enquêtes annuelles d'évaluation participative et la systématisation et l'analyse des indicateurs, entre autres. En outre, les partenaires ont assumé la responsabilité de la supervision globale des initiatives mises en œuvre, avec des réunions du Comité quadripartite et des missions techniques du Brésil et de l'Italie, deux fois par an.
Supporté par:
Du côté brésilien: Agence Brésilienne de Coopération (ABC), Caixa Econômica Federal (CAIXA) et Ministère des Villes
Du côté italien: Ministère des affaires étrangères (Direction générale de la coopération pour le développement)
Partenaires internationaux: Alliance des villes et Banque mondiale
Agence d'exécution:
Fondation AVSI et Municipalité de Maputo
Détails du contact:
Brésil
Alliance des villes
Anacláudia Rossbach
Conseiller régional, Amérique latine et Caraïbes
Email: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Résumé:
Mis en œuvre entre 2014 et 2017, ce projet de coopération Sud-Sud visait à encourager l'augmentation de la production alimentaire au Botswana à travers le développement des coopératives et des associations rurales. Financé par l'Agence brésilienne de coopération (ABC) et géré par l'Organisation des coopératives brésiliennes (OCB) avec le soutien technique de la Corporation brésilienne de recherche agricole (EMBRAPA), le projet avait un caractère pilote et était axé sur les producteurs de légumes.
Problème:
Sur les deux millions d'habitants du Botswana, 39% vivent dans les zones rurales; Cependant, la grande majorité du territoire (85%) est couverte par le désert du Kalahari. Avec une économie fragile et une production agricole peu diversifiée, le pays dépend fortement des importations alimentaires. Par exemple, l'importation de légumes représente 75% de tous les aliments consommés à l'échelle nationale, ce qui rend ce secteur stratégique pour la sécurité alimentaire. En ce sens, le gouvernement du Botswana a cherché à encourager les producteurs locaux à s'organiser en coopératives afin de mieux gérer les problèmes qu'ils rencontrent individuellement, tels que le stockage et le transport des produits. Les agriculteurs peuvent ainsi devenir plus compétitifs et coopérer pour abaisser les prix des aliments de base au consommateur final.
Solution:
Le projet de renforcement des coopératives et des associations rurales au Botswana visait à diffuser le modèle coopératif pour la promotion du développement agricole dans le pays. La dimension coopérative inclut l'acquisition de connaissances appropriées pour la gestion partagée et participative des entreprises, l'orientation commerciale et la capacité organisationnelle des producteurs. Ces connaissances visent à donner aux agriculteurs une autonomie dans la gestion et des possibilités de gestion créatives et durables, ainsi que la représentativité et la légitimité avec le marché et le pays.
Le partage de l'expérience brésilienne avec les coopératives a impliqué des visites techniques et une formation dans deux axes principaux: l'autonomisation des producteurs familiaux et des leaders communautaires ruraux pour agir en tant que multiplicateurs du modèle coopératif localement, et la sensibilisation des représentants des organismes régulateurs à la pratique de la coopération dans la formulation des politiques publiques. Avec la collaboration du gouvernement du Botswana, des producteurs ayant un profil coopératif - c'est-à-dire des experts du marché et les principales difficultés de telles entreprises - ont été identifiés et, après cette cartographie, des plans de travail et d'affaires ont été élaborés pour le secteur horticole. Les réunions de travail ont également impliqué des organisations de la société civile telles que l'Association coopérative du Botswana (BOCA), le Centre de formation coopératif du Botswana et le Marché central de Gaborone.
La formation au Botswana et au Brésil a bénéficié à un total de 43 personnes (agents gouvernementaux et producteurs de fruits et légumes) axées sur la planification, la formation et la gestion coopérative, ainsi que la gestion des cultures horticoles en partenariat avec EMBRAPA Hortaliças. Pendant la période de formation, les agriculteurs de la communauté de North Kweneng ont décidé de fonder leur propre coopérative, qui servira de modèle à suivre dans d'autres régions du pays. Enregistrée en novembre 2015, la North Kweneng Horticulture Cooperative, qui compte actuellement 14 familles coopérantes, est soutenue par le ministère de l'Agriculture du Botswana et dispose déjà de tous les documents nécessaires pour fournir de la nourriture aux programmes sociaux des gouvernements locaux.
Supporté par:
Agence de coopération brésilienne (ABC)
Agences de mise en œuvre:
Du côté brésilien: Organisation des coopératives brésiliennes (OCB) et Corporation brésilienne de recherche agricole (EMBRAPA)
Du côté botswanais: Ministère de l'Agriculture
Détails du contact:
Brésil
Organisation des coopératives brésiliennes (OCB)
João Marcos Silva Martins
Analyste d'affaires
Email: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Résumé:
Mis en œuvre en République démocratique du Congo (RDC) depuis 2011, le projet Voices of Africa vise à autonomiser les petits agriculteurs et les agriculteurs familiaux dans les technologies socio-environnementales durables développées par l'agroécologie grâce à une extension universitaire innovante. Le projet repose sur un accord de coopération entre l'Université fédérale de Lavras (UFLA, Brésil), l'Université libre des pays des Grands Lacs (ULPGL, Goma, RDC) et l'Institut national d'études et de recherches agronomiques (INERA, RDC); Reproduisant en quelque sorte le «projet Carrancas» pour l'agriculture familiale, financé par le Conseil national de développement scientifique et technologique (CNPq, Brésil) et exécuté au Brésil par l'UFLA. Le «projet Carrancas» a été reconnu comme un modèle de développement économique / socio-environnemental par le ministère brésilien de l'Environnement.
Défi:
Le gouvernement de la RDC vise à réduire la proportion de la population dont les revenus sont inférieurs à un dollar par jour et la proportion de la population affamée. Dans ce contexte, la sécurité alimentaire est devenue l'un des principaux défis de ce pays caractérisé par les petites exploitations et l'agriculture de subsistance. La faible productivité de ces unités repose sur des pratiques agricoles non viables, qui déclenchent souvent la déforestation, la désertification, la perte de biodiversité, ainsi que la dégradation des sols, des sources, des sources et des eaux souterraines. L'une des causes de cette situation est l'accès difficile des communautés aux connaissances scientifiques générées dans les universités et les centres de recherche. Une fois ajustée aux demandes locales, cette connaissance permet de tirer parti du potentiel agricole naturellement présent dans le pays. De plus, le fait que les petits producteurs ne soient pas organisés en coopératives ne permet souvent pas de tirer profit des avantages collectifs, en particulier le stockage sûr des produits et les avantages potentiels des économies d'échelle.
Solution:
Le projet novateur d'extension des universités «Voices of Africa» vise à former des enseignants et des techniciens congolais aux technologies socio-environnementales durables, développées, testées et approuvées par l'agroécologie. Grâce à l'échange de professionnels des deux pays, le projet propose l'utilisation de pratiques simples et viables, adaptées au contexte local, qui se traduiront par une meilleure qualité de vie pour la population et la préservation de l'environnement.
Promouvoir le développement d'une agriculture économiquement viable, écologiquement correcte, socialement juste et culturellement appropriée passe, en particulier, par l'utilisation de ressources indigènes, la distribution d'intrants et de produits à coûts élevés. Le projet met l'accent sur la sécurité alimentaire par la production d'aliments de base et de base, la création d'emplois et un revenu décent, qui mettront les personnes sur leur propriété, aussi petites soient-elles, décourageant ainsi l'exode rural et la formation de communautés de la promiscuité autour des grandes villes.
Suivant une approche participative, la connaissance de l'agroécologie est transmise aux petits agriculteurs familiaux et aux producteurs, à travers des ateliers de formation organisés dans les communautés elles-mêmes. Les communautés qui excellent dans l'apprentissage sont appelées UEP (Unités Expérimentales Participatives) et deviennent des points focaux pour la diffusion des connaissances acquises dans un format croissant en spirale.
Mis en œuvre en tant qu'initiative pilote à Goma (province du Nord-Kivu), le projet «Voices of Africa» a également été mené dans la capitale Kinshasa et dans la province de Maniema. En ce qui concerne les résultats, à la fin de 2013, le projet avait formé 60 enseignants et techniciens congolais en agroécologie et aurait touché environ 3 500 agriculteurs familiaux autour de Goma, Kinshasa et Kindu. Une coopérative agricole de petits agriculteurs (Cooperativa Agropastoril dos Grandes Lagos) a été fondée à Butembo (province du Nord-Kivu) et trois stations de radio ont été créées pour diffuser des programmes éducatifs dans la province. En outre, l'ULPGL a commencé à développer des activités de vulgarisation universitaire axées sur l'agroécologie et l'agriculture familiale.
Grâce aux activités de vulgarisation universitaire, les connaissances générées dans l'académie transcendent les frontières, dans un dialogue participatif avec les communautés, entraînant à la fois l'autonomisation des agriculteurs et l'amélioration conséquente de la productivité, ainsi que la formation de professionnels plus engagés avec les réalités dans les localités. Le projet «Voices of Africa» est actuellement en cours de reproduction au Mozambique, dans le cadre d'un partenariat entre l'UFLA et l'ONG brésilienne Fraternidade Sem Fronteiras.
Supporté par:
Agence Brésilienne de Coopération du Ministère des Affaires Etrangères du Brésil (ABC / MRE), UFLA et gouvernement de la RDC
Agence d'implémentation
Du côté brésilien: UFLA
Du côté congolais: ULPGL, INERA, Université de Kinshasa (UNIKIN), Ministère de l'Agriculture et ONG Women's Solidarity
Informations supplémentaires sur la solution:
Détails du contact:
Brésil
Université fédérale de Lavras, Département d'ingénierie (DEG / UFLA)
Gilmar Tavares
Professeur titulaire Extensionniste volontaire
Email: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Résumé:
En tant que l'une des nations les plus vulnérables au changement climatique, le Rwanda est pleinement conscient des défis qui l'attendent. Pour cette raison, le pays a créé un fonds d'investissement révolutionnaire pour soutenir les projets verts qui permettront au Rwanda de devenir une économie sobre en carbone et résiliente au changement climatique d'ici 2050. Le fonds a créé plus de 100 000 emplois et mobilisé environ 100 millions de dollars US. exemple majeur de financement climatique pour la réalisation des ODD.
Défi:
Enclavé au cœur de l'Afrique, le Rwanda ressemble à une version tropicale de la Suisse. Des montagnes coniques entourées de jungles équatoriales ont aidé à faire du Rwanda le surnom de «Le Pays des Mille Collines». Le pays, laissé en ruines après le génocide de 1994, s'est rapidement reconstruit. Les Rwandais ont utilisé efficacement l'aide au développement et ont laissé derrière eux les horribles souvenirs du génocide. Cependant, les terres fertiles et florissantes du Rwanda sont menacées. La population croissante - qui devrait doubler au cours des 20 prochaines années - exerce inévitablement des pressions sur le sol, les rivières et les forêts d'une économie essentiellement rurale. Ajoutant à cela sont les menaces du changement climatique. Toutes les estimations de l'impact du changement climatique suggèrent que l'Afrique sera la plus touchée. Les changements climatiques intensifient déjà les sécheresses et paralysent le secteur agricole vulnérable du continent. La réalité est que sans un environnement durable, les plans de développement économique au Rwanda risquent d'échouer. Cela a encouragé le gouvernement à considérer une priorité nationale.
Solution:
Le Rwanda s'est fixé une vision ambitieuse - et extrêmement nécessaire - de devenir une économie sobre en carbone et résiliente au changement climatique d'ici 2050.
Pour transformer cette vision en réalité, le pays a créé un fonds d'investissement révolutionnaire pour l'environnement et les changements climatiques. Localement connu sous le nom Fonerwa, ce fonds vert est rapidement devenu le plus grand de son genre en Afrique.
Le fonds investit dans des initiatives qui placent l'environnement et le changement climatique au centre du développement. Aujourd'hui, il soutient 35 projets qui aident à restaurer les bassins versants, à lutter contre l'érosion, à relier les familles hors réseau à l'énergie propre et bien plus encore.
En 2017, le fonds a franchi une étape importante: la création de plus de 100 000 emplois. La flexibilité du fonds permet la mise à disposition de ressources pour toutes sortes et tailles d'initiatives, et dans tous les secteurs de la société.
D'un système communautaire qui prélève l'eau de pluie sur les toits à une stratégie de gestion des déchets électroniques dirigée par le gouvernement, à des logements abordables zéro carbone et à une centrale hydroélectrique de 500 kW le long de la rivière Gaseke.
Le fonds est ouvert aux candidatures deux fois par an. Un comité évalue toutes les propositions soumises au moyen d'un processus rigoureux et transparent. Les projets doivent montrer leur potentiel pour contribuer à l'ambition de développement durable du pays.
Le fonds a mobilisé environ 100 millions de dollars US à ce jour. La plus grande partie de ce financement provient des sources de revenus du gouvernement central - y compris de l'évaluation des impacts environnementaux, des amendes et des frais - ce qui rend le fonds moins volatil face aux chocs de l'aide extérieure.
La communauté internationale et le secteur privé contribuent également à la capitalisation du fonds. Le fonds vert du Rwanda est un exemple majeur de l'impact qu'un financement climatique bien géré peut avoir.
Le Malawi suit déjà les traces du Rwanda, et la Tanzanie et la Zambie ont également manifesté leur intérêt pour l'établissement de fonds verts dans leurs pays, inspirés par cette expérience réussie. Le Rwanda vient peut-être de semer les graines pour que l'Afrique devienne plus verte.
Supporté par:
PNUD, Institut mondial de la croissance verte, Fonds vert pour le climat, UK DFID, Banque de développement du Rwanda, GIZ
Agence d'exécution:
N / A
Détails du contact:
Fonds vert du Rwanda (FONERWA)
Alex Mulisa
Coordinateur
Email: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Résumé:
En tant que l'une des nations les plus vulnérables au changement climatique, le Rwanda est pleinement conscient des défis qui l'attendent. Pour cette raison, le pays a créé un fonds d'investissement révolutionnaire pour soutenir les projets verts qui permettront au Rwanda de devenir une économie sobre en carbone et résiliente au changement climatique d'ici 2050. Le fonds a créé plus de 100 000 emplois et mobilisé environ 100 millions de dollars US. exemple majeur de financement climatique pour la réalisation des ODD.
Défi:
Enclavé au cœur de l'Afrique, le Rwanda ressemble à une version tropicale de la Suisse. Des montagnes coniques entourées de jungles équatoriales ont aidé à faire du Rwanda le surnom de «Le Pays des Mille Collines». Le pays, laissé en ruines après le génocide de 1994, s'est rapidement reconstruit. Les Rwandais ont utilisé efficacement l'aide au développement et ont laissé derrière eux les horribles souvenirs du génocide. Cependant, les terres fertiles et florissantes du Rwanda sont menacées. La population croissante - qui devrait doubler au cours des 20 prochaines années - exerce inévitablement des pressions sur le sol, les rivières et les forêts d'une économie essentiellement rurale. Ajoutant à cela sont les menaces du changement climatique. Toutes les estimations de l'impact du changement climatique suggèrent que l'Afrique sera la plus touchée. Les changements climatiques intensifient déjà les sécheresses et paralysent le secteur agricole vulnérable du continent. La réalité est que sans un environnement durable, les plans de développement économique au Rwanda risquent d'échouer. Cela a encouragé le gouvernement à considérer une priorité nationale.
Solution:
Le Rwanda s'est fixé une vision ambitieuse - et extrêmement nécessaire - de devenir une économie sobre en carbone et résiliente au changement climatique d'ici 2050.
Pour transformer cette vision en réalité, le pays a créé un fonds d'investissement révolutionnaire pour l'environnement et les changements climatiques. Localement connu sous le nom Fonerwa, ce fonds vert est rapidement devenu le plus grand de son genre en Afrique.
Le fonds investit dans des initiatives qui placent l'environnement et le changement climatique au centre du développement. Aujourd'hui, il soutient 35 projets qui aident à restaurer les bassins versants, à lutter contre l'érosion, à relier les familles hors réseau à l'énergie propre et bien plus encore.
En 2017, le fonds a franchi une étape importante: la création de plus de 100 000 emplois. La flexibilité du fonds permet la mise à disposition de ressources pour toutes sortes et tailles d'initiatives, et dans tous les secteurs de la société.
D'un système communautaire qui prélève l'eau de pluie sur les toits à une stratégie de gestion des déchets électroniques dirigée par le gouvernement, à des logements abordables zéro carbone et à une centrale hydroélectrique de 500 kW le long de la rivière Gaseke.
Le fonds est ouvert aux candidatures deux fois par an. Un comité évalue toutes les propositions soumises au moyen d'un processus rigoureux et transparent. Les projets doivent montrer leur potentiel pour contribuer à l'ambition de développement durable du pays.
Le fonds a mobilisé environ 100 millions de dollars US à ce jour. La plus grande partie de ce financement provient des sources de revenus du gouvernement central - y compris de l'évaluation des impacts environnementaux, des amendes et des frais - ce qui rend le fonds moins volatil face aux chocs de l'aide extérieure.
La communauté internationale et le secteur privé contribuent également à la capitalisation du fonds. Le fonds vert du Rwanda est un exemple majeur de l'impact qu'un financement climatique bien géré peut avoir.
Le Malawi suit déjà les traces du Rwanda, et la Tanzanie et la Zambie ont également manifesté leur intérêt pour l'établissement de fonds verts dans leurs pays, inspirés par cette expérience réussie. Le Rwanda vient peut-être de semer les graines pour que l'Afrique devienne plus verte.
Supporté par:
PNUD, Institut mondial de la croissance verte, Fonds vert pour le climat, UK DFID, Banque de développement du Rwanda, GIZ
Agence d'exécution:
N / A
Détails du contact:
Fonds vert du Rwanda (FONERWA)
Alex Mulisa
Coordinateur
Email: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
YouthConnekt se voit comme un animateur, à la fois physiquement et virtuellement, et comme un catalyseur de partenariats qui cherchent à libérer l'énorme potentiel des jeunes de tous les horizons de la vie. La plateforme donne à la jeunesse un siège à la table. Il relie les jeunes à des modèles, des ressources, des connaissances et des compétences, des stages et des opportunités d'emploi, leur permettant de participer à la construction d'un avenir meilleur pour eux-mêmes, le Rwanda et le monde en général.
Dans un monde de plus en plus mondialisé et numérisé, les jeunes sont souvent les principaux innovateurs. Ils doivent donc être dotés des compétences et des connaissances nécessaires pour tirer pleinement parti des opportunités que leur environnement immédiat offre pour le développement personnel et l'avancement de leurs communautés. De telles opportunités sont souvent déguisées en défis et il faut une attitude positive pour les transformer.
YouthConnekt est une plate-forme qui vise à créer un soutien entre pairs et à faciliter les interactions entre les jeunes et les organisations publiques, privées, de la société civile et internationales qui travaillent à promouvoir le développement civique et socio-économique des jeunes.
L'objectif global de YouthConnekt est de réduire le chômage chez les jeunes et de promouvoir la citoyenneté active. Il habilite les jeunes à travers la création d'emplois, les innovations TIC, le développement des compétences et l'engagement des citoyens. La plate-forme YouthConnekt permet aux jeunes femmes et hommes entre 16 et 30 ans de communiquer avec des leaders, des modèles, des pairs, des compétences et des ressources pour promouvoir l'emploi et l'entrepreneuriat.
YouthConnekt permet aux jeunes de participer à la construction d'un avenir meilleur pour eux-mêmes, le Rwanda et le monde en général.
Objectifs de YouthConnekt:
- 10 millions d'emplois d'ici 2020 dans des environnements de travail durables dans les industries émergentes
- 25 000 000 opportunités grâce à la formation et l'inscription sur les lieux de travail
- Identifier, nourrir et développer 1 million de leaders qui fournissent des solutions, participent au plaidoyer et deviennent des modèles dans leurs communautés
- Développer des initiatives et des politiques durables qui réduisent la parité entre les sexes dans l'éducation, l'emploi, la technologie et le leadership
- Connectez chaque école en Afrique et encouragez les ambassadeurs numériques à transférer des compétences à leurs communautés locales. Former un Hub de Hubs qui connecte tous les centres d'incubation à travers le continent.
PNUD, Ministère de la Jeunesse et des TIC au Rwanda
PNUD, Ministère de la Jeunesse et des TIC au Rwanda
Détails du contact:
PNUD Rwanda
Njoya Tikum
Conseiller régional anti-corruption
Email: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Problème: Veuillez spécifier le problème que les solutions doivent résoudre.
Les jeunes constituent aujourd'hui la majorité de la population mondiale. En 2015, un chiffre mondial de 1,2 milliard d'individus âgés de 15 à 24 ans représentait une personne sur six dans le monde. D'ici 2030, date butoir pour les objectifs de développement durable, le nombre de jeunes devrait avoir augmenté de 7%, pour atteindre près de 1,3 milliard. C'est en effet la plus grande cohorte de jeunes que le monde ait jamais vue.
Cependant, la majorité des jeunes vivant dans les pays en développement luttent pour satisfaire leurs besoins fondamentaux en termes d'éducation et de formation, d'emploi rémunéré et de moyens de subsistance durables, de services de santé, ainsi que de libertés civiles et de participation politique. Sans accès à ces besoins fondamentaux, les jeunes n'ont aucun moyen de grandir, d'établir des familles, de soutenir leur progéniture et de contribuer pleinement à la société.
Ces besoins sociaux, économiques et politiques sont fondamentaux pour améliorer la vie des jeunes, éradiquer la pauvreté et la faim et promouvoir le bien-être et des sociétés pacifiques plus inclusives. Le Programme d'action mondial pour la jeunesse (PAMJ) souligne clairement l'importance de ces questions sociales en tant que piliers fondamentaux d'un développement social solide et efficace des jeunes. Ces questions de développement social ont été reconnues et reconnues à maintes reprises par les gouvernements, ainsi que par les jeunes et les organisations dirigées par des jeunes, comme des défis importants auxquels sont confrontées les jeunes générations aujourd'hui. Par conséquent, la paix, la sécurité et le développement durable ne peuvent être atteints qu'en abordant les questions sociales, économiques et politiques qui touchent les jeunes de manière holistique et intégrée.
En 2016, Audacious Dreams Foundation (ADF), une organisation sociale en Inde, a mis au point un nouveau programme visant à inspirer, informer, engager, habiliter et habiliter les jeunes pour la compréhension globale et le développement durable à travers le volontariat.
VIP (Volunteer-Innovate-Participate) est un programme visant à promouvoir le volontariat des jeunes pour le développement de la nation et le développement durable en leur permettant de se responsabiliser ainsi que la communauté en faisant des innovations / contributions sociales. Le PAAC favorise l'apprentissage participatif par le bénévolat et encourage les jeunes de la communauté locale à participer au développement des compétences (soi-même) et au développement communautaire (à autrui) en entreprenant un programme de bénévolat structuré pouvant aller jusqu'à 500 heures par année.
Objectifs du projet
- Intégrer les jeunes dans le programme de développement pour l'après-2015 et contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable
- Offrir aux jeunes l'occasion de participer au processus de construction de la nation
- Pour acquérir les compétences, y compris les compétences fonctionnelles, les compétences de la vie et les compétences professionnelles
- Initier et participer à des projets d'apprentissage par le service
- Fournir un espace de travail pour que les jeunes puissent encadrer, exposer leurs compétences et les encadrer avec différents coachs de leadership
- Fournir une plateforme structurée et structurée pour que les femmes et les filles puissent s'autonomiser et participer à la communauté grâce à des initiatives de bénévolat
- Intégration du travail professionnel de jeunesse
Les jeunes participants contribuent à l'innovation sociale / volontaire pour la nation en fonction de leur intérêt et de leurs opportunités à travers:
- Autonomisation (avec le choix de toute activité de service ou de renforcement des compétences pour les améliorer (50%)
- Autonomisation communautaire (avec le choix de toute activité de volontariat qui profite à la société (50%).
Les participants prennent un projet diversifié en fonction des besoins de la communauté, y compris mais sans s'y limiter:
- Autonomiser les jeunes et les adolescentes par des compétences de vie
- Intégrer les jeunes dans la gouvernance locale
- Education à la citoyenneté civique et à la gouvernance participative des jeunes
- Sports pour le développement
- Promouvoir l'égalité des sexes et la santé des adolescents
- Plaidoyer
- Entreprise sociale
- Le renforcement des compétences
- Assurer une éducation et un enseignement de qualité dans les communautés marginalisées
- Développement de la jeunesse rurale
- Former et renforcer les groupes d'entraide féminins dans les zones rurales et marginalisées
- Volontariat dans les organisations de développement
- Renforcement des agences de jeunesse institutionnelles (conseils étudiants et académiques)
- comité de discipline, coordination du campus, etc.
Réalisations: À l'heure actuelle, le programme a permis à plus de 400 jeunes indiens d'acquérir des compétences en leadership, en relations interpersonnelles et en gestion de projets.
Partenaires: Le projet est mis en œuvre en collaboration avec des établissements d'enseignement indiens et des leaders communautaires.
Budget: 25 000 USD pour aider 1000 volontaires à participer au programme d'un an
Détails du contact:
Audacious Dreams Foundation
45, Karupuleeswarar nagar,
Goodanagaram Road, Gudiyattam 632602
Vellore Dt, Tamil Nadu Inde
Téléphone: +91 8883449369
Email: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
www.facebook.com/audaciousdreams
Plus d'images:
https://www.facebook.com/VIPVolontaires/
{galerie} sud-sud-monde / galeries / indiaaudaciousdreams {/ gallery}
À l'heure actuelle, l'Ouganda recrute chaque année plus de 30 000 nouveaux jeunes sur le marché du travail, et 64% d'entre eux sont au chômage, le taux le plus élevé de tous les temps. Une enquête sur la jeunesse ougandaise réalisée en 2016 a révélé que 74% des jeunes étaient susceptibles de subir des pots-de-vin en raison de la pauvreté; 54% ont dit qu'ils avaient le pouvoir d'influencer les changements; et environ 48% des jeunes aspirent à posséder des entreprises. Le désir des jeunes de s'engager dans l'entrepreneuriat et les discours politiques fournit une voie claire vers la réalisation des Objectifs de développement durable des Nations Unies et le Plan de développement national de l'Ouganda pour mettre fin à la pauvreté et améliorer la qualité de vie des Ougandais. Cependant, les jeunes ont des connaissances et un soutien limités sur la façon de participer pleinement à l'orientation du pays.
En 2017, Faraja Africa Foundation a conçu un programme spécial appelé Entrepreneurs sociaux et Leaders Fellowship (SELF) visant à combler les lacunes en matière de connaissances, notamment en matière d'entrepreneuriat social et de leadership auprès des étudiants universitaires du nord et du centre de l'Ouganda. programme d'entrepreneuriat qui développe des compétences sur la façon de démarrer, maintenir et développer des entreprises. Dans le même temps, il donne aux jeunes les compétences nécessaires pour participer de manière significative au discours politique du pays.
L'initiative est axée sur les jeunes âgés de 18 à 23 ans et fréquentant une université en Ouganda. D'où le choix de résoudre un problème en faisant en sorte que les diplômés alignent leurs connaissances, leurs compétences et leur engagement; tout en ayant une idée claire de changement social positif avec un bilan d'accomplissement qui démontre la viabilité de l'idée. En plus d'avoir une passion profonde pour résoudre le problème qu'ils abordent, et être coachable (embrasse la rétroaction honnête et les désirs d'améliorer).
L'initiative vise à atteindre trois objectifs spécifiques;
- Développer et évaluer un programme intégré de bourses en entrepreneuriat (discussions WhatsApp, programme d'entrepreneuriat, plaidoyer, participation politique) pour améliorer la qualité de vie des jeunes et leur capacité à participer de manière significative à la démocratisation de l'Ouganda;
- Évaluer la faisabilité, l'acceptabilité et l'efficacité du programme SELF pour accroître les possibilités d'emploi pour les jeunes.
- Mobiliser la connaissance des processus de mise en œuvre et l'efficacité des approches SELFdelivery.
Il renforce également le rôle des jeunes leaders dans la mobilisation communautaire, la gouvernance locale et le développement durable. Par conséquent, créer des créateurs d'emplois, des agents de changement communautaire et des éducateurs pour les pairs qui piloteront durablement le programme de développement non seulement de l'Ouganda, mais qui se reproduiront également auprès des autres jeunes et des pays africains.
La méthodologie mise en œuvre est basée sur trois E: Eduquer (informer et compétences), Empower (exposition et création d'opportunités pour démarrer avec le mentorat) et Engage (soutenir les initiatives communautaires et se connecter aux bons endroits / bureaux pour la durabilité).
À la fin de l'année 2017, 90 jeunes gens ont acquis l'entrepreneuriat social et des compétences en leadership pour créer, obtenir et conserver un emploi, lancer des initiatives commerciales / communautaires durables. De ce nombre, 25 jeunes ont reçu de petites subventions de 800 dollars pour lancer des entreprises sociales dans l'agriculture et les technologies de l'information. La campagne de plaidoyer amplifie les voix de plus de 9 millions de jeunes qui réclament un financement plus important des ressources pour l'alimentation des jeunes, lors de la 9e réunion des ministres de la Jeunesse du Commonwealth. L'initiative a également permis de renforcer facilement les capacités de leadership des parlementaires de six districts et de communiquer avec les 90 jeunes de leurs régions respectives, en particulier pour aborder les questions de l'emploi, des opportunités et de la participation des jeunes à la prise de décision. À la fin de l'année 2017, un camp international de jeunes, qui reliait les responsables de la jeunesse à d'autres acteurs de l'Afrique de l'Est, a organisé des discussions sur l'entrepreneuriat social et les efforts régionaux collectifs pour influencer nos communautés est-africaines.
Partenaires: La solution est mise en œuvre en partenariat avec le Parlement ougandais
Budget: 48 820 $
Détails du contact:
Emmanuel Wabwire,
Faraja Africa Foundation,
PO Box 7562, Chambres de la Reine,
Avenue parlementaire Kampala, Ouganda
Portable: +256772472724
Bureau Tel +256 (0) 39 488 4176
Email: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser., Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
http://ssda.southsouth.world/fr/ssda-blog-fr-fr/author/42-webadmin?start=84#sigProIdf9bd775a48