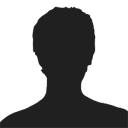Solutions SSDA
South-South Development Academy
Solutions SSDA
South-South Development Academy
Cartographier les solutions South-South Development Academy
Résumé
Dans le cadre du Mécanisme africain d'évaluation par les pairs (MAEP) de l’Union Africaine, un partage d’expérience s’est tenu au Benin avec le Mali et la Côte d’Ivoire afin d’échanger les bonnes pratiques et des acquis de l’utilisation du mécanisme.
Défi
Présenté comme « une approche novatrice conçue et mise en œuvre par les Africains pour l’Afrique », le mécanisme permet à des experts, aux gouvernements, à la société civile d’évaluer ensemble les performances d’un pays donné dans divers domaines (démocratie, bonne gouvernance, développement, droits de humains).
Créé en 2003, le Mécanisme africain d'évaluation par les pairs (MAEP) est un dispositif de contrôle réciproque visant à favoriser la bonne gouvernance en Afrique. Il s'agit d'un instrument établi d'un commun accord, auquel les États Membres de l'Union africaine (UA) adhèrent volontairement.
A travers le dialogue constructif et la persuasion, ce Mécanisme favorise le partage et l'apprentissage réciproque grâce aux échanges d'expériences et le renforcement des bonnes pratiques, y compris l'identification des lacunes et, pour les pays participants, l'évaluation des capacités à renforcer.
Au Bénin, une Commission Nationale de Gouvernance du MAEP (CNG-MAEP) a été mise en place en 2008 avec le but de renforcer la gouvernance politique, économique et sociale à travers l’éducation, la sensibilisation, la vulgarisation du Mécanisme Africain d’Evaluation par les Pairs (MAEP) et le suivi de la mise en œuvre du Plan d’actions et des recommandations issues de l’évaluation du Bénin dans le cadre du MAEP.
Solution
Les missions reçues au Bénin en Novembre 2016 avaient pour but de s’inspirer de l’expérience Béninoise de mise en œuvre du mécanisme dans ses phases d’autoévaluation, d’évaluation et de suivi de la mise en œuvre du plan national d’action. Le déplacement des membres de la Commission Nationales de Gouvernance du Mecanisme African d’evaluation par les pairs (CNG-MAEP) au Mali s’inscrit dans le cadre d’une rencontre faisant le point annuel de la mise en œuvre du MAEP et un renforcement des capacités de ces membres sur le contrôle citoyen. Les échangés de missions entre le Benin et les autres pays de la sous-région lui ont permis d’apprécier son propre niveau en matière de mise en œuvre du plan national d’action du MAEP, de s’enrichir des expériences des autres pays et de noter les domaines dans lesquels il doit mieux faire.
Soutenu par: PNUD
Implementé par: Commission Nationale de Gouvernance du Mecanisme African d’evaluation par les pairs (CNG-MAEP) (Bénin)
Contact:
Ginette Mondongou,
Économiste principal,
PNUD Bénin
Courriel: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Résumé
Mission d’appui au Ministère de la fonction publique du Burundi dans la mise en œuvre de l’archivage électronique des dossiers des fonctionnaires et agents de la fonction publique.
Défi
Le Burundi fait face au défi d’un secteur public et une administration insuffisamment robustes pour pouvoir rendre aux citoyens un service de qualité. L’introduction d’outils et de systèmes efficaces de gestion ont été identifiés comme un élément important pour améliorer les capacités et la performance de la fonction publique.
Solution
Entre août et septembre 2014 une mission d’assistance technique de deux experts du Ministère de la Fonction Publique du Burkina Faso s’est déroulée au profit du Ministère de la Fonction Publique du Travail et de la Sécurité Sociale du Burundi pour: (i) partager l’expérience burkinabaise en matière de digitalisation et de sécurisation des archives et (ii) aider le Burundi à développer une feuille de route en vue d'un archivage électronique des dossiers des agents publics de l'Etat dans un horizon de 5 ans.
Le résultat de la mission comprend une étude et une feuille de route sur les modalités de mise en œuvre de l'archivage électronique. Les recommandations visent à avancer dans l’automatisation de la gestion des ressources humaines de la Fonction Publique et dans l’amélioration de la qualité du service rendu au citoyen. Les études ont été validées par le Ministère de la Fonction Publique.
Soutenu par: PNUD
Implementé par: Ministère de la Fonction Publique, du travail et de la Protection Sociale Burkina Faso; Ministère de la Fonction Publique, du travail et de la Sécurité Sociale du Burundi
Contact:
Rose Nitunga
UNDP Burundi
Email: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Résumé
Mission d’appui d’experts initiés dans le cadre du processus de formulation des priorités de résilience/AGIR Sahel au Tchad.
Défi
L’Initiative AGIR « Alliance Globale pour les Initiatives de Résilience au Sahel et en Afrique de l’Ouest » a été lancée par les pays de l’Afrique de l’Ouest et du Sahel, organisés au sein de l’UEMOA, de la CEDEAO et du CILSS, en étroite collaboration avec les partenaires techniques et financiers de l’OCDE. L’objectif d’AGIR est: « Réduire structurellement et de manière durable la vulnérabilité alimentaire et nutritionnelle en apportant un appui technique, matériel et financier pour la mise en œuvre des politiques sahéliennes et ouest-africaines ».
Agir vise à mobiliser de façon coordonnée et à accompagner les politiques régionales et nationales en appui au renforcement de la résilience des populations vulnérables. Il s’agit d’aborder, dans une même démarche, les causes des crises alimentaires et nutritionnelles aiguës et chroniques, en aidant les ménages vulnérables à accroître leurs revenus, à accéder aux infrastructures et aux services sociaux de base, à constituer un patrimoine en renforçant durablement leurs moyens d’existence.
Pour le Niger, le processus AGIR est une opportunité pour renforcer sa dimension résilience de la stratégie de l’Initiative 3N « les Nigériens nourrissent les Nigériens ».
Solution
Dans le cadre de l’Alliance Globale pour l’Initiative Résilience dans le Sahel (AGIR), le PNUD a appuyé le déploiement des experts du programme 3N (les Nigériens nourrissent les Nigériens) du Niger au Tchad afin de renforcer l’échange d’expertise dans le processus de formulation des priorités nationales en matière de résilience.
La mission des experts Nigériens au Tchad a permis d’accélérer le processus AGIR (Alliance Globale pour l’initiative Résilience dans le Sahel) au Tchad notamment en ce qui concerne la définition des priorités, ainsi que les différents piliers de l’initiative. Les prochaines étapes planifiées incluant la visite de la partie tchadienne au Niger pour s’enrichir de l’expérience et le renforcement de la coopération entre ces deux pays dans le cadre de la résilience.
Soutenu par: PNUD
Implementé par: Niger: Haut Commissariat à l’initiative 3N
Contact:
Amata DIABATE
PNUD NIger
Email: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Résumé
Le Programme National Plateformes multifonctionnelles pour la lutte contre la pauvreté (PTFM) a suscité un partage d’expériences avec la Guinée qui a bénéficié de l’expertise en matière de micro industrialisation villageoise et de promotion de l'entreprenariat rural.
Défi
Le Programme national plateformes multifonctionnelles pour la lutte contre la pauvreté, en abrégé « PN-PTFM », est une initiative du Gouvernement Sénégalais, soutenue par le PNUD qui a pour objectif d’améliorer les conditions de vie des populations en milieu rural par un accroissement de l’accès aux services énergétiques de base.
Solution
Durant l’année 2014, le PTFM a suscité un partage d’expériences avec la Guinée qui a bénéficié de l’expertise en matière de micro industrialisation villageoise et de promotion de l'entreprenariat rural.
L'initiative a permis le renforcement de la coopération entre le Sénégal et la Guinée dans le domaine de la micro industrialisation villageoise. Il a été ainsi convenu que les experts du Sénégal se rendent en Guinée pour apporter un appui dans ce domaine, une fois que les restrictions liées au Ebola seront levées.
Soutenu par: PNUD
Implementé par: Ministère en charge de l’Industrie, -Ministère de l’Economie et des Finances
Contact:
Isiyaka SABO,
Conseiller économique,
PNUD Sénégal
Email: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Résumé
Les forces de police du Rwanda et de la Côte d'Ivoire partagent des expériences sur la manière d'appliquer les innovations en matière de TIC dans leurs projets Police et GBV, en utilisant de courts messages texte sur leur téléphone mobile pour résoudre les problèmes de GBV.
Défi
Le rapport 2015 d'ONU Femmes Beijing +20 indique que l'Afrique a la plus forte prévalence de violence physique ou sexuelle de la part d'un partenaire intime, soit 45,6% dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.
Les organes africains de sécurité ont pris des engagements fermes et des progrès considérables pour soutenir la lutte contre la violence à l'égard des femmes et des filles. Les organes de sécurité du Rwanda en partenariat avec One-UN Rwanda Le Rwanda a lancé la campagne à Kigali en octobre 2010 lors d’une conférence internationale de haut niveau sur le thème: «Le rôle des organes de sécurité africains dans la lutte contre la violence à l’égard des femmes et des filles». La conférence s'est terminée par la proclamation et la signature de la déclaration de la conférence internationale de Kigali (KICD).
En outre, depuis 2000, le Rwanda a adopté le concept de sécurité humaine, qui place l'individu au centre de l'analyse. Placer le citoyen au centre des préoccupations de sécurité, en particulier des personnes vulnérables, renforcera probablement la confiance des citoyens dans la police. En outre, le Rwanda a créé le Bureau pour la lutte contre la violence sexiste et le One Stop Centre, un centre médical pour les victimes de la violence sexiste. Il y a un bureau pour les questions de genre par commissariat, soit 74 de ce type au Rwanda. Le guichet unique accueille les victimes et leur propose, en plus des services de santé, un hébergement jusqu'à leur réintégration dans un environnement sûr. Il existe 30 centres uniques au Rwanda.
Le secteur de la sécurité en Côte d'Ivoire a été gravement touché par la décennie de crise sociopolitique et par la violente crise postélectorale de 2010. Le rétablissement de la sécurité et du pouvoir de l'État a donc été au premier plan des priorités du gouvernement ivoirien dans son programme post-crise. Par conséquent, le gouvernement et ses partenaires nationaux et internationaux ont déployé de nombreux efforts pour promouvoir la réconciliation à tous les niveaux et l'adoption d'un concept de sécurité centré sur la personne.
Solution
Dans le cadre de la mise en œuvre de la coopération Sud-Sud entre la Côte d'Ivoire et le Rwanda, une délégation ivoirienne conduite par les ministères d'État, de l'Intérieur et de la Sécurité et composée de représentants de la gendarmerie nationale, du Conseil de sécurité nationale, du Les services de police de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire ont effectué une visite de travail et d’échange au Rwanda en novembre 2014. L’objectif de cet échange était de partager les expériences en matière de mise en œuvre des politiques de sécurité et de cohésion sociale tout en mettant en exergue les meilleures pratiques et leçons apprises dans ce domaine.
Au cours de son séjour au Rwanda, la mission ivoirienne a rencontré tous les partenaires gouvernementaux (ministères ou institutions en charge de la sécurité, de la justice, de la solidarité, de la cohésion sociale, de la police, de la gendarmerie) et des organisations non gouvernementales nationales et internationales, ainsi que des agences des Nations Unies. participant à la mise en œuvre des politiques, programmes et projets du secteur de la sécurité.
Ces séances de travail ont permis de faire le point sur la situation en matière de sécurité et d'apprendre à appliquer les innovations en matière de TIC dans les projets Police et GBV, en utilisant des SMS pour les téléphones mobiles pour traiter les problèmes de GBV.
Soutenu par: PNUD
Mis en œuvre par: Ministère de l'Intérieur de Côte d'Ivoire; Police nationale rwandaise
Personne de contact: El Allassane Baguia, Unité politique et stratégie, PNUD-Côte d'Ivoire, Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Résumé
Deux experts du Secrétariat exécutif du Conseil national pour l'environnement et le développement durable (CNEDD) se sont rendus au Sénégal pour profiter de l'expérience du pays en matière d'assurance climat afin de développer un projet similaire au Niger
Défi
Les impacts négatifs du changement climatique sur les rendements agricoles et la situation de la sécurité alimentaire en Afrique sont préoccupants. Les réductions de rendement prévues dans certains pays pourraient atteindre 50% d'ici 2020 et les recettes nettes des cultures pourraient chuter de 90% d'ici 2100, les petits agriculteurs étant les plus gravement touchés. Les risques liés aux aléas climatiques et climatiques constituent des contraintes majeures pour les ruraux engagés dans des activités agricoles ou dont les moyens de subsistance dépendent fortement du secteur agricole.
L'article 4.8 de la CCNUCC mentionne "l'assurance" comme l'un des principaux moyens de réagir aux impacts négatifs du changement climatique (ainsi que le financement et le transfert de technologie). L'assurance peut en effet constituer un outil efficace pour la gestion des risques climatiques lorsqu'elle est associée à d'autres mesures telles que les systèmes d'alerte précoce, l'information sur les risques, la réduction des risques de catastrophe et l'adaptation au changement climatique.
Récemment, les produits de transfert de risque indexés tels que l'assurance indicielle sont apparus comme un mécanisme potentiellement efficace de transfert de risque climatique pour les populations rurales. L'assurance est liée à un indice, souvent météorologique, tel que les précipitations, la température, l'humidité ou les rendements, plutôt que les pertes réelles.
Solution
Deux experts du Secrétariat exécutif du Conseil national pour l'environnement et le développement durable (CNEDD) se sont rendus au Sénégal pour profiter de l'expérience du pays en matière d'assurance climat afin de développer un projet similaire au Niger.
Avec ce voyage d'étude, les gestionnaires nigérians ont mieux compris les méthodes utilisées au Sénégal par le projet d'assurance indicielle pour l'agriculture afin d'identifier et de sélectionner des sites d'intervention et de collecter des données de base. Grâce aux enseignements tirés, le Niger a mieux préparé son indice d'assurance climatique contre la sécheresse, en adoptant une méthodologie similaire pour identifier les sites de mise en œuvre des projets et de meilleures méthodes de collecte de données.
Soutenu par: PNUD
Mis en œuvre par: Secrétariat exécutif du Conseil national pour l'environnement et le développement durable (CNEDD)
Personne de contact: Amata DIABATE, conseillère économique, PNUD Niger, Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Résumé
Un accord de coopération entre les gouvernements du Burundi et de Singapour, avec l'appui du PNUD, a été signé pour un montant de près de 2,5 millions de dollars. Cette coopération Sud-Sud est axée sur la réalisation d’un plan directeur novateur visant à guider le développement de la capitale du Burundi et de ses environs d’ici 2045.
Défi
La ville de Bujumbura en tant que capitale politique, sociale et économique du Burundi a un réel potentiel de développement. Cependant, son développement urbain futur se heurte à de véritables défis: aujourd'hui, bien qu'un Burundais sur dix seulement soit urbain, la ville de Bujumbura abrite à elle seule les trois quarts de la population urbaine du pays. En 1962, la capitale comptait environ 60 000 habitants. En 2014, les estimations sont de 800 000 habitants. Cette population est principalement concentrée dans les districts périphériques où la densité atteint parfois plus de 2 000 habitants par km². Selon la Banque africaine de développement (BAD), il est prévu que, d'ici 2030, la population urbaine du Burundi atteindra 2,63 millions d'habitants, ce qui représenterait 19% de la population totale.
Cette urbanisation rapide et continue, en particulier dans la ville de Bujumbura, entraîne une dégradation de la qualité de la vie des citoyens et de l'environnement. Au-delà de la croissance démographique, le développement de Bujumbura est confronté à d'autres défis tels que: le manque d'outils de planification et de gestion urbaine; législation inadéquate; faible revenu des ménages par rapport au coût du logement; le manque d'énergie électrique; l'exode rural des jeunes.
Le défi actuel est de pouvoir gérer le développement de la capitale et de garantir un meilleur cadre de vie et de travail à ses habitants.
Solution
Le soutien de Singapour combinait la fourniture d'un large éventail de connaissances techniques fondées sur l'expérience aux niveaux national et provincial. L’assistance technique, les services de conseil et le partage des pratiques optimales constituaient le cœur de ce mécanisme de coopération Sud-Sud avec Singapour.
En vertu de cet accord, le SCE a mis à profit l'expérience et l'expertise de Singapour en matière de développement urbain avec la ville capitale de Bujumbura. Le projet a démarré en juillet 2014 et durait 18 mois. Il comprendrait 12 mois de préparation du plan directeur et 6 mois de renforcement des capacités. SCE effectuerait le transfert des connaissances sur les meilleures pratiques en matière de développement urbain avec l'équipe de planification urbaine du gouvernement burundais afin de mener à bien le plan directeur.
Soutenu par: PNUD
Mis en œuvre par: Singapore Cooperation Enterprise (SCE)
Personne de contact: Charles NIZIGIMANA (au ministère) - email: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. ; Marie-Ange KIGEME (PNUD) email: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Résumé
Mission d'expert de haut niveau et activités de partage d'expériences entre Maurice et la Côte d'Ivoire pour aider le gouvernement de Côte d'Ivoire à élaborer un plan d'action opérationnel pour soutenir la création d'emplois pour les jeunes.
Défi
L'étendue du sous-emploi (20,9% de la population active en 2014) et du chômage des jeunes (9,6%) et des femmes (10% contre 4,8% chez les hommes) est un facteur clé qui explique la pauvreté persistante. Les opportunités d'emplois verts et de formation professionnelle pour les jeunes sont limitées en raison de la faible diversification économique et de la transformation insuffisante des produits de base. Il en va de même pour le développement des microentreprises, qui souffrent d'un manque de soutien technique et financier. Le chômage des jeunes, s'il n'est pas suffisamment pris en compte, pourrait également constituer un obstacle aux dynamiques de cohésion sociale et de consolidation de la paix.
Solution
Un spécialiste principal de l'emploi du ministère des Finances de Maurice a participé à une mission d'experts de haut niveau en décembre 2014 pour partager l'expérience du gouvernement mauricien avec le gouvernement de Côte d'Ivoire et contribuer à l'élaboration d'un plan d'action opérationnel visant à garantir des résultats tangibles et à renforcer la cohérence politiques et structures gouvernementales. À la suite de ce voyage d'étude, la Côte d'Ivoire a élaboré une politique de création d'emplois pour les jeunes qui a été mise en œuvre au niveau du président.
Soutenu par: PNUD
Mis en œuvre par: Ministère de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique
Personne de contact: El Allassane Baguia Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Résumé
Echange de coopération Sud-Sud avec le Maroc pour la mise en place de la Matrice de Comptabilité Sociale.
Défi
Renforcement des capacités statistiques et de comptabilité nationales.
Solution
Une Matrice de Comptabilité Sociale (MCS) est une matrice carrée dans laquelle chaque compte est représenté par une ligne et une colonne. Il fournit une image complète des transactions économiques d'une économie. La matrice fournit une cartographie aussi complète que possible de la circulation des flux économiques à l’intérieur de l’économie nationale. Elle sert de socle des modèles économiques qui vont être développés par le Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) afin d'analyser l'impact des politiques économiques.
La solution proposée a consisté en une activité de partage de connaissances qui s’est déroulée en juin 2014 entre experts statistiques du Haut Commissariat au Plan du Maroc et la Direction de la Prévision et de l’Analyse Economique de la Mauritanie.
Le partage a permis de donner aux décideurs la possibilité de mieux évaluer les politiques publiques et les ajuster pour les rendre plus efficientes et ce à travers la restructuration des données économiques. Le système a facilité la compréhension des interrelations entre les diverses parties du système macroéconomique.
Les principaux résultats atteints avec l’appui du Haut Commissariat au Plan du Maroc sont:
- Une matrice de comptabilité sociale détaillée pour l’économie mauritanienne sur la base du Système de Comptabilité Nationale 1993 (SCN 93) est produite
- Une méthodologie d’élaboration des MCS adaptée est élaborée et diffusée
- Les cadres du MEF sont formés à la méthodologie des MCS
Soutenu par: UNDP
Implementé par: Maroc: Haut Commissariat au Plan
Mauritanie: Ministère de l’Economie et des Finances, Direction de la Prévision et de l’Analyse Economique
Contact:
Oumar Gueye
Directeur de la Prévision et de l’Analyse Economique
Email: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Résumé
Echange d’expériences régionales sur la mise en place du cadre intégré-Une mission d’échange du Ministère du Commerce de la Guinée, de l’Unité de mise en œuvre du Cadre intégré a séjourné en décembre 2014 à Bamako au Mali pour s’enquérir de l’expérience Malienne dans la mise en œuvre du Cadre intégré.
Défi
Le Cadre Intégré Renforcé (CIR) réunit partenaires et ressources en vue d'aider les pays les moins avancés (PMA) à utiliser le commerce pour réduire la pauvreté et assurer une croissance inclusive et un développement durable. Le programme CIR apporte un appui visant à accroître le rôle du commerce dans le développement économique et social par une meilleure intégration du pays au marché régional, au système commercial multilatéral et lutter contre la pauvreté.
Solution
La mise en œuvre du programme Cadre intégré a commencé au Mali en 2005 avec l’appui du PNUD. Sur la base des acquis de la première phase, une seconde phase, le Programme de Développement des Capacités Commerciales (Cadre Intégré Renforcé) a été élaborée pour la période 2008-2012 puis prolongée jusqu’en 2017.
Il vise à appuyer le renforcement des capacités liées à l’intégration du Mali au Système Commercial Multilatéral. principalement dan la filière de production des mangues. Trois résultats majeurs sont ainsi attendus : (i) le développement des capacités liées au commerce, (ii) le renforcement de l’Unité de mise en œuvre du Cadre Intégré et (iii) la facilitation de la promotion des exportations.
Une mission d’échange du Ministère du Commerce de la Guinée, de l’Unité de mise en œuvre du Cadre intégré a séjourné en décembre 2014 à Bamako au Mali pour s’enquérir de l’expérience Malienne dans la mise en œuvre du Cadre intégré. La mission a rencontré les structures du gouvernement, du secteur privé et des partenaires pour s‘enquérir du diapositif institutionnel, organisationnel et des résultats obtenus.
Soutenu par: UNDP, CIR
Implementé par: Mali : Ministère du Commerce/ Direction Nationale du Commerce et de la Concurrence
Contact:
Bécaye Diarra,
Conseiller en économie et chef de l’unité stratégique et politique,
Programme des Nations Unies pour le développement, bureau au Mali
Courriel: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Résumé
Grâce à un partenariat entre l'observatoire national du développement humain au Maroc et l'observatoire national du développement humain durable et de la réduction de la pauvreté au Mali, une série d'échanges et d'activités de renforcement des capacités ont eu lieu entre les deux institutions.
Défi
Sous la supervision du Ministère du développement social, de la solidarité et des personnes âgées (MDSSPA), l'Observatoire national du développement humain durable et de la réduction de la pauvreté au Mali (ODHD / LCP) a pour mission principale d'entreprendre des études et des recherches dans les domaines suivants: développement humain durable et lutte contre la pauvreté. La solution cherche à adresser le système d’information et les capacités d’analyse et d’évaluation des politiques publiques pour améliorer la prise de décision et, à terme, la bonne gouvernance. Plus précisément, il vise à consolider une culture de politique publique, de mesure du rendement, ainsi que de transparence et de responsabilité.
Solution
En juin 2014, l'ODHD / LCP du Mali a participé à la conférence internationale sur les méthodes de mesure du développement humain et des approches d'évaluation axées sur l'équité. Le directeur de l'ODHD a présenté le processus d'élaboration de l'indice de pauvreté des communes du Mali.
Un accord de partenariat a été conclu entre des observatoires au Maroc et au Mali.
Dans le cadre de ce partenariat Sud-Sud, l'Observatoire national du développement humain du Maroc (ONDH) a reçu une délégation malienne composée de hauts fonctionnaires du gouvernement du Mali et d'experts en août 2017. À la suite de plusieurs participations du Mali aux forums et séminaires organisés de l’ONDH, l’Observatoire national du développement humain durable et de la lutte contre la pauvreté au Mali (ODHD / LCP) a sollicité l’appui de l’ONDH pour renforcer ses capacités dans deux domaines: les systèmes d’information et le développement humain.
Appuyé par: PNUD, UNICEF, UNFPA, UNWOMEN
Mis en œuvre par: Mali: Observatoire du développement humain durable et de la lutte contre la pauvreté (ODHD / LCP); Maroc: Observatoire National du Développement Humain (ONDH)
Personne de contact: Bécaye Diarra, conseillère en économie et chef de l'unité des politiques et des politiques, Programme des Nations Unies pour le développement, bureau au Mali, Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Résumé
Le parc national Oti-Kéran (OKM), autrefois bien développé, situé dans le nord du Togo, a connu un déclin important de ses infrastructures et a perdu la majeure partie de sa faune et de sa flore. Le projet vise à renforcer la gestion du système d'aires protégées au Togo, en améliorant la contribution à la conservation de la biodiversité par le biais d'approches efficaces de la réhabilitation et de la gestion des aires protégées. Compte tenu du caractère transfrontalier du parc, cette initiative aide le Togo à créer les conditions préalables pour pouvoir rejoindre dans les années à venir l’initiative pour la conservation de la biodiversité (complexe W-Arly-Pendjari qui était bien relié au réseau togolais). OKM) dirigé par le Burkina Faso, le Bénin et le Niger.
Défi
Le système d'aires protégées du Togo est confronté à de graves problèmes de dégradation des infrastructures, de mauvaise gestion, de pénurie de personnel et de cadres juridiques et politiques inadéquats. Dans le complexe Oti-Kéran-Mandouri, situé au nord du pays et voisin du Burkina Faso et du Bénin, la faune et la flore ont largement disparu et menacent la biodiversité à l'échelle régionale.
Ce déclin reflète un déclin général de la situation sociopolitique du pays depuis les années 90. Malgré son bon emplacement à côté d'un couloir transfrontalier de migration d'éléphants et de mammifères, cette situation a également entraîné un blocage complet du secteur de l'écotourisme et contraint les communautés locales à exploiter la zone protégée pour gagner leur vie.
Solution
Lancé en 2012, le projet vise à renforcer la gestion du système d'aires protégées au Togo,
améliorer la contribution à la conservation de la biodiversité par des approches efficaces de réhabilitation et de gestion des aires protégées. Compte tenu de la nature transfrontalière du parc, cette initiative aide le Togo à créer les conditions préalables pour pouvoir adhérer dans les années à venir à l'initiative pour la conservation de la biodiversité menée par le Burkina Faso, le Bénin et le Niger en partenariat avec l'UE, l'UEMOA et le PNUD. .
Appuyé par: PNUD, UEMOA, Fonds pour l'environnement mondial
Mis en œuvre par: PNUD
Personne de contact: Ginette MONDOUGOU CAMARA, conseillère économique, PNUD Togo, Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.