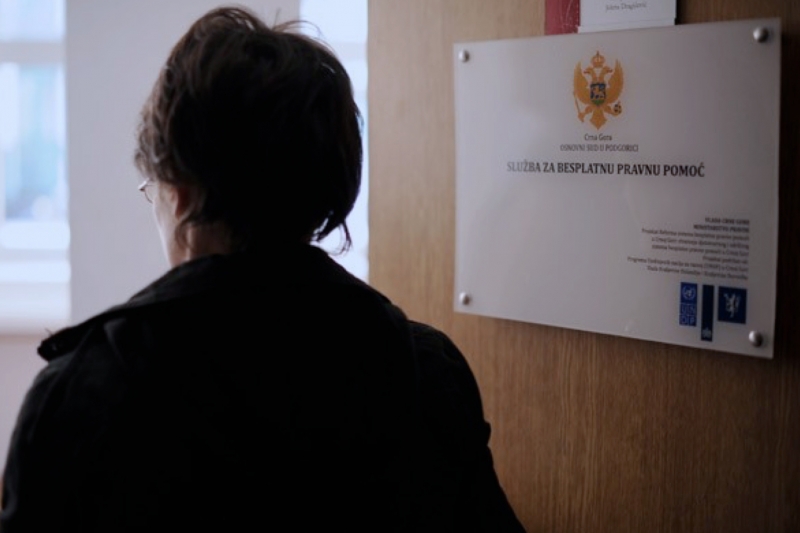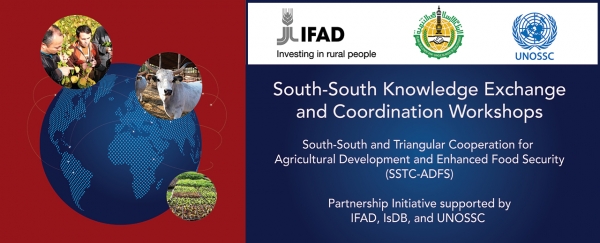Solutions SSDA
South-South Development Academy
Solutions SSDA
South-South Development Academy
Blog
Visites d'échange effectuées en 2011 et 2012 entre la Chambre de Commerce et d'Industrie de Madagascar et le Centre d'Arbitrage, de Médiation et de Conciliation de Ouagadougou (CAMC-O) du Burkina Faso dans le but de mettre en place un centre d'arbitrage et de médiation soutenu par une structure durable à Madagascar. L'initiative vise à contribuer au renforcement de la compétitivité des entreprises à Madagascar à travers l'amélioration du climat des affaires, notamment en ce qui concerne l'exécution des contrats commerciaux et l'adoption de modes alternatifs de résolution des conflits (ADR) dans le pays.
Défi:
Classé parmi les pays les moins développés, Madagascar est reconnu pour son fort potentiel, notamment en ressources naturelles, qui ne peut malheureusement pas inverser la courbe de l'appauvrissement. En moyenne, la croissance économique (2,3% en moyenne entre 2010 et 2015) reste nettement inférieure à la croissance démographique (2,8% en moyenne) et reflète une baisse du revenu par habitant de la population et un taux de pauvreté supérieur à 80%.
Aussi, la mise en place d'un cadre favorable à la promotion du secteur privé, dans son rôle de créateur de richesse, a toujours été au cœur des différentes stratégies successives mises en œuvre à Madagascar.
Concernant l'amélioration de l'exécution des contrats commerciaux en particulier, un Centre d'arbitrage et de médiation a été créé à Madagascar (CAMM) en 2000, sous la forme d'une association privée. Le centre a pu bénéficier du soutien de certains partenaires techniques et financiers. Si le CAMM avait le mérite d'exister, en tant que centre d'arbitrage recherché et souhaité par le monde des affaires et le secteur privé, il reste que le recours au centre a été limité: a Une douzaine de cas d'arbitrage et de médiation ont été réglés par le CAMM depuis sa création - et le centre n'était pratiquement plus opérationnel en 2011. Cependant, une étude réalisée la même année avec des entreprises locales a montré que 65% d'entre eux ont une perception positive de médiation et d'arbitrage, 70% considèrent leur impact positif 53% sont prêts à prévoir une clause de médiation et / ou d'arbitrage dans leur contrat.
Le défi est donc de relancer les modes alternatifs de commerce à Madagascar, en tirant des leçons du passé pour assurer la pérennité de la prestation de services.
Répondre à la nécessité de renforcer la gouvernance et le fonctionnement de l'entrepreneuriat et du climat des affaires à travers la prévention et la résolution des conflits commerciaux. L'objectif est d'encourager la recherche de solutions amiables aux litiges nés ou en cours de médiation et d'arbitrage à travers un mécanisme de règlement des litiges et des litiges entre parties avec l'intervention d'un tiers, l'arbitre (ou plusieurs arbitres).
Solution:
Afin de relever le défi de relancer les MARC, mais surtout leur durabilité, l'importance de soutenir l'entité promotrice vers une structure durable, menée par le secteur privé (utilisateur principal) a été privilégiée.
Des études et des consultations ont identifié la Chambre de commerce et d'industrie de Antananarivo (CCIA) comme une institution potentielle pour amener le nouveau CAMM, comme plusieurs expériences réussies ailleurs.
Afin d'assurer la pleine appropriation de la vision et de l'approche du secteur privé, le PNUD a soutenu l'organisation d'un séjour d'initiation et de formation pour les représentants de haut niveau du CCIA au Centre. Médiation et Arbitrage de Paris (CAMP) et le Centre d'Arbitrage, de Médiation et de Conciliation de Ouagadougou (CMAC-O).
La solution de coopération Sud-Sud adoptée consiste en une série de voyages d'échange en 2011 et 2012 dans le but de préparer les dirigeants de la CCIA et le secteur privé en général à s'approprier pleinement le concept et le rôle qu'ils vont jouer. jouer dans la nouvelle configuration du CAMM pour donner plus de profondeur à la médiation et à l'arbitrage à Madagascar.
A la fin de la mission, un groupe de travail composé par les missionnaires a été mis en place pour piloter la revitalisation du CAMM soutenu par la CCIA.
Le groupe a supervisé l'examen de la constitution et des statuts du CAMM, le recrutement d'un nouveau SG ainsi que le renforcement de ses capacités au sein du CMAP et du CAMC-O, et la formation de médiateurs pour le centre (un pool d'arbitres ayant été hérité de l'ancien CAMM).
Le CAMM soutenu par la CCIA est opérationnel depuis 2012. En 2013, il a initié le réseau «Business Bridge OI», qui regroupe les centres de gestion des conflits commerciaux des îles de l'océan Indien, afin de faciliter les relations commerciales entre ces centres. dernier.
Pays fournisseur: Burkina Faso
Soutenu par: PNUD
Agence d'exécution: Chambre de commerce et d'industrie d'Antananarivo
Contact:
PNUD Madagascar
Hasina Ramarson
Agent de programme, Réduction de la pauvreté / Secteur privé
Email: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
{Gallery} sud-sud-monde / galeries / Madagascar-abitration {/ gallery}
Plusieurs districts autour des rives tanzaniennes du lac Victoria souffrent gravement de la surpêche et de la détérioration des écosystèmes du lac. Les autorités gouvernementales locales pilotent les techniques de pisciculture et les intègrent dans les plans de développement des districts et les plans d'investissement dans la pêche pour relever ce défi. Soutenu par le PNUD, le programme comprend également des études préalables pour évaluer la faisabilité des interventions planifiées, la mise en place de sites de démonstration et la formation de groupements piscicoles. Des visites d'apprentissage dans les pays voisins, des formations et des analyses coûts-avantages à des fins de plaidoyer permettent d'intensifier les interventions.
Défi:
Le lac Victoria, le plus grand lac du continent africain, se situe entre la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya. Environ 35 millions de personnes dépendent de ses eaux pour leur subsistance. Initialement connue comme une ressource riche en poissons endémiques, la surpêche dans la seconde moitié du XXe siècle, combinée à la pollution et à l'introduction d'espèces non indigènes, a entraîné une détérioration rapide de ses écosystèmes.
Solution:
Sur la base des recommandations d'une étude PNUD-ONU Environnement-Pauvreté-Environnement 2014 (PEI) identifiant les goulots d'étranglement institutionnel, juridique et financier pour la mise en œuvre d'une durabilité environnementale favorable aux pauvres, le district de Bunda a inclus en 2015 des mesures pour améliorer la pisciculture durable. plan de développement. Le District a également élaboré un plan d'investissement décrivant comment financer la mise en œuvre du plan de développement du district. Une autre étude commandée récemment par l'Î.-P.-É. (2016) sur l'analyse coûts-avantages (ACA) des entreprises axées sur la nature qui ont confirmé que la pisciculture était une entreprise hautement viable sur le plan environnemental, social et économique.
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan, le District a identifié des champions locaux tels que les agriculteurs progressistes et le Service National et a facilité la formation de 14 groupes piscicoles (312 membres au total dont 40% de femmes) dans le but de renforcer capacités locales et améliorer la productivité et les options de financement. En 2015, deux des groupes ont demandé et reçu des prêts de 6 200 $ combinés de Twiga Bancorp pour lancer la pisciculture en cage, une option de pêche plus durable que les pratiques actuelles.
En mars et décembre 2014, différentes missions d'apprentissage ont eu lieu entre des institutions de Tanzanie et d'Ouganda / Kenya. Ces échanges de connaissances ont permis d'étudier la gestion et la technologie pour la pisciculture avec un accent particulier sur les techniques de pisciculture entre les principales parties prenantes impliquées dans la pisciculture en Tanzanie, en Ouganda et au Kenya. Cela inclut les officiels du district ainsi que les champions locaux et les institutions de recherche.
Suite à ces échanges, à l'identification des champions locaux et à la formation des groupements piscicoles, les agriculteurs ont été formés à l'exploitation des étangs piscicoles et aux techniques d'élevage du poisson. En outre, un site de démonstration a été établi au Service national, où une formation sur place est dispensée aux pisciculteurs locaux, aux groupes de femmes et aux unités de gestion des plages. Le Service national a également construit une écloserie pour la production d'alevins, ce qui a permis de réduire le coût et d'améliorer la qualité et l'approvisionnement constant en fingerlings.
Après le pilotage des pratiques de pisciculture durable, le gouvernement et le secteur privé ont pris des mesures pour intensifier la pisciculture en cage en Tanzanie. Jusqu'à présent, 9 entreprises privées ont été autorisées à pratiquer la pisciculture en cage dans le lac Victoria et la version révisée de la politique nationale de la pêche de 2015 vise à promouvoir un environnement propice et favorable pour le secteur du poisson.
Calendrier de mise en œuvre: 2014-2016
Pays fournisseurs: Kenya et Ouganda
Soutenu par: PNUD
Agence d'exécution:
Mis en œuvre par le Conseil du district de Bunda en collaboration avec le Service national, le secteur privé, la Fondation de la recherche économique et sociale et le Ministère de l'élevage et de la pêche
Plus d'information:
Détails du contact:
Monsieur Ambrose Mugisha
Email: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Mme Kristina Weibel
Email: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Le PNUD Tanzanie a soutenu la création de sites de démonstration sur l'aquaponie et la culture hydroponique, une visite d'apprentissage au Kenya pour les principales parties prenantes et la formation de paysans champions dans le but d'introduire la technologie en Tanzanie pour répondre aux défis de l'exploitation non durable des ressources naturelles et de l'empiètement des sources. . Basé sur les écosystèmes partagés du lac Victoria, l'expérience avancée au Kenya a fourni des leçons riches et des perspicacités aux pisciculteurs de prospection en Tanzanie.
Défi:
La population de 50 millions d'habitants en croissance rapide de la Tanzanie (dont 1,3 million vivant à Zanzibar) dépend fortement de l'environnement et des ressources naturelles pour sa subsistance. En particulier dans les zones rurales, des niveaux alarmants d'insécurité alimentaire persistent. L'exploitation non durable des ressources naturelles, l'empiétement des sources d'eau et la culture incontrôlée, associés à l'impact croissant des changements climatiques, compliquent le maintien des réalisations antérieures et la réalisation des ODD.
Surtout dans le lac Victoria, des décennies de surpêche et de pêche illégale ont épuisé la population de poissons auparavant extrêmement riche, dégradé les habitats de reproduction des poissons et diminué la biodiversité complexe du lac, menaçant ainsi les moyens de subsistance de millions de familles vivant du lac . En outre, la pisciculture a traditionnellement été une occupation dominée par les hommes et les femmes sont souvent exclues des chaînes de valeur de la pêche.
Solution:
Dans le cadre d'une initiative d'intégration de la pauvreté, de l'environnement et du genre, le PNUD en Tanzanie a facilité un voyage d'étude en 2015 au Kenya, un pionnier de l'aquaponie et de la technologie hydroponique en Afrique de l'Est.
10 acteurs clés (2 femmes et 8 hommes), dont des agriculteurs, des fonctionnaires de district et des représentants du Service national, du secteur privé et des instituts de recherche ont participé à la visite pour apprendre des agriculteurs kenyans et des éleveurs la technologie de fourrage hydroponique dans le but d'introduire la technologie en Tanzanie.
À leur retour, 31 agriculteurs supplémentaires (10 femmes et 21 hommes) dans la zone du lac ont été formés à l'aquaponie et trois sites de démonstration ont été établis dans la région côtière ainsi que des districts ruraux de Bunda et Bukoba autour de la technologie aquaponique. Ces sites de démonstration sont utilisés pour l'apprentissage sur site alors que d'autres agriculteurs dans les districts apprennent les nouvelles technologies qui permettront la production de poisson et de fourrage dans un système circulaire utilisant 90% moins d'eau que l'agriculture conventionnelle.
La technologie a été localisée en fonction de la situation locale. Par exemple, les systèmes adaptés localement ne sont pas automatisés et ne dépendent pas de l'électricité et la température et l'humidité à l'intérieur du système de fourrage hydroponique sont contrôlées uniquement à l'aide d'un hydro-net et d'un hydro-tissu. .
Le secteur privé a également manifesté son intérêt pour l'adoption de la technologie. Milkcom Farms, le producteur de produits Dar Fresh a installé le système de fourrage hydroponique dans son usine de Kigamboni à Dar es Salaam.
Pays fournisseur: Kenya
Soutenu par: PNUD
Agence d'exécution:
Un service national et des champions locaux avec le soutien de la Fondation de recherche économique et sociale
Plus d'information:
Smart Farming: Living Labs
Détails du contact:
Monsieur Ambrose Mugisha
Email: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Mme Kristina Weibel
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
{galerie} sud-sud-monde / galeries / tanzanie-aquaponie {/ galerie}
La Gambie, qui englobe les plus petits pays d'Afrique de l'Ouest, est confrontée à de graves problèmes de taux de pauvreté élevés (48,6%), d'insécurité alimentaire, de chômage des jeunes et de vulnérabilité au changement climatique. Afin d'explorer pleinement le potentiel du secteur agricole pour l'expansion économique, l'emploi et la production alimentaire, le gouvernement de la Gambie travaille avec le Centre Bénin Songhaï pour développer un système de formation agricole agricole et de formation des jeunes entrepreneurs. Cela permet d'accroître la productivité agricole, d'augmenter les revenus et de lutter contre l'insécurité alimentaire et le chômage des jeunes.
Défi:
La Gambie est une nation jeune avec plus de 60% de sa population de moins de 30 ans. Cependant, le chômage parmi les jeunes est le plus élevé (38,6% des jeunes sont pauvres) et reste un défi majeur. Le secteur agricole, secteur le plus critique pour l'expansion économique des pays, la production alimentaire et la réduction de la pauvreté, n'emploie que 20% des jeunes employés.
Solution:
Inspirée par le modèle Songhaï, modèle agricole agro-industriel, organique et autosuffisant, lancé au Bénin en 1985, la Gambie développe à la fois un système agricole aquacole fonctionnel et un système de formation des jeunes entrepreneurs. Conformément à la Vision 2016 adoptée par le Président, le projet met un accent particulier sur l'emploi des jeunes et la transformation agricole par le biais de l'ajout de valeur et de pratiques durables.
Le projet a été développé suite à une visite d'échange de connaissances des Ministères de la Jeunesse et de l'Agriculture de Gambie au Centre régional Songhai Bénin en 2014, permettant aux responsables d'étudier la stratégie de développement agricole durable intégré du centre pour la création d'emplois et la réduction de la pauvreté. Après l'approbation du rapport de mission par le cabinet et les recommandations pour une réplication de la stratégie de développement ont commencé en 2015. 29 jeunes gambiens ont réussi leur formation de six mois au Bénin et sont retournés en Gambie pour transférer leurs compétences.
La création d'une ferme mère à Chamen / Gambie a été supervisée par cinq techniciens du Bénin. Depuis août 2015, le centre est opérationnel et a formé 137 jeunes et inscrit actuellement 40 stagiaires (25 femmes et 15 hommes) comme cinquième groupe pour la troisième année en 2017. L'initiative Gambia Songhaï est entièrement organique et continue d'être gérée par les instructeurs étrangers et les instructeurs de la jeunesse formés au Bénin. Une équipe locale d'instructeurs est préparée par l'équipe technique du Bénin pour une éventuelle prise de contrôle.
Le centre exploite maintenant diverses activités liées à l'agriculture telles que le maraîchage, l'agroforesterie, la volaille témoin, la volaille en liberté, le bétail (moutons, chèvres et bovins), une usine d'aliments et travaille actuellement sur les étangs qui atteignent presque suffisance. Le centre a commencé à générer des fonds substantiels pour les activités ci-dessus qui sont déposées dans une banque pour utilisation une fois que le soutien externe devrait cesser.
Au cours des deux dernières années, le gouvernement de la Gambie a contribué de manière substantielle dans son budget national en tant que contribution de contrepartie au projet / initiative et a réaffirmé son fort engagement à poursuivre le développement de l'initiative.
Pays du fournisseur:
Centre régional de Songhai - Bénin
Supporté par:
Le gouvernement de la Gambie, le Programme des Nations Unies pour le développement, rejoint par l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture et le projet d'emploi des jeunes mis en œuvre par le Centre du commerce international financé par l'Union européenne.
Agence d'exécution:
Ministère de la jeunesse et des sports en collaboration avec le ministère de l'agriculture
Contact:
PNUD Gambie
Abdou Touray
Spécialiste du programme
Email: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
{gallery} sud-sud-monde / galleries / gambia-project {/ gallery}
Le parc national d'Oti-Kéran (OKM), autrefois bien développé dans le nord du Togo, a connu un déclin important des infrastructures et a perdu la majeure partie de sa faune et de sa flore. Le projet vise à renforcer la gestion du système d'aires protégées au Togo, en améliorant la contribution à la conservation de la biodiversité à travers des approches efficaces de réhabilitation et de gestion des aires protégées. Compte tenu de la nature transfrontalière du parc, l'initiative aide le Togo à développer des conditions préalables pour pouvoir rejoindre dans les prochaines années l'initiative pour la conservation de la biodiversité (complexe W-Arly-Pendjari qui était autrefois bien relié au Togo). Complexe OKM) dirigé par le Burkina Faso, le Bénin et le Niger.
Défi:
Le système d'aires protégées du Togo est confronté à de graves problèmes de déclin des infrastructures, de mauvaise gestion, de manque de personnel et de cadres juridiques et politiques inadéquats. Surtout dans le complexe d'Oti-Kéran-Mandouri, situé au nord du pays et à proximité du Burkina Faso et du Bénin, la faune et la flore ont largement disparu et menacent la biodiversité à l'échelle régionale.
Cette baisse reflète un déclin général de la situation sociopolitique des pays depuis les années 1990. En dépit de son bon emplacement à proximité d'un couloir de migration transfrontalière des éléphants et des mammifères, cette situation a également provoqué une paralysie complète du secteur de l'écotourisme et forcé les communautés locales à exploiter la zone protégée pour leur subsistance.
Solution:
Lancé en 2012, le projet vise à renforcer la gestion du système d'aires protégées au Togo, tout en améliorant la contribution à la conservation de la biodiversité à travers des approches efficaces de réhabilitation et de gestion des aires protégées. Compte tenu de la nature transfrontalière du parc, l'initiative aide le Togo à développer des conditions préalables pour participer dans les prochaines années à l'initiative de conservation de la biodiversité menée par le Burkina Faso, le Bénin et le Niger en partenariat avec l'UE, l'UEMOA et le PNUD .
Pays fournisseurs: Bénin, Burkina Faso, Niger
Soutenu par: PNUD, UEMOA, Fonds pour l'environnement mondial
Agence d'exécution: PNUD
Personne à contacter
PNUD Togo
Ginette Mondougou Camara
Conseiller économique
Email: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
{gallery} sud-sud-monde / galeries / togo-conservation {/ gallery}
Amel Association International (Amel) est une organisation non gouvernementale ONG fondée en 1979 par Dr.Kamel Mohanna au Liban. Active dans l'intervention d'urgence ainsi que dans les programmes de développement à long terme, Amel vise à soutenir les populations les plus vulnérables, qu'elles soient locales ou hébergées, en mettant en œuvre des activités accessibles en santé et psychologie, éducation, développement rural, sécurité alimentaire, protection, l'égalité des sexes et les droits de l'homme. Amel fournit les services à travers ses 24 centres, 2 unités d'enseignement mobiles, 1 unité mobile de protection et 6 cliniques mobiles réparties dans les zones les plus défavorisées du Liban.
Actuellement, AMEL travaille dans certaines des zones les plus proches des conflits, à proximité de la frontière syrienne. Historiquement, AMEL a toujours travaillé dans des domaines sensibles, par exemple, pendant l'occupation israélienne et la guerre civile libanaise, l'association travaillait dans des territoires qui étaient contestés par des milices politiques et sectaires rivales. AMEL a toujours été indépendant, plaçant l'être humain avant tout. Grâce à son expérience, AMEL a prouvé qu'une approche non sectaire est le moyen le plus efficace d'acquérir une paix et un apaisement durables. Une telle approche devrait faire partie d'une réponse globale aux défis actuels auxquels le monde arabe est confronté.
Pourquoi Amel est un centre d'excellence? Un institut établi de longue date, Amel sert de centre d'excellence pour la prestation de services de base et le renforcement des capacités des populations les plus vulnérables, y compris les réfugiés, à l'échelle nationale et régionale. Après plus de 38 années d'efforts continus et de dévouement, AMEL travaille toujours sur le terrain et a montré comment les ONG locales et nationales peuvent faire la différence et contribuer à atténuer les difficultés des communautés démunies et à autonomiser les individus sans discrimination. Le travail d'AMEL est extrêmement précieux pour le Liban, qui est non seulement un pays qui a souffert un conflit très long et violent entre 1975 et 1990, mais aussi un pays souffrant chroniquement de l'instabilité extérieure de ses voisins et où le rôle de l'Etat est faibles et services publics déficients. Amel, en tant que centre d'excellence, met en œuvre des initiatives, notamment en relation avec la recherche, l'innovation et l'apprentissage. Les hauts standards de conduite d'Amel, basés sur les principes humanitaires et en particulier l'humanité, la solidarité et la dignité, guident son intervention sur le terrain. Dans le secteur de la recherche, l'action d'Amel informe des publications clés liées au droit international humanitaire, droit à la santé, droit à l'éducation, entre autres sujets. Amel contribue également à diverses études, à travers ses antennes, notamment dans le secteur de la santé. En ce qui concerne l'innovation, Amel dispose d'un large éventail d'actions qui remodèlent les initiatives humanitaires et de développement traditionnelles, y compris les unités mobiles d'éducation, de protection et médicales. Le flux d'apprentissage est diffusé dans toutes les activités d'Amel à travers des processus réguliers de renforcement des capacités, de suivi, d'évaluation et de capitalisation, menés en partenariat avec des consultants externes et des universités.
Coopération internationale. AMEL promeut le renforcement de la coopération Sud-Nord à travers son partenariat avec Médecins du Monde sur les 3 décennies, mais aussi la coopération régionale, comme le projet en partenariat avec les Jeunes du Moyen-Orient organisant une formation sur la communication et les conflits la gestion, couplée à un échange culturel au Liban entre jeunes Libanais, Syriens et Palestiniens. AMEL est membre du Conseil Economique et Social des Nations Unies (ECOSOC), du Conseil International des Associations Volontaires et du Humanitarian Accountability Partnership, un vaste réseau d'ONG qui favorise une meilleure coordination de l'action humanitaire dans le monde entier. En 2017, Amel a été reconnu en tant qu'observateur à l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) et en tant que membre du Geneva Global Health Hub.
L'organisation dispose de bureaux en Suisse, aux États-Unis et en France pour reproduire son approche auprès des populations vulnérables en Europe. De plus, AMEL a été l'une des ONG les plus actives dans le dialogue sur la «refonte de l'action humanitaire» dans le cadre du processus préparatoire du Sommet Humanitaire Mondial qui s'est tenu en 2016. AMEL vise essentiellement à promouvoir un équilibre entre les acteurs internationaux et locaux. ONG travaillant au Liban ou dans d'autres parties du monde.
Réalisations
- 10 millions de services depuis sa création:
- 250 000 consultations par an (généralistes, pédiatres, gynécologues, psychologues, tests de laboratoire, spécialistes de base) dans les centres;
- 40 000 consultations par an avec nos unités médicales mobiles;
- 3 000 bénéficiaires du programme "Migrant Domestic Worker" depuis sa création en 2011;
- 10 000 bénéficiaires du programme «Youth Empowerment» depuis 2011;
- 3 000 bénéficiaires du programme «Women Empowerment» depuis 2011;
- 52 000 étudiants suivent le programme «Education des enfants» depuis 2011;
- 5000 étudiants inscrits aux formations professionnelles par an;
- 1 500 enfants suivront des programmes éducatifs d'ici la fin de 2017;
- 5000 enfants et parents inscrits au programme de protection par an;
- 450 enfants des rues soutenus individuellement en 2017;
- Capacité de mettre en place une réponse d'urgence en cas de crise migratoire.
Détails du contact:
Liban
Dr Kamel Mohanna, président
Téléphone: + 961 3 202 270
Email: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Site Web: www.amel.org
http://ssda.southsouth.world/fr/ssda-blog-fr-fr/author/42-webadmin?start=108#sigProId5cad485c13
De nombreux facteurs influent sur la productivité des colonies d'abeilles mellifères. Bien que certains de ces facteurs soient environnementaux et échappent au contrôle de l'apiculteur, certains d'entre eux peuvent encore être améliorés. Les apiculteurs peuvent augmenter la productivité en contrôlant la productivité de la colonie, la productivité individuelle des abeilles ouvrières et la synchronisation de l'activité de vol et du flux de miel.
Afin d'augmenter la productivité des colonies d'abeilles mellifères et permettre la production d'essaims naturels et l'élevage des reines, le professeur Muhsin Dogaroglu de Turquie a développé la solution innovante sur le système de gestion de soutien des colonies.
Le système de gestion de support de colonies est une méthode basée sur la mise en place de colonies de paires qui produisent du miel de chaque colonie dans chaque paire. De cette paire de colonie, on s'appelle le supporter et l'autre s'appelle le producteur. Les observations ont montré que les colonies productrices étaient capables de produire du miel plus que toute autre colonie habituelle dans toutes les conditions et que le système est capable d'augmenter la production totale de miel du rucher. En changeant les tâches au cours de la prochaine période de production de miel, la colonie de soutien devient la colonie productrice et la colonie productrice devient la colonie de soutien. Le système cible environ 75 000 abeilles dans les colonies de production et 50 000 abeilles dans les colonies de soutien au début du flux principal de nectar et ces chiffres sont inversés pour la fin de la saison. Le nombre de colonies dans le système dépend de la situation économique des apiculteurs et il est facultatif.
Le système est essentiellement basé sur l'amélioration de la productivité individuelle. Il vise à augmenter la production de couvain dans toutes les colonies du rucher 6 semaines avant les principaux flux de nectar. La couvée produite au cours de cette période augmentera le nombre de butineuses qui travailleront efficacement dans la production de miel pendant les principaux écoulements de nectar. Ces oeufs deviennent adultes après 3 semaines et les colonies sont divisées en deux parties, les partisans et les producteurs. Alors que deux groupes travaillent en équipe, se soutenant alternativement.
Les transferts de la couvée à la colonie de production devraient commencer 3 ou 4 semaines avant le flux principal de miel, et devraient être complétés 1 semaine avant le flux principal de nectar. Chaque semaine, 1 ou 2 cadres avec des couvées scellées de colonies de soutien sont transférés aux colonies de production. Lorsque les ruches de production commencent à produire du miel, les jeunes couvées sont transférées à la colonie de soutien pour réduire la consommation de miel. Les colonies de support peuvent être alimentées à la quantité requise.
Cette méthode donne d'excellents résultats, en particulier pour 2 écoulements de nectar principaux consécutifs (dont chacun dure en moyenne 3 semaines) ou des flux de nectar principaux plus longs. Traditionnellement, la production de couvain diminue après le premier flux principal de nectar, le nombre de consommateurs augmente dans les colonies, ce qui rend presque impossible l'accumulation de miel par les colonies. Dans le nouveau système, pour le prochain écoulement de miel, les colonies de support sont préparées comme colonies de production et cette fois les colonies de production de la période précédente les supportent en passant à la position de support. Ainsi, pour les deux flux de nectar, les colonies de soutien pourront survivre et récolter suffisamment de nectar et de pollen pour la production de couvain.
En conséquence, pour les producteurs de miellat, ce système permet d' augmenter la production 4 fois plus et fournit une production de miel garantie à partir de leurs colonies, surtout en automne.
La méthode a été testée avec succès par quelques centaines d'apiculteurs turcs. Les systèmes de gestion du soutien des colonies appliqués par les apiculteurs jouent un rôle efficace dans le maintien de l'augmentation de la taille et de la productivité des colonies, étant donné qu'elles sont appliquées de manière correcte. Des applications incorrectes peuvent entraîner une diminution de la production agricole et entraîner des pertes hivernales.
Budget de la solution : Le système n'a pas de coût supplémentaire pour les méthodes de production normales.
Détails du contact:
Dinde,
Tekirdag,
Professeur Dr. Muhsin Dogaroglu
Téléphone: +90 532 496 22 59
E-mail: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Au Kenya, on estime que seulement un tiers de la population a accès à de l'eau potable à proximité de leur domicile, à un prix abordable. Par conséquent, les enfants scolarisés doivent parcourir de longues distances (au moins 4 km) afin d'assurer l'approvisionnement en eau de leur famille avant / après l'école, causant l'absentéisme et entraînant des abandons scolaires.
En 2013, les membres de la International Transformation Foundation ont travaillé ensemble à un projet de recherche national sur un système d'eau potable durable. L'une des principales connaissances acquises est que toutes les communautés souhaitent améliorer leur système d'eau. Certaines communautés ne disposent d'aucun système d'eau potable, ce qui incite les enfants scolarisés et les femmes à parcourir de très longues distances pour s'approvisionner en eau auprès des puits / rivières des communautés avoisinantes. D'autres communautés, en particulier dans les zones urbaines, ont un petit nombre de robinets et voudraient augmenter ce nombre.
Le problème avec les projets d'eau en cours dans les communautés au Kenya sont:
- le système d'eau avec les composants techniques pour amener l'eau souterraine au robinet et
- le système payant qui décrit ce qu'il faut payer, comment entretenir le système et comment l'entreprise est établie; le système social.
C'est ainsi que l'on a créé un kiosque d'eau à l'école en tant qu'entreprise (primaire) scolaire, gérée par les élèves, vendant de l'eau potable aux résidents de la communauté. Dans ce contexte, l'organisation travaille avec les écoles communautaires pour mettre en place un kiosque d'eau sur place avec des produits spécialement conçus et durables pour que les enfants puissent transporter l'eau du robinet directement à l'école. Un kiosque d'eau à l'école est à la fois une activité éducative et rentable qui enseigne aux étudiants les compétences commerciales et entrepreneuriales. Il génère également des revenus indispensables pour les écoles.
Il offre une éducation pratique qui comble le fossé entre l'école et le travail et contribue au développement d'une communauté avec une école capable de subvenir à ses besoins sans dépendre de subventions tout en étant capable de s'offrir les meilleurs équipements et les meilleurs enseignants.
Depuis novembre 2014, l'ITF a construit 10 kiosques d'eau dans 10 écoles et communautés dans 4 comtés (Nairobi, Bungoma, Siaya et Homabay) à travers le Kenya.
Méthodologie utilisée: Un kiosque d'eau à l'école est installé dans une école située dans une communauté généralement pauvre et / ou rurale sans système d'eau potable. Dans une communauté, il s'agit de la principale source d'eau potable pour tous les ménages.
Un kiosque à eau à l'école se caractérise par les produits respectueux de l'environnement suivants, développés en partenariat avec Join the Pipe Foundation:
- Robinet d'eau économisant l'eau - Les stations d'eau ne fournissent pas seulement de l'eau potable mais économisent également de l'eau. Aucune eau n'est gaspillée avec notre robinet d'arrêt automatique. Ils sont également résistants au vandalisme.
- TAPS DE GOUTTES À GOUTTES Pour les installations de lavage des mains - Ils construisent des toilettes et des lavabos pour se laver les mains afin d'empêcher la propagation des maladies hydriques. La technologie des robinets d'égouttage réduit de 90% la consommation d'eau.
- Bouteilles d'eau - Elles fournissent des bouteilles d'eau réutilisables pour les enfants à boire.
- Jerry Carry Karts - Ces Jerry Carry Karts réduisent les blessures physiques causées par le soulèvement constant et le port de lourdes charges d'eau sur la tête des enfants.
En l'espace de 24 mois, l'école gagne assez d'argent en vendant de l'eau aux résidents de la communauté à un prix abordable et est en mesure de rembourser le coût d'installation qui est ensuite redéployé vers une école / communauté supplémentaire. Voici les activités réalisées (chronologiquement) dans la mise en place d'un kiosque d'eau à l'école:
- L'expression d'intérêt de l'école pour adopter un kiosque d'eau à l'école . L'expression est faite en remplissant un formulaire de demande documentant l'école; contexte communautaire et la situation de l'eau dans l'école et autour de la communauté.
- L'implication de la communauté et l' estimation des coûts. L'ITF, l'école et les résidents de la communauté travaillent ensemble pour estimer le coût d'installation dans le contexte des ressources communautaires. De cette façon, l'école sera en mesure de vendre de l'eau de manière rentable et de retourner le coût d'installation.
- Les sources de l'ITF pour le financement de la mise en place du kiosque.
- Accord juridiquement contraignant. Un accord est signé permettant à l'ITF de placer la gestion du kiosque auprès des résidents de l'école et de la communauté. Dans le cas où l'école viole les principes du kiosque, l'école est tenue responsable.
- Permis et licences: L'école demande et obtient des permis de construction de kiosque et de raccordement à l'eau et des licences connexes auprès de l'autorité compétente.
- Construction d'un kiosque et raccordement à l'eau: Un technicien de l'ITF, avec l'aide des habitants de la communauté, a installé le kiosque à l'école.
- Lancement du kiosque Le kiosque est ouvert au public après avoir formé les étudiants et les enseignants à la gestion des opérations quotidiennes du kiosque.
- Suivi et évaluation
Opérations et registres quotidiens: Un kiosque d'eau à l'école est géré par deux étudiants par jour avec deux rôles. On reçoit de l'argent et fait les registres du livre. L'autre est chargé d'aider les clients au robinet. Les registres du comptable comprennent l'heure, le nom de l'acheteur, la quantité achetée et le montant payé. Le comptable enregistre également toutes les dépenses éventuelles. À la fermeture de n'importe quel jour ouvrable, les deux opérateurs de kiosque signent et soumettent le livre des records à l'enseignant responsable.
Rapport hebdomadaire et mensuel: L'information est enregistrée tous les jours dans le livre des records est utilisé pour compiler un rapport hebdomadaire et mensuel préparé par les élèves avec l'aide d'un enseignant. Le rapport est envoyé à l'ITF et contient essentiellement des informations telles que le nombre d'étudiants et de non-étudiants qui ont utilisé le kiosque, la quantité d'eau achetée et l'argent dépensé, les noms et les coordonnées des étudiants qui gèrent le kiosque, etc.
Visite mensuelle du kiosque : Le coordinateur du projet ITF visite l'école / kiosque pour passer en revue les registres du livre au jour le jour.
Sondage auprès des utilisateurs : Cela se fait tous les trimestres pour obtenir les commentaires des utilisateurs.
Remboursement: L'école rembourse le coût d'installation sur une base mensuelle.
Réalisations:
- Ils ont construit 10 kiosques d'eau dans 10 écoles / communautés dans 4 comtés à travers le Kenya.
- 4815 écoliers n'ont plus besoin d'être absents de l'école pour se procurer de l'eau pour leurs familles. Ils ont également amélioré l'assainissement et la santé dans leurs écoles.
- À ce jour, 73087 personnes ont accès à de l'eau potable à un prix abordable dans leurs communautés.
Réplicabilité:
Les avantages multiples associés à un kiosque d'eau à l'école pour les élèves, les résidents de l'école et de la communauté comprennent:
Financièrement:
- Le premier projet de microcrédit pour les écoles avec un modèle d'entreprise durable, créant de l'argent pour les activités WASH à l'école.
- Un système de prêt remboursé qui permet le redéploiement des fonds vers d'autres écoles dans le besoin, réduisant ainsi le besoin de subventions et de dépendance.
Amélioration de l'assainissement et de la santé:
- Toutes les installations d'assainissement sont améliorées autour de l'école, l'argent du kiosque à eau est utilisé pour acheter du savon et du papier toilette pour les écoliers.
- Jerry carry karts réduit les blessures physiques causées par le soulèvement constant et le port de lourdes charges d'eau sur la tête des enfants.
Éducation et développement des capacités:
- L'augmentation de la fréquentation scolaire puisque les enfants n'ont plus besoin de s'absenter de l'école pour obtenir de l'eau pour leurs familles.
- Expérience de travail pour les étudiants grâce à la gestion du kiosque à eau. Ils apprennent le travail d'équipe, l'engagement, le leadership et la responsabilité.
Opportunité socio-économique
- Les enfants sont en mesure de transporter l'eau à leur domicile directement à l'école.
- Sécurité accrue car les enfants n'ont pas à se rendre dans des endroits éloignés et dangereux pour aller chercher de l'eau.
- Un kiosque scolaire permet d'économiser du temps et d'attendre dans les lignes à d'autres points d'eau.
Valeurs ajoutées environnementales:
- Fournir à la communauté de l'eau potable filtrée.
- Réduction de l'énorme quantité de déchets plastiques et d'émissions de CO 2 causée par la production et le transport de bouteilles d'eau et de récipients non durables.
- Nouvelle campagne en tant qu'ambassadeur fort pour l'accès à l'eau potable et à un meilleur assainissement dans les communautés rurales et pauvres.
Budget: L'installation d'un kiosque d'eau à l'école coûte entre 10 000 et 12 000 $.
Avec une école et une communauté prêtes à adopter un kiosque d'eau à l'école, voici les ressources minimales nécessaires pour installer le kiosque:
- Rejoignez les produits de tuyauterie:
-
- Source d'eau dans au moins 4kms de l'école
- Kiosque Construction de bâtiments Espace de 7X9 "à l'école
- Kiosque bâtiment matériaux de construction et technicien
- Robinet d'eau économisant l'eau
- Robinets d'égouttage
- Bouteilles rechargeables
- Jerry porte des karts
- Matériel de raccordement à l'eau (plomberie) et technicien
Détails du contact:
Kenya
M. Venuste Kubwimana - Secrétaire général de l'ITF
+254715799292
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
www.itfsecretariat.org
Le Maroc, comme les autres pays arabes, fait face à un approvisionnement en eau insuffisant pour l'irrigation et cherche à faire évoluer la gestion de l'irrigation pour maximiser la production agricole par unité d'eau consommée, c'est-à-dire la productivité de l'eau. Pour faire face à la pénurie d'eau, en 2011-2016, l'Institut national de la recherche agricole (INRA) a mis en place des pratiques d'irrigation déficitaire dans différentes régions du Maroc.
Les principaux objectifs de développement à long terme du projet sont de parvenir à une production agricole durable et rentable dans les zones arides d' Asie de l' Ouest et de l'Afrique du Nord (WANA) basée sur la gestion efficace et durable des ressources en eau rares. L'objectif principal de l'irrigation déficitaire est d'augmenter l'efficacité de l'utilisation de l'eau (WUE) d'une culture en éliminant les irrigations qui ont peu d'impact sur le rendement. La réduction du rendement qui en résulte peut être faible par rapport aux avantages obtenus en détournant l'eau économisée pour irriguer d'autres cultures pour lesquelles l'eau serait normalement insuffisante dans le cadre des pratiques d'irrigation traditionnelles.
L'approche du projet repose sur cinq principes: la participation, l'intégration, les complémentarités, les institutions multidisciplinaires et multi-institutions et l'analyse socio-économique.
Le projet a développé et testé, avec la participation de la communauté, des options de gestion de l'eau qui augmentent la productivité de l'eau et optimisent l'utilisation de l'eau, qui sont économiquement viables, socialement acceptables et écologiquement rationnelles.
Dans le site de référence du Maroc, des études de la réponse du blé, du maïs et du poivre à différents niveaux d'irrigation supplémentaire ont été menées et l'information a aidé à évaluer le compromis entre rendement et productivité de l'eau. Une réponse positive à l'augmentation du niveau d'eau a été observée.
Réalisations:
- Les régimes de l'azote et de l'eau ont eu des effets significatifs sur la biomasse totale et le rendement en grains;
- Amélioration du rendement des cultures (céréales);
- Réduction de 30% de l'utilisation de l'eau dans l'irrigation des céréales;
- Augmentation du revenu des agriculteurs et renforcement de la sécurité alimentaire;
- Le système d'irrigation déficitaire pourrait être étendu à plus grande échelle dans différentes zones arides et reproduit dans d'autres régions avec des conditions similaires.
Partenaires: Bureaux régionaux de développement agricole, Office national de la recherche agricole, Direction régionale de l'agriculture, Centre international de recherche agricole dans les zones sèches
Budget: environ 2000 USD / ha
Détails du contact:
INRA
Division scientifique
BP 415
Av.la victoire Rabat Maroc
Dr Rachid Moussadek, Chef du Département de l'environnement et des ressources naturelles
Téléphone: +212660199501
Email: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
La séparation d'un enfant de la famille et son placement en famille d'accueil ou en famille d'accueil est une expérience traumatisante et douloureuse, car elle conduit souvent à affaiblir ou rompre les liens avec les personnes extrêmement proches et significatives pour les enfants. Par conséquent, travailler avec les familles à risque de rupture est un domaine qui nécessite une attention accrue.
Le Bureau de l'UNICEF au Monténégro a établi un partenariat avec le bureau de l'UNICEF en Serbie afin de mettre en place au Monténégro un service de soutien familial et familial appelé Family Outreach Worker, initialement lancé en Serbie en 2013. Le service d'aide aux familles est une forme de visite à domicile.
- Empêcher le retrait de l'enfant de sa famille biologique et améliorer le fonctionnement de la famille biologique, réagir en temps opportun dans les situations à risque dans la famille en termes de prévention de la violence, de la négligence et des abus (familles apparentées et familles d'accueil) ont également été soutenus pour prévenir la rupture de la parenté ou du placement familial)
- Aider au processus de réintégration d'un enfant dans sa famille biologique, par exemple, un enfant qui a été temporairement placé dans un établissement ou d'autres formes de placement en famille d'accueil ou en famille d'accueil;
- Soutenir le système pour fournir une protection et un soutien adéquats à l'enfant et à la famille, ce qui sera dans le meilleur intérêt de l'enfant.
La coopération a impliqué des institutions publiques des deux pays et plus récemment une ONG du Monténégro qui fournit le service et a permis l'échange de savoir-faire et d'experts ainsi que la formation des professionnels du Monténégro par des professionnels de Serbie. Le service a été fourni (par intermittence) depuis 2014 dans un quart des municipalités du Monténégro. Initialement, il était financé par l'UNICEF, puis par le Ministère du travail et de la protection sociale. Le ministère s'est engagé dans la Stratégie sur la prévention et la projection des enfants contre la violence qu'il intégrera les services dans le système 2021.
Le service a couvert plus de 70 familles avec près de 180 enfants au cours de la période 2016-2017, a jusqu'à présent donné des résultats très positifs. Conformément à l'engagement du Monténégro en faveur de la désinstitutionnalisation, aucun enfant couvert par le service n'a été séparé de la famille biologique ou de la famille d'accueil jusqu'à présent.
Budget: Le coût est d'environ 90 euros par famille et par mois.
Partenaires: les bureaux de pays de l'UNICEF en Serbie et Monténégro, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale du Monténégro, les institutions en Serbie (Institut des affaires sociales, Maison "Zvecanska"), l'ONG Family Center Kotor
Détails du contact:
Organisation UNICEF Monténégro
Personne de contact: Mme Ida Ferdinandi
Adresse: Stanka Dragojevica bb, Podgorica
Site Web: www.unicef.org/montenegro
Adresse électronique: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Numéro de Téléphone: +38269303191
Nous sommes heureux d'annoncer les lauréats du premier concours mondial de sensibilisation aux solutions Youth4South visant à promouvoir l'Initiative de leadership des jeunes Sud-Sud dans la promotion du Programme de développement durable 2030.
L'égalité d'accès à la justice et la protection des droits de l'homme pour tous ses habitants, indépendamment de leur situation socio-économique, constituent un défi majeur pour le gouvernement du Monténégro. Les coûts des services juridiques restent inabordables pour la majorité des gens, en particulier ceux qui n'ont pas d'emploi, comme le montre l'information fournie par le ministère de la Justice. Selon certaines estimations, le coût du dépôt d'une plainte se situe entre 25 et 75 pour cent du salaire mensuel moyen, ce qui signifie que l'accès effectif à la justice ne reste pas abordable pour tous les citoyens. En outre, une telle situation affecte particulièrement les femmes et les personnes ayant des besoins spéciaux.
Sur la base de la stratégie et du plan d'action pour la réforme judiciaire pour 2007-2012 et des mesures de suivi de la loi sur l'aide judiciaire adoptée en 2011, le PNUD, en coopération avec le ministère de la Justice et avec le soutien des gouvernements néerlandais et La Norvège a lancé un projet sur la réforme du système d'aide juridique pour rendre le conseil juridique abordable et largement disponible.
La mise en œuvre de la loi a débuté en janvier 2012, après l'ouverture des bureaux d'aide juridique dans les 15 tribunaux de base du pays.
L'impact du projet revêt une grande importance pour le pays, étant donné que, jusqu'à son adoption, le Monténégro était l'un des rares pays d'Europe à ne pas disposer d'une loi spécifique garantissant l'aide judiciaire à ses citoyens. Selon les informations les plus récentes, 787 demandes d'aide judiciaire ont été déposées en 2016, parmi lesquelles 510 étaient des femmes et 277 des hommes. En 2015, 628 demandes d'aide judiciaire ont été déposées, dont 399 femmes et 229 candidats hommes. En 2014, 700 demandes d'aide judiciaire ont été déposées, dont 438 femmes et 262 hommes. Outre le bénéfice que l'introduction du système d'aide juridique a apporté aux habitants du Monténégro, il convient de souligner que la réforme du système d'aide judiciaire était nécessaire pour parvenir à une harmonisation législative avec les normes de l'UE dans ce domaine, qui était l'un des les conditions d'une nouvelle progression vers les intégrations européennes. Le pays a donc rempli ses obligations en vertu des lois internationales sur les droits de l'homme et a fait un pas important pour surmonter le problème d'une inégalité fondamentale des citoyens en termes d'accès à la justice.
Budget: Les ressources pour la mise en œuvre de cette solution doivent être allouées par le gouvernement de l'État, car l'accent est mis sur le fait que le système d'aide juridique doit être financé par l'État et accessible à tous.
Partenaires: Cour suprême du Monténégro, 15 Tribunaux de base au Monténégro, Chambre du Barreau, Autres partenaires: Ministère de la Justice du Monténégro, Barreau et Barreau du Monténégro, Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, Open Society Foundation et le Conseil d'Europe, ainsi que plusieurs gouvernements municipaux et ONG.
Informations de contact:
Stanka Dragojevica BB, Podgorica, Monténégro
Organisation: PNUD
Personnes de contact: M. Tomica Paovic
Téléphone: +382 20 447 465
E-mail: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.