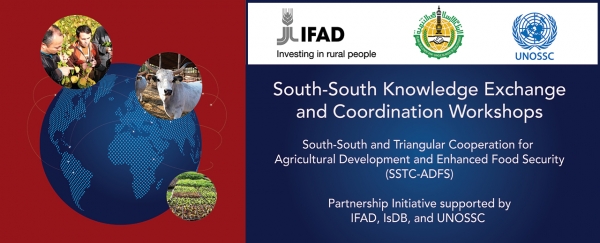Solutions SSDA
South-South Development Academy
Solutions SSDA
South-South Development Academy
Blog
En moyenne, 750 000 cas de décès d'enfants dus à la pneumonie sont signalés chaque année en Afrique. Beaucoup de ces décès causés par un mauvais diagnostic, en particulier dans les villages et les zones reculées, les enfants tombent malades - et la première réaction est de les traiter pour le paludisme. La plupart des gens sont conscients du paludisme, et les signes du paludisme et de la pneumonie sont très similaires, il est donc difficile pour les professionnels de la santé de se différencier.
En 2016, Brian Turyabagye, co-fondateur de Mamaope Medicals, a conçu une veste intelligente biomédicale qui distinguerait les symptômes de la pneumonie - température, fréquence respiratoire et bruit des poumons - et éliminerait la plupart des erreurs humaines, diagnostiquant la pneumonie chez les enfants de moins de 5 ans. un taux trois à quatre fois plus rapide qu'un médecin. Il l'a nommé «Mamaope», ou «espoir de la mère» - une référence aux 27 000 enfants qui meurent de pneumonie en Ouganda chaque année .
La veste MamaOpe fonctionne de manière simple. Une fois qu'un enfant le met, un agent de santé active une unité de contrôle. Après avoir cliqué sur le bouton de démarrage, la veste suit les signes vitaux de la pneumonie et affiche les résultats après 3 minutes. Cette solution à faible coût rend le processus de diagnostic beaucoup plus rapide que les méthodes conventionnelles actuellement utilisées, comme celles qui nécessitent un stéthoscope, peuvent nécessiter cinq minutes ou plus.
Les avantages de la veste médicale intelligente sont de prévenir les cas récurrents de diagnostic de pneumonie. Depuis novembre 2017, la veste a été testée en Ouganda. Jusqu'à présent, Mamaope est en cours de déploiement dans certains des principaux hôpitaux de l'Ouganda et il devrait bénéficier à plus de 50 000 citoyens par an qui ont été victimes de la pneumonie.
L'équipe a construit des vestes de test et celles-ci sont actuellement approuvées pour le marché. Mamaope Medicals a également l'intention de développer davantage la solution afin de permettre un suivi à distance des patients par leurs médecins.
La solution a été élue lauréate de Pitch @ Palace Africa 2017 et classée par CNN parmi les 12 innovations africaines qui vont changer le monde.
Partenaires: Le projet a été financé à lui seul par Resilient African Network (RAN), mais tout soutien additionnel de la part des plus avisés pour une mise à l'échelle serait grandement apprécié .
Budget: USD 100 000 pour la commercialisation et la production.
Détails du contact:
Ouganda
M. Brian Turyabagye Cofondateur, Mamaope Medicals
Téléphone: +256764555236
Email: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
En réponse au taux de chômage élevé et au niveau de pauvreté parmi les jeunes en Ouganda, le gouvernement de l'Ouganda a lancé le Youth Livelihood Program (YLP). YLP est un programme glissant qui a débuté en 2013 et qui se terminera en 2018, ciblant les jeunes pauvres et sans emploi (18-30 ans) pour exploiter leur potentiel socioéconomique et augmenter les possibilités d'emploi indépendant et les niveaux de revenu.
Le programme est mis en œuvre par le Ministère du genre, du travail et du développement social en collaboration avec les gouvernements locaux et couvre tous les 122 districts actuels (y compris la ville de Kampala) et 41 municipalités. La conception et la mise en œuvre du programme reposent sur le modèle de développement piloté par la demande (CDD). Les jeunes reçoivent le soutien sous la forme de fonds renouvelable avancés par l'intermédiaire des groupes d'intérêt jeunesse (GPJ).
Le programme est structuré et intégré aux niveaux national et local où les gouvernements locaux sont responsables de la mobilisation et de la sensibilisation, de la sélection des bénéficiaires, de la préparation des projets, de l'évaluation et de l'approbation des projets, du suivi et de la supervision.
Le ministère fournit les directives techniques, le renforcement des capacités de soutien, le financement et la coordination générale. Et le soutien est assuré par des groupes d'intérêt de la jeunesse (GPJ) de 10 à 15 personnes sous la forme de fonds renouvelables (prêts à taux réduit - avec des termes favorables aux jeunes).
Les groupes cibles comprennent les catégories suivantes de jeunes: Abandons d'écoles et d'institutions de formation, Jeunes vivant dans des bidonvilles, rues de la ville, communautés à haut risque et pauvres, Jeunes n'ayant pas eu l'opportunité de suivre des études formelles, Famille monoparentale , Les jeunes handicapés, les jeunes vivant avec le VIH / sida et les jeunes qui ont terminé leurs études secondaires ou leurs établissements d'enseignement supérieur (y compris l'université) mais qui restent au chômage.
Dans le cadre du programme YLP, la majorité des bénéficiaires sont des décrocheurs scolaires (34,6%), suivis de ceux qui ont seulement terminé leurs études primaires (19,6%). 2,8% des bénéficiaires sont des jeunes handicapés.
Le programme comprend les éléments suivants:
- Autonomisation des jeunes: La plus grande implication des jeunes dans la mobilisation, la sensibilisation, la priorisation et la planification de leurs besoins, la mise en œuvre et le suivi et l'évaluation des activités du programme a créé un sentiment d'autonomisation et de confiance pour prendre leur destin en main. Les compétences fournies par la formation de base en gestion financière, en entrepreneuriat, en développement des affaires, en dynamique de groupe et en compétences de la vie courante renforcent l'habilitation des jeunes impliqués dans le programme.
- Engagement économique des jeunes: les jeunes soutenus sont engagés dans le travail indépendant par le biais de métiers professionnels et d'activités génératrices de revenus financés par YLP.
- Inclusion financière: Tous les jeunes soutenus dans le cadre du programme reçoivent les fonds par l'intermédiaire des banques commerciales. Un certain nombre de ces groupes de jeunes n'avaient jamais eu de contacts avec les banques auparavant, mais ils détiennent maintenant des comptes d'épargne dans les banques commerciales. C'est une grande réussite dans la promotion de l'inclusion financière chez les jeunes vulnérables.
- Soutien au développement économique local: Les YIG achètent des produits et des services localement et soutiennent ainsi la communauté comme l'approvisionnement en intrants agricoles, les formateurs pour les projets d'amélioration des compétences augmentent donc pour les entrepreneurs locaux qui traitent avec les YIG.
- Augmentation des niveaux de revenu pour les jeunes: Un certain nombre de projets financés par les jeunes ont été productifs, ce qui a permis aux jeunes de gagner un revenu proportionné, ce qui a permis à certains JEJ de rembourser à 100%. Le rapport d'évaluation du processus a classé 51% des entreprises du YIG comme ayant réussi, 46% luttant et 3% ayant échoué / démantelé.
- Acquisition accrue de compétences: Un certain nombre de jeunes ont acquis des compétences employables dans le cadre d'une formation en apprentissage dispensée par des experts locaux. Cela s'est traduit par un effet multiplicateur et une autonomie des projets. Par exemple, un certain nombre de jeunes ont ouvert leurs propres centres de formation pour former des membres de la communauté et d'autres jeunes à des frais raisonnables et à des horaires de formation flexibles.
- Inclusion financière: Dans le cadre du programme, les YIG ont accès aux fonds du projet par l'intermédiaire des banques commerciales. Par conséquent, 13 107 comptes bancaires de YIG ont été ouverts et exploités. En outre, les bénéficiaires ont également ouvert des comptes dans les organisations coopératives d'épargne et de crédit (SACCO) et sont engagés dans des associations d'épargne au niveau des villages (VLSA).
Réalisations: Le montant total remboursé au 12 janvier 2018 était UShs. 15.249 milliards , [représentant 67% des UShs. 22,903 milliards qui est due à ce jour]. 112 groupes ont été entièrement libérés (100% de remboursement).
Le Programme en décembre 2017 a entamé le processus de rotation des fonds récupérés vers divers districts et conseils municipaux. À ce jour, 703 projets valent USHs. 6,269 milliards ont été financés par les fonds renouvelables. Cela profite à 8 112 jeunes.
Partenaires: gouvernements locaux et municipalités.
Budget: Il est financé initialement par les ressources propres du gouvernement (avec la possibilité d'un soutien des partenaires de développement à l'avenir). Le programme a reçu une version cumulative de USh. 132 423 537 300 ( des 265 milliards de dollars initiaux.
Détails du contact:
Ouganda
Mme Dianah Naturinda Makobore, gestionnaire de programme
Téléphone: +256782240088
Email: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
http://ssda.southsouth.world/fr/ssda-blog-fr-fr/author/42-webadmin?start=96#sigProId3e90a1ce65
Résumé
Voyage d’étude et d'échange d’expériences entre la Mauritanie et le Burkina Faso sur la gestion du Programme National de Volontariat pour s’inspirer de l’expérience du Burkina sur sa mise en œuvre et son ancrage institutionnel en vue de la mise en place d’un Programme National de Volontariat de la Mauritanie (PNVM).
Défi
Dans des contextes où une grande partie de la population à moins de 20 ans et un accès limité à l'emploi formel, comme c’est le cas au Burkina Faso et en Mauritanie, il est important de créer des opportunités pour capitaliser sur cette ressource humaine sous-utilisée. Le programme de volontariat (PNVB) a le potentiel de développer les ressources humaines, contribuer à l'emploi des jeunes et être cohérent avec la lutte contre le chômage et la pauvreté.
L'objectif est d'engager de jeunes volontaires qualifiés, leur permettant de contribuer au développement
de la nation ainsi que d'acquérir une expérience qui augmenterait leurs chances d'emploi.
Le Groupement d’Intérêt Public - Programme National de Volontariat au Burkina Faso a été mis en place en 2006 avec la mission de valoriser, de promouvoir et de développer toutes les formes d’engagement volontaire D’après le Programme Volontaires des Nations Unies (PVNU), depuis sa création, le Programme National de Volontariat au Burkina Faso a recruté 25,000 volontaires et à contribuer à la formulation de la lois sur le volontariat de 2008, et intervient dans les treize régions du Burkina Faso à travers des Centres Régionaux de Volontariat (CRV) abrités par des organisations de la société civile. Cette expérience a inspiré la Mauritanie à entreprendre un programme similaire.
Solution
Une délégation mauritanienne est arrivée au Burkina Faso en 2014 dans le but de s’enquérir de l’expérience du Burkina Faso en matière de création et de gestion d’un programme national de volontariat.
La délégation a eu des entretiens avec un certain nombre d’acteurs dont les responsables et les partenaires techniques du GIP-PNVB (Programme VNU, France Volontaires, etc.). Elle a par ailleurs rendu visite aux autorités du Ministère en charge de la jeunesse du Burkina Faso (ministère de tutelle technique). La délégation, avec l’accompagnement du GIP-PNVB, a visité deux Centres Régionaux de Volontariat (CRV) : le CRV du Centre ouest à Koudougou, et celui du Nord basé à Yako. Une visite de structure d’accueil et des volontaires nationaux en mission a clôturé les visites.
Le programme National de Volontariat en Mauritanie a été lancé en Janvier 2014. La visite d’étude au Burkina Faso a permis de mieux connaître le fonctionnement des structures créées, de s’approprier des outils développés et tirer les leçons des difficultés rencontrées afin de renforcer le programme.
Soutenu par: PNUD
Implementé par: Programme National de Volontariat de la Mauritanie
Contact:
Naomi Falkenburg, Chargée de programme des Volontaires ONU au Burkina Faso - Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
En raison du changement climatique au Bénin, on s'attend à ce que la variabilité de la fréquence et de l'intensité des chocs liés au climat augmente, nécessitant ainsi l'adaptation de divers secteurs socio-économiques. La vulnérabilité du Bénin aux risques climatiques a été démontrée en 2010 lorsque le Bénin a subi plus de 262 millions de dollars de pertes dans divers secteurs socio-économiques (agriculture, commerce et infrastructures) en raison des inondations. De même, la région côtière du Bénin, qui compte plus de 3 millions d'habitants et l'un des plus grands marchés d'Afrique de l'Ouest et du Centre, a été victime de l'envahissement côtier de 16 mètres par an.
Dans un pays en développement comme le Bénin, les impacts du changement climatique sont exacerbés par des mécanismes de sensibilisation limités aux niveaux locaux et la dépendance d'un pays à l'agriculture de subsistance. Pour le Bénin, améliorer la collecte d'informations climatiques et développer un système d'alerte précoce est un moyen efficace de sensibiliser la population générale aux risques climatiques et climatiques afin que les communautés (en particulier les agriculteurs pluviaux) puissent se préparer en conséquence. Cependant, actuellement, un système d'alerte précoce pour les prévisions multirisques (p. Ex. Inondations côtières et inondations) ainsi que les capacités de production et de diffusion d'informations météorologiques / climatiques n'existe pas au Bénin.
Cette solution consistait en une mission d'étude au Kenya du 24 au 29 mars 2014. Le Centre de prévision et d'application du climat (ICPAC) de l'Autorité Intergouvernementale pour le Développement (IGAD) basé au Kenya dispose d'un SAP qui couvre tous les pays d'Afrique de l'Est. L'ICPAC est également en contact avec toutes les autres institutions nationales et régionales basées au Kenya impliquées dans l'alerte rapide.
L'objectif principal de la mission était de visiter et d'apprendre sur le fonctionnement et les différentes composantes des systèmes d'alerte précoce au Kenya. Plus précisément, la mission a impliqué:
- Acquérir des connaissances sur divers composants techniques (équipements, technologies et infrastructures informatiques) du SAP (de la phase d'acquisition et de transmission des données, à la phase de production-diffusion de l'alerte, en passant par la phase de traitement et de prévision);
- Rencontrer les principales structures impliquées dans la prévention des risques hydro-climatiques afin de comprendre le modèle organisationnel et le fonctionnement institutionnel des SAP au Kenya et en Afrique de l'Est;
- Apprendre les limites et le niveau de sécurité offerts par les dispositifs existants dans la prévention des risques hydro-climatiques;
- Apprendre à connaître les aspects administratifs, juridiques et financiers de l'activité d'alerte précoce sur les risques hydro-climatiques au Kenya et en Afrique de l'Est sous la direction de l'IGAD; ainsi que des aspects liés à l'intégration du secteur privé.
L'expérience acquise a permis de renforcer les capacités des structures nationales impliquées dans la mise en œuvre du Système d'Alerte Précoce (SAP). Un système d'alerte rapide transitoire pour la gestion des inondations a été mis en place en 2014. La couverture nationale du suivi climat / météo s'est améliorée de 26%, passant de 30% à 56%. La périodicité des données des stations de collecte et d'émission est passée d'une base mensuelle (difficile) à une base quotidienne.
Pays fournisseur: Kenya et Pays-Bas
Soutenu par: PNUD
Agence d'exécution:
Direction Générale de l'Eau, Institut National de l'Eau, Agence Nationale de Météorologie / Météo-Bénin, Institut de Pêches et d'Océanologie du Bénin (IRHOB). Centre de prévision et d'applications climatiques de l'IGAD, Office sous-régional de l'OMM pour l'Afrique centrale et australe, Autorité nationale de gestion de la sécheresse, Centre régional de cartographie des ressources pour le développement, Département de météorologie du Kenya et Département des ressources hydrauliques, Ministère de l'environnement, de l'eau et des ressources naturelles. .
Contact:
PNUD Bénin
Isidore Agbokou
Chef d'équipe, développement durable et croissance inclusive
Email: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
La pêche et l'aquaculture jouent un rôle important en termes socio-économiques et en tant que source de nourriture. Cependant, au fil des ans, il n'y a pas eu de progrès stable dans l'augmentation des niveaux de production des pêcheries. En 1988, la production de la pêche a atteint 102 tonnes, mais elle a baissé dans les années 90 avant de revenir lentement au même niveau de production de 102 tonnes en 2004. Ce n'est qu'au cours des deux dernières années que la pêche annuelle a atteint 110 tonnes. La consommation annuelle par habitant a suivi la même tendance (de 13,5 kg en 1988, elle est tombée à 8,5% en 1990, passant à 9,5 kg ces dernières années) avec une répartition régionale très faussée, du fait que la consommation annuelle par habitant dans les régions de l'intérieur est inférieur à 1,5 kg.
Une façon de lutter contre ce défi consiste à envisager l'aménagement de l'aquaculture marine, qui consiste à identifier les zones appropriées (onshore, offshore et côtière) pour exercer une activité dans l'aquaculture marine. L'activité aquacole englobe la conchyliculture, la culture d'algues et la pisciculture. Il est mis en œuvre à travers la mise en place de plans d'aménagement de l'aquaculture qui identifient, en plus des zones favorables, les espèces potentielles et leurs techniques culturales / culturales appropriées.
La méthodologie adoptée pour la réalisation des plans d'aquaculture a été initiée en 2013 dans le cadre du premier plan réalisé au niveau de la baie de Dakhla jusqu'à la baie de Cintra (Région de Dakhla-Oued Eddahab). Cette méthodologie a sa particularité d'appliquer une approche de sélection progressive, qui prend en compte tous les paramètres techniques, environnementaux et administratifs, en identifiant les zones les plus propices à l'exercice d'une aquaculture durable et respectueuse de l'environnement. Cette approche a également permis l'organisation du secteur de l'aquaculture au niveau national, à travers la fourniture de projets clé en main à des investisseurs potentiels dans le cadre d'appels à manifestation d'intérêt. L'institution publique marocaine en charge du développement de ce secteur s'appuie à la fois sur un diagnostic détaillé et une analyse approfondie d'un ensemble de critères de faisabilité administratifs, juridiques, environnementaux, techniques et socio-économiques, et sur une approche participative impliquant tous les acteurs du territoire concerné par l'aménagement du territoire marin et côtier.
Afin d'assurer la pérennité de l'activité aquacole, plusieurs instruments d'intégration environnementale sont pris en compte, de la phase de planification et de sélection à la phase opérationnelle. L'étude de la capacité d'accueil consiste en l'évaluation de la capacité du milieu récepteur à accueillir des projets aquacoles, illustrée par la capacité de charge physique, productive, écologique et sociale, ce qui assure la pérennité de l'activité et de l'environnement récepteur.
L'évaluation globale de l'impact environnemental d'un plan de gestion aquacole est utile car elle permet de calculer et d'évaluer les impacts cumulatifs générés par la multitude de projets situés dans une zone donnée et de présenter des mesures d'atténuation adaptées, contrairement aux études d'impact environnemental isolées sont spécifiques à chaque projet individuel et ne permettent pas cet exercice. Ces outils sont multiformes et s'appliquent à différents niveaux tels que: i) Étude des capacités de charge pendant la phase de sélection du site, ii) Réalisation d'études d'impacts environnementaux portant sur les impacts négatifs significatifs de l'aquaculture ainsi que les impacts positifs de cette activité. aboutir à la proposition de mesures d'atténuation et de renforcement efficaces (iii) Plans de gestion environnementale et sociale, nécessaires au suivi environnemental et social des plans d'aquaculture.
- Plan d'aquaculture dans la région de Dakhla Oued Ed Dahab: de la baie de Dakhla à la baie de Cintra / Fin des études (août 2015), mise en œuvre par le lancement d'un appel à manifestation d'intérêt (novembre 2015);
- Plan d'aquaculture dans les régions de Souss Massa et Guelmim Oued: d'Imessouane à Sidi Ifni / Fin des études (avril 2017), mise en œuvre en préparation;
- Plan d'aquaculture dans la région méditerranéenne: de Cap Targha à Saidia / Fin des études prévues en août 2017, mise en œuvre en préparation;
- Plan d'aquaculture dans les régions de Guelmim Oued Noun et Laayoune Sakia El Hamra: de Guelmim à Boujdour / en construction;
- Plan d'aquaculture dans les Régions de Casablanca Settat et Marrakech Safi: d'El Jadida à Essaouira / en construction.
Les plans d'aquaculture ont évalué le potentiel aquacole réel du littoral national, sur la base de données et de connaissances fiables du milieu marin, et ce, après avoir analysé toutes les formes d'activités, d'utilisations et de professions actuelles et futures. L'approche de planification participative adoptée par ANDA, impliquant tous les acteurs locaux, régionaux et centraux concernés par les zones côtières maritimes et terrestres, constitue une anticipation de l'intégration sectorielle permettant l'optimisation et l'harmonisation de l'utilisation des zones côtières tout en valorisant les écosystèmes côtiers .
En raison de la nouvelle méthodologie appliquée, les résultats suivants ont été obtenus:
- Établissement d'une cartographie des zones allouées à l'aquaculture (AAA) (onshore, offshore et côtière) avec une base de données complète;
- Identification des espèces potentielles et proposition de technologies appropriées;
- Établissement de plans de lotissement: Le plan de lotissement est l'avant-dernière étape du processus de planification et consiste en la fragmentation de polygones favorables à l'aquaculture précédemment identifiés. Par conséquent, durant cette étape et sur la base de la superposition de tous les paramètres précédemment identifiés (oxygène dissous, température, courants, etc.), d'une étude socio-économique et d'une pondération préétablie, ces polygones sont décomposés en unités économiquement viables. , dont la production, la technique et le type d'élevage sont identifiés.
- Les projets clés en main proposés dans le cadre de la planification dans les régions de Dakhla, Souss-Massa et de la Méditerranée ont été lancés pour des investissements via des appels à manifestation d'intérêt. Les progrès de la mise en œuvre de ces 3 plans sont les suivants:
- Zone Dakhla-Cintra: La publication officielle des résultats de l'appel à manifestation d'intérêt a été réalisée le 21 septembre 2017;
- Région de Souss-Massa: l'appel à manifestation d'intérêt a été lancé le 27 décembre 2017;
- Région méditerranéenne: l'appel à manifestation d'intérêt a été lancé le 18 juillet 2017.
Cette solution offre également aux investisseurs potentiels des espaces étudiés à tous les niveaux, les exemptant de ces études coûteuses et évitant leur installation anarchique et permettant aux populations locales des sites sélectionnés de bénéficier des projets d'aquaculture artisanale prévus dans le cadre des coopératives, afin de améliorer les conditions de vie de ces populations. C'est aussi une raison pour la création de richesse et fournit des emplois directs et indirects et une croissance socio-économique régionale. Il est également intéressant de noter que la protection de l'environnement marin est également parmi l'impact important de la solution.
Globalement, les plans d'aquaculture ont permis la mise en place d'une base de données cartographiques exhaustive et consolidée, qui a servi d'outil pour la localisation et la planification de l'activité. Ils aident également à surveiller et à fournir aux investisseurs des projets clé en main, ainsi que des zones propices à l'activité aquacole productive et durable. Par conséquent, cette base de données cartographiques sur l'environnement permet aux investisseurs de mieux planifier et concevoir leurs projets, ce qui contribuera à augmenter les niveaux de production de la pêche au cours des prochaines années.
Budget : 1,8 million de dollars
Détails du contact:
Maroc
Agence nationale de développement de l'aquaculture
+212 538 099 700
Email: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Basée sur la politique et la pratique brésiliennes de mise en place de banques de lait (BLH), initiée par le ministère de la Santé et la Fondation Oswaldo Cruz (Fiocruz) dans les années 1980, un réseau mondial de banques de lait humain (RBLH) une communication des connaissances et des technologies visant à assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des nouveau-nés et des nourrissons, en ayant le droit à la santé comme valeur centrale. (ABC), sans l'intention de transférer à la mise en œuvre de ses propres ressources, pour la mise en œuvre de ses propres ressources. les banques de lait humain (en particulier l'Angola, le Cap-Vert et le Mozambique sont devenus partie intégrante du RBLH en 2010). Une fois que les entreprises ont réussi, qu'est-ce qui est un plan de travail horizontal, qui est un ensemble horizontal.
Défi:
(7000 par jour) est décédé en 2016, (près de 7 mois par jour) est mort en 2016, (près de 7 mois par jour) est décédé en 2016, ce qui est de 40% en Afrique subsaharienne. Dans le même temps, seuls dix pays d'Afrique subsaharienne ont partiellement atteint l'objectif du Millénaire pour le développement consistant à réduire la mortalité infantile d'ici à 2015.
Solution:
Avec la mission de soutenir ou d'allaiter, et de collecter, traiter, évaluer, stocker et distribuer du lait humain, les BLH peuvent être créés avec une technologie simple et peu coûteuse, assemblés en ressources réelles, en relativement peu de temps. En plus de sa contribution importante à l'augmentation des taux d'allaitement maternel et des améliorations de la santé néonatale, le HMB génère des preuves pour améliorer les politiques publiques liées à la santé. L'expérience brésilienne montre que les HBs sont un moyen efficace d'augmenter la survie des bébés ayant des problèmes (principalement des bébés prématurés) et de réduire la mortalité néonatale (comme l'indique une baisse de plus de 70% des taux entre 1990 et 2012).
Une banque Sud-Sud pour la mise en œuvre d'un HBL implique une qualification professionnelle, la fourniture d'équipements spécialisés et l'adéquation des installations physiques. La formation de la santé et de l'éducation et la gestion et l'information dans BLH) et la réalisation de stages (dans les domaines de l'assistance aux femmes dans le processus d'allaitement maternel, la communication et l'information, entre autres). Ensemble, un ABC et Fiocruz soutiennent technique et financier, qui est une installation et qualification des banques de lait dans diverses parties du monde, par le partage d'expériences, de connaissances et de technologies et le renforcement des capacités locales, en respectant les différents contextes socioéconomiques et culturels. Cette version dispose d'une liste interminable de corrections, de modifications et de nouveautés qui améliorent considérablement son fonctionnement.
RBLH joue un rôle central dans la promotion de la mise en place de banques de lait dans les pays intégrés en réalisant des activités telles que des ateliers et des ateliers et en encourageant le partage de documents techniques et scientifiques. Des exemples de telles initiatives sont une chaîne YouTube avec Educational VIDEOS, une plateforme d'apprentissage à distance et le Young Researchers Award impliqué dans le rBLH.
La création et / ou le renforcement du HMB dans les pays africains est essentiel pour le renforcement de leurs systèmes de santé nationaux. La première unité BLH africaine a été installée à l'hôpital Agostinho Neto à Praia (Cap-Vert) en 2011, impliquant une formation de 96 techniciens. Au cours de sa première année de fonctionnement, une équipe locale a constaté une réduction de 50% des décès de nouveau-nés; entre 2011 et 2016, 2 500 bébés ont été allaités et 17 499 femmes ont été allaités. Le projet d'une nouvelle unité capverdienne sur l'île de São Vicente est en cours de discussion. La deuxième unité du BLH africain est en phase d'implantation, pas l'hôpital central de Maputo (Mozambique), avec le début des activités prévues pour le premier semestre de 2018. À son tour, le premier BLH angolais à entrer en opération au Paim Lucrécia Maternité à Luanda Les autres pays africains lusophones et le Timor-Leste devraient également rejoindre le RBLH, comme prévu par la création en octobre 2017 du Réseau BLH de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP).
Supporté par:
Agence brésilienne de coopération (ABC) et les ministères de la santé du Brésil et les pays participant à RBLH
Agence d'exécution:
Fiocruz / Ministère de la Santé, à travers ses unités: l'Institut National de la Santé des Femmes, des Enfants et des Adolescents Fernandes Figueira (IFF) et l'Institut de Communication et d'Information Scientifique et Technologique en Santé (ICICT)
Plus d'information:
- Programme ibéro-américain des banques de lait humain (iberblH)
- Les banques de lait autour du monde autour du monde
Contact:
Brésil
Fondation Oswaldo Cruz (Fiocruz / Ministère de la Santé)
João Aprígio Guerra de Almeida
Coordonnateur du Réseau mondial des banques de lait humain (RBLH)
E-mail: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Mis en œuvre entre 2008 et 2011 par le Secrétariat des Droits de l'Homme de l'époque (actuellement le Ministère brésilien des Droits de l'Homme), le projet «Appui à la formulation et au suivi du Programme National pour l'Universalisation des Registres de Naissance en Guinée Bissau». de la Justice pour l'élaboration et l'exécution d'une politique nationale de prise en charge de l'enregistrement civil des naissances.
Défi:
La Guinée Bissau est l'un des pays les moins développés et a l'un des taux de mortalité infantile les plus élevés du monde, soit cinq ans (88 pour 1 000). Avec un taux de croissance élevé (environ 2,5%), la population guinéenne est majoritairement jeune (42% des habitants ont moins de 15 ans). La majorité de la population dépend de l'agriculture de subsistance pour assurer ses moyens de subsistance et sa vie dans des zones où les écoles, les marchés et les postes de santé ne sont pas facilement accessibles. Le réseau routier est très limité et l'électricité, qui n'existe que dans les villes, est rare.
L'enregistrement civil des naissances (RCN) est un droit pour tous les enfants et le premier pas vers l'accès à d'autres droits et services publics et au plein exercice de la citoyenneté. La MRC permet à l'État de connaître le nombre et le lieu de naissance des individus, en favorisant le développement de politiques publiques au service des citoyens. La fourniture d'une identité légale pour tous (y compris l'enregistrement des naissances) d'ici 2030 est l'un des objectifs spécifiques internationalement reconnus associés aux SAO 16. Malgré l'importance de la CDE, seulement 39% des enfants sont enregistrés en Guinée Bissau, selon l'UNICEF. La sous-déclaration constitue un défi à la protection des enfants guinéens et ses principales causes sont la concentration des services d'enregistrement, la faible capillarité des registres (bureaux d'enregistrement), la difficulté d'accès aux services et la perception de frais élevés pour obtenir la MRC. Plusieurs tentatives pour remédier au problème dans le pays ont été entreprises par le gouvernement, par l'intermédiaire du ministère de la Justice, sans toutefois aboutir à des résultats positifs.
Solution:
En 2008, le Ministère de la Justice de Guinée-Bissau a demandé l'appui du Secrétariat des Droits de l'Homme de l'époque (rattaché à la Présidence de la République du Brésil) pour faire face au sous-enregistrement civil de naissance dans votre pays.
Au Brésil, la stratégie d'éradication du sous-enregistrement civil à la naissance a permis de faire passer l'indice de sous-enregistrement de 20,9% en 2002 à 6,6% en 2010. Il reposait sur la mobilisation nationale pour la MRC et le plan national pour la MRC, avec des actions impliquant les États et les municipalités. Lancé en 2004, le Plan national de RCN repose sur une gestion partagée et une articulation entre les sphères gouvernementales, les branches législatives et judiciaires, les organisations internationales et les ONG, et s'articule autour des axes suivants:
- Mobilisation : promotion de mobilisations et de campagnes de mobilisation, aux niveaux national, régional, étatique et municipal;
- Réseau de service : l'expansion de l'offre de services RCN et de la documentation de base, la mise en œuvre d'unités interconnectées, l'amélioration du flux d'informations entre les maternités et les registres;
- Conditions structurantes : la création du Système National d'Information du Registre Civil (qui modernise, via une plateforme digitale, la saisie et le traitement des données) et l'amélioration de la législation, ainsi que le suivi et l'évaluation.
Compte tenu des similitudes entre les contextes brésilien et guinéen, ce projet de coopération Sud-Sud visait à reproduire l'expérience réussie du Brésil, en l'adaptant aux particularités de la Guinée-Bissau. Parmi les stratégies retenues figuraient, entre autres, l'expansion du réseau des services d'état civil (avec l'expansion des conservatoires et la structuration des services itinérants et des maternités), ainsi que la communication et la formation des agents de mobilisation. Les activités et les résultats du projet comprenaient principalement:
- La formulation, avec le Ministère de la Justice de Guinée-Bissau, du Programme National d'Universalisation de la MRC;
- La création du règlement intérieur, des instruments de coopération et d'intégration des actions et du plan d'action du Comité de pilotage du Programme national d'universalisation de la MRC;
- Sensibiliser la population guinéenne à l'importance de la documentation civile en tant qu'instrument d'exercice de la citoyenneté et de promotion et de défense des droits de l'homme; et
- Le suivi de l'exécution du programme national d'universalisation de la MRC.
Supporté par:
Du côté brésilien: Agence de coopération brésilienne (ABC) et Ministère des droits de l'homme
Du côté guinéen: Ministère de la Justice
Agence d'exécution:
Ministère des Droits de l'Homme du Brésil
Contact:
Brésil
Ministère des Droits de l'Homme
Thiago de Almeida Garcia
Coordonnateur général pour la promotion de l'enregistrement des naissances, Secrétariat national à la citoyenneté
Email: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Ce projet visait à répondre au problème de l'exclusion du système d'enseignement secondaire formel au Cap-Vert, qui laisse de nombreux jeunes sans compétences et obstacles, et entrave leur capacité à intégrer le marché du travail, les plaçant en marge de la société et favoriser la délinquance juvénile. Basé sur l'expérience de l'ONG brésilienne AfroReggae dans certaines des favelas les plus violentes de Rio de Janeiro et d'autres pays, le projet a développé une série d'initiatives visant à investir dans le potentiel des enfants défavorisés dans trois quartiers pilotes de Praia. l'éducation, la culture et l'art dans des environnements marqués par la violence urbaine.
Défi:
La population du Cap-Vert est principalement urbaine (les centres urbains concentrent 62% de la population) et jeune (avec une moyenne d'âge de 26,2 ans). Environ 192 000 enfants et adolescents âgés de 0 à 17 ans (soit près de 40% de la population) vivent dans l'archipel. Bien que l'éducation de base soit pratiquement universelle au Cap-Vert, avec la grande majorité des élèves inscrits dans les écoles publiques, l'enseignement secondaire continue d'être l'un des défis pour l'éducation dans le pays. Malgré la forte expansion de l'enseignement secondaire entre 2001 et 2009, les taux d'abandon scolaire restent très élevés, en particulier pour les élèves âgés de plus de 14 ans issus de classes sociales défavorisées. Le fait que l'étude secondaire ne soit pas gratuite et tende à être perçue par les familles comme une dépense et non comme un investissement favorise la sortie des adolescents de l'école avant la fin du secondaire, certains cherchant du travail (bien que de nature précaire) ), d'autres cherchant de l'argent facile dans des activités moins désirables. On estime que sur cinq jeunes de 17 ans, deux ne sont pas scolarisés.
Le taux de chômage officiel dans le pays était de 16,8% en 2012, le taux le plus élevé en zone urbaine (19,1%). Avec un taux d'environ 21%, les jeunes âgés de 15 à 24 ans sont les plus durement touchés par le chômage. Cette situation dans laquelle les segments urbains et de la jeunesse sont les plus touchés contribue à la perpétuation des cycles de pauvreté, avec un impact potentiellement significatif sur l'abandon scolaire, la migration et la violence de rue, un des problèmes qui fortement dans les dernières années.
Outre le chômage et la faible scolarisation des jeunes, plusieurs autres facteurs ont été avancés comme causes possibles de l'émergence des gangs de rue et de l'augmentation de la violence urbaine au Cap-Vert, en particulier: la croissance des inégalités sociales entre les couches sociales; l'expansion de l'offre de produits de consommation et le faible pouvoir d'achat de la grande majorité des jeunes; et le processus d'urbanisation sans planification, conduisant à l'expansion des quartiers périphériques informels sans équipement adéquat en termes de services de base.
Dans l'environnement des quartiers marginalisés de Praia (ville qui concentre la moitié de la population urbaine du pays), il y a un déficit d'articulation entre les mouvements de la société civile et les politiques publiques, la dépendance au financement, notamment international, pour la survie du les actions de développement, réseau embryonnaire de coopération entre les mouvements sociaux, et le manque d'accès à l'information sur les politiques publiques existantes destinées aux populations à faible revenu, principalement liées à la jeunesse et à l'éducation. Cela limite l'accès coordonné des jeunes aux services sociaux, à l'éducation (secondaire - en particulier technique et professionnelle - et supérieure) et aux possibilités d'emploi.
Solution:
Le projet de promotion de l'inclusion sociale des jeunes par la culture a été mis en œuvre dans la capitale cap-verdienne entre 2013 et 2015, avec pour objectif général de lutter contre l'évasion scolaire et la précarité sociale et de promouvoir la participation sociale des jeunes. Financé en partie par les recettes collectées dans le cadre du «Football Match Against Poverty» organisé au Brésil par le PNUD en décembre 2012, le projet visait à offrir aux jeunes victimes ou menacés d'exclusion sociale des modes de vie alternatifs, viables et bénéfiques la société, à travers la promotion des manifestations culturelles et artistiques, la réconciliation avec l'univers scolaire, l'approche du marché du travail et le développement des compétences sociales.
Grâce au transfert, avec des adaptations appropriées, de la technologie sociale de l'ONG AfroReggae, des agents de quatre organisations locales ont été formés dans trois districts de Praia pour travailler dans des réseaux de mobilisation visant à: renvoyer les évadés vers l'école; le renforcement de la politique culturelle et éducative; et le développement de débats qui contribuent à l'amélioration de la qualité de vie des jeunes défavorisés et à des changements positifs dans leur vie.
Le projet a promu des ateliers culturels et artistiques comme stratégies de lutte contre la violence et la mobilisation sociale en faveur de l'inclusion, de l'intégration et de la formation de 70 jeunes multiplicateurs locaux dans les expressions culturelles (cirque, musique, percussions, théâtre et graphite). après sa période de mise en œuvre officielle et de l'étendre au-delà des trois communautés pilotes initialement ciblées. Grâce à la recherche impliquant l'application de la méthodologie de l'Indice de pauvreté multidimensionnelle (IPM) du PNUD, le projet a également inclus le suivi social des familles à risque afin de les orienter vers les politiques publiques existantes et d'améliorer leur accès aux services publics et aux droits fondamentaux .
Le projet a été reconnu comme le quatrième plus innovant des 54 initiatives évaluées sur le continent africain dans le cadre de la «Innovation Knowledge Fair», organisée par le PNUD en décembre 2013.
Supporté par:
PNUD, UNICEF et Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP)
Agence d' exécution:
Du côté brésilien: AfroReggae
Du côté du Cap-Vert: Ministère de la Jeunesse, de l'Emploi et du Développement des Ressources Humaines, et quatre organisations locales: Association des Enfants Handicapés (ACRIDES), Association Zé Moniz, Actuels Activistes et Fondation Hope
Contact:
Cap-Vert
Bureau commun du PNUD, du FNUAP et de l'UNICEF
Nelida Rodrigues
Chef de l'Unité de développement du capital humain
Email: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Le projet de coopération bilatérale Escola de Todos vise à renforcer le système éducatif du Cap-Vert en matière d'inclusion, avec la formation d'enseignants pour les élèves handicapés et les besoins éducatifs spéciaux (SEN), l'élaboration de documents d'appui pour l'élaboration d'un politique d'éducation inclusive et mise à disposition d'espaces spécialisés pour des activités éducatives complémentaires avec ces enfants. Mis en œuvre par les ministères de l'éducation du Brésil et du Cap-Vert en partenariat avec l'Université fédérale de Santa Maria (UFSM, Brésil), l'initiative vise à offrir aux enfants et aux jeunes ayant le BEP la même qualité que les autres étudiants du pays.
Défi:
L'UNESCO a promu comme objectif international l'accès à une éducation de qualité pour tous, indépendamment de facteurs tels que le sexe, l'appartenance ethnique et le handicap. Bien qu'il n'y ait pas de données précises, l'UNESCO estime que 5% des enfants dans le monde sont handicapés, dont environ 80% vivent dans des pays en développement. Dans le même temps, les enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux (tels que la déficience intellectuelle, la déficience visuelle ou la surdité) sont moins susceptibles d'achever l'éducation de base. Cela a des répercussions individuelles et collectives négatives, en particulier l'exclusion sociale et l'alimentation d'un cercle vicieux autour de la pauvreté. Il y a donc un besoin d'éducation inclusive qui favorise une plus grande autonomie pour les enfants handicapés, avec leur intégration dans les systèmes scolaires traditionnels. Cette orientation nécessite des ressources supplémentaires, tant pour les enseignants ayant une formation spécialisée que pour l'accès à du matériel pédagogique adapté.
Suivant la perspective préconisée par l'UNESCO, le Cap-Vert a développé des initiatives dans le domaine de l'éducation inclusive spéciale, y compris l'élaboration de plans spécifiques qui incluent la formation des enseignants en matière de SEN. Selon le recensement de 2000, 3% de la population vivant au Cap-Vert souffre d'un handicap, et les enquêtes de 2001 et 2002 ont identifié environ 1000 enfants SEN inscrits dans les écoles du pays (déficience visuelle et surdité les cas les plus fréquents). Cependant, le nombre d'enseignants et de techniciens formés pour traiter ce public était donc insuffisant pour répondre à la demande.
Solution:
- Le projet School of All vise à soutenir le système éducatif capverdien dans le développement et l'offre de l'éducation inclusive dans ses différentes interfaces. Dans une première phase (2006-2007), des enseignants multiplicateurs ont été formés dans trois domaines: le système Braille et le code mathématique unifié; orientation et mobilité (pour les étudiants ayant une déficience visuelle); et l'enseignement de la langue portugaise aux sourds, avec la fourniture de matériel didactique et de kits pédagogiques spécialisés. Dans une deuxième phase, plus complète, débutée en 2008, le projet a mené des activités dans trois domaines principaux:
Organisation d'un cours de formation des enseignants (250 heures) pour le service éducatif spécialisé complémentaire à la scolarité, comprenant 11 modules: Enseignement à distance; Assistance éducative spécialisée La technologie d'assistance; Handicap physique; Déficience intellectuelle; Déficience visuelle; Surdité; Autisme; Hautes compétences / douance; Évaluation pédagogique des étudiants handicapés et adaptation curriculaire. Les deux tiers des modules ont été réalisés à distance (environnement d'apprentissage virtuel) et le reste par le biais de cours en face à face (au Cap-Vert et au Brésil). - Élaboration de lignes directrices pour les politiques publiques en matière d'éducation inclusive et de technologie d'assistance, en vue de renforcer le processus d'inclusion des élèves avec BEP dans les écoles ordinaires. Dans ce contexte, plusieurs études ont été réalisées au Cap-Vert, qui ont débouché sur des documents et des activités pour guider l'élaboration d'une politique nationale d'éducation inclusive, dont les actions liées à la langue des signes du Cap-Vert sont remarquables. Par exemple, l'enregistrement des signes utilisés par les personnes malentendantes dans les différentes îles du pays, le développement d'une langue des signes en créole (en version imprimée et numérique) et la fourniture de cours de langue des signes et d'interprétation ont été inclus. Cette partie a abouti en 2012 à un livre dans lequel est décrit une partie des activités menées dans le projet jusque-là.
- Mise en place de trois salles de ressources multifonctionnelles pour dispenser des services éducatifs spécialisés afin de desservir les élèves ayant des BEP. Le gouvernement du Cap-Vert a fourni des chambres dans les écoles des îles de Santo Antão, Santiago et Fogo, qui ont été rénovées et équipées avec le soutien du gouvernement brésilien, servant de référence en matière d'accessibilité pour les étudiants handicapés. Le pays dispose ainsi de neuf salles de ressources multifonctionnelles. Ce volet comprenait également la formation des enseignants et des étudiants à la pratique dans les salles de ressources multifonctionnelles, à travers un cours en classe en utilisant les matériaux disponibles dans les chambres.
En tout, environ 300 enseignants des écoles primaires et secondaires du Cap-Vert ont déjà été couverts par le programme, 50 enseignants formés dans les services éducatifs spécialisés, 40 enseignants multiplicateurs pour la transcription et l'adaptation du matériel Braille et 4 enseignants multiplicateurs pour la surdicécité la technologie d'assistance.
Le projet School of All, dans un format similaire, a également été développé en Angola entre 2008 et 2015, avec le soutien du ministère brésilien de l'Education.
Soutenu par: Agence de coopération brésilienne (ABC)
Agence de mise en œuvre:
Du côté brésilien: Ministère de l'éducation et de l'UFSM
Du côté cap-verdien: Ministère de l'éducation, Direction générale de l'éducation de base et secondaire (DGEBS / ME)
Contact:
Brésil
Université fédérale de Santa Maria, Centre d'éducation (CE / UFSM)
Ana Cláudia Oliveira Pavão, enseignante coordinatrice du projet
Email: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Organisée entre 2009 et 2014, cette initiative a été le premier projet de coopération Sud-Sud développé par le Brésil, dont la formulation et la mise en œuvre ont été réalisées par des mouvements sociaux, coordonnés par une ONG brésilienne (IBASE). Impliquant des organisations paysannes au Brésil, au Mozambique et en Afrique du Sud liées à l'agriculture familiale, le projet était axé sur le sauvetage des semences créoles et le renforcement technique de leur plantation et récolte, afin de promouvoir, en même temps, la génération de revenus et la préservation de l'agrobiodiversité.
Défi:
Basé sur les grandes entreprises et monocultures intensives qui utilisent la mécanisation et l'utilisation de produits agrochimiques, de semences commerciales et d'engrais chimiques pour augmenter la productivité, le modèle dominant de développement agricole a été propagé au 20ème siècle pour résoudre le problème de la faim dans le monde. . Cependant, il a été constaté que ce modèle a provoqué des déséquilibres socio-environnementaux importants (appauvrissement de la petite agriculture, appauvrissement progressif de l'agrobiodiversité, appauvrissement des sols et vulnérabilité accrue de la production aux variations atmosphériques, ravageurs et maladies). , au contraire, se concentrer sur le maintien d'un cercle vicieux entre la pauvreté, la faim et la dégradation de l'environnement. Ainsi, l'agro-industrie a été interrogée sur sa capacité à générer un développement à la fois inclusif et durable.
Selon la FAO, l'agriculture familiale est la principale forme d'approvisionnement alimentaire dans le monde et constitue la base de subsistance de la majorité de la population des pays africains (bien que dans les zones rurales, la majorité de la population soit plus pauvre). Déclarant 2014 «Année internationale de l'agriculture familiale», l'ONU visait à accroître la visibilité de ce secteur de production, qui joue un rôle clé dans la sécurité alimentaire et la souveraineté, ainsi que dans la création d'emplois et de revenus, notamment dans les pays des pays moins développés.
Par exemple, contrairement à l'homogénéisation et à la simplification des procédures agro-industrielles, l'agriculture familiale a permis de perpétuer les connaissances et les pratiques traditionnellement développées au fil du temps pour la sélection et l'amélioration des plantes et semences adaptées à des contextes particuliers. Avec des besoins énergétiques et des apports industriels bien inférieurs à ceux des monocultures, les systèmes complexes et diversifiés associés à l'agriculture familiale persistent même dans des milieux hostiles (tels que ceux soumis à la sécheresse), contribuant ainsi à la préservation du patrimoine génétique et du patrimoine culturel . Cela est particulièrement important compte tenu du fait que, selon les estimations de la FAO, environ 75% de la biodiversité agricole a disparu au cours du siècle dernier.
Face à cette situation, les mouvements paysans et les scientifiques en agroécologie ont cherché à favoriser le sauvetage des semences créoles - variétés adaptées au lieu de culture - et les pratiques communautaires traditionnelles qui leur sont associées, en particulier les banques de semences (pour assurer leur conservation jusqu'au prochaine plantation) et les foires commerciales. Ainsi, parmi les principaux défis figurent la réhabilitation et la diffusion de telles pratiques par les paysans.
Solution:
Préparé avec la participation des membres de la société civile et des leaders communautaires des pays concernés, le projet de banques communautaires de semences créoles pour l'agriculture familiale visant à former les paysans aux procédures de sauvetage, multiplication, stockage et utilisation des semences indigènes. Du transfert des technologies sociales et de l'agroécologie, le projet visait également la création de banques de semences communautaires et la formation des paysans aux processus d'échange et de commercialisation, contribuant ainsi au renforcement organisationnel et économique de l'agriculture familiale au Mozambique et au Sud. Afrique.
Les activités ont porté sur l'échange de professionnels pour l'échange de connaissances entre les trois pays, à travers des visites techniques, des cours et des tests de plantation avec la participation d'agronomes habitués à travailler avec des mouvements populaires. Des représentants de mouvements paysans mozambicains et sud-africains étaient au Brésil pour échanger des expériences et connaître des techniques de plantation et de récolte de graines créoles utilisées par les mouvements sociaux brésiliens et, à une autre occasion, pour visiter une foire d'échange de graines dans l'État de Goiás.
Avec un contenu et une méthodologie définis collectivement par les mouvements sociaux des trois pays, les cours de formation ont impliqué des techniciens et des leaders paysans sur des questions liées à la culture et à la conservation des semences, ainsi que des thèmes transversaux liés à l'organisation, au fonctionnement et aux défis. besoins des mouvements sociaux paysans. Les participants aux cours ont également été formés sur la manière de diffuser les connaissances acquises, de sorte qu'ils ont servi de multiplicateurs de l'initiative. Le projet a particulièrement pris en compte les questions de genre dans l'agriculture familiale, en incluant un séminaire spécialement dédié aux paysans, organisé par des représentants du Mouvement des femmes paysannes du Brésil. Ce séminaire a eu des répercussions sur la mobilisation et l'autonomisation des femmes au Mozambique et en Afrique du Sud, ayant influencé la création de structures et d'événements spécialisés dans ces pays.
Le projet a également formé des paysans à la méthodologie de mise en place et d'exploitation de banques de semences communautaires, réalisé un inventaire des semences indigènes présentes dans les zones couvertes par le projet dans les deux pays africains (principalement céréales, racines et légumes) . Les résultats du projet comprennent également la reconnaissance par les deux gouvernements africains impliqués des mouvements sociaux paysans et des relations plus étroites entre eux.
La principale différence de ce projet de coopération Sud-Sud était de faire en sorte que les mouvements sociaux ruraux au Brésil, en Afrique du Sud et au Mozambique définissent les demandes et les activités et leur mise en œuvre, renforçant ainsi la durabilité de l'initiative. .
Soutenu par: Agence de coopération brésilienne (ABC)
Agence de mise en œuvre:
Du côté brésilien: Secrétariat général de la Présidence de la République, Institut brésilien d'analyse économique et sociale (IBASE), Mouvement populaire paysan (MCP) et Mouvement des femmes paysannes (MMC)
Du côté mozambicain: Ministère de l'agriculture (Direction nationale de la vulgarisation agraire) et Union nationale des paysans (UNAC)
Du côté sud-africain: Ministère de l'Agriculture, des Forêts et des Pêches, et Trust for Community Outreach and Education (TCOE)
Détails du contact:
Brésil
Athayde Motta
Directeur exécutif, IBASE
Email: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Bas:
La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification a été lancée en réponse à la communauté internationale pour coordonner les efforts de lutte contre la désertification et la réhabilitation des terres dégradées et atténuer les effets négatifs de la désertification sur les ressources naturelles et les sociétés humaines. L'accord était axé sur le travail à différents niveaux par le biais des plans d'action nationaux et des programmes régionaux / suprarégionaux (RAP - PAS) pour promouvoir la coopération entre les pays de la région ou de la même région grâce à la coordination des travaux dans la région. domaine de la surveillance et du contrôle de la désertification et de l'échange d'informations et d'expériences dans ce domaine.
En conséquence, la préparation et la mise en œuvre du programme ont été entreprises pour lutter contre la désertification en Asie occidentale, en coopération avec le PNUE / ROWA et le Centre arabe d'études sur les zones arides et les zones arides de l'ACSAD. Programme international de recherche agricole dans les zones arides ICARDA
Objectifs du programme:
Le programme était axé sur deux thèmes principaux: l'eau et la végétation, le programme a donc été mis en œuvre à travers deux réseaux: gestion durable de l'eau (TN1) et gestion durable du couvert végétal (TN2) pour les objectifs suivants: a. Soutenir les pays de la région dans la mise en œuvre de stratégies pour la gestion durable des ressources en eau et de la végétation. B. Le développement d'activités innovantes pour améliorer les ressources en eau et la gestion de la végétation. T. Contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre de programmes de lutte contre la désertification et établir un partenariat entre toutes les parties. W. Soutenir la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification aux niveaux national, régional et sous-national. C. Faciliter l'échange d'informations et d'expériences entre les pays de la région.
Activités de programme:
- Choisir des sites Web en coopération avec des institutions gouvernementales et des ONG
- Mise en place d'un premier atelier avec la participation de toutes les parties prenantes pour élaborer un plan d'action.
- Mise en place d'études sociales, économiques et environnementales.
- Conduire un cours national de formation pour le savoir national afin de renforcer la capacité de mettre en œuvre les actions proposées pour lutter contre la désertification et la réhabilitation des terres dégradées.
- Mener des activités de sensibilisation pour les communautés locales sur les questions de désertification.
- Formation des cadres nationaux à l'adoption de politiques nationales visant à soutenir la mise en œuvre de programmes d'action nationaux de lutte contre la désertification et d'intégration dans les activités des plans de développement nationaux.
- Appliquer différentes procédures pour restaurer la réhabilitation des terres dégradées, telles que la récolte de l'eau, la plantation et l'entretien des terrasses pastorales des plantes et la lutte contre l'érosion hydrique et le vent.
- Mise en place d'un système de suivi et d'évaluation des processus de désertification utilisant la technologie de télédétection et intégration des systèmes d'information géographique dans le domaine commercial.
Le projet a été mis en œuvre entre 2003 et 2006. En plus des résultats positifs obtenus en termes d'atténuation et de réhabilitation des terres dégradées et de l'amélioration de la végétation et de l'augmentation de la productivité de la dégradation des terres, le projet a obtenu les succès suivants :
- Améliorer les conditions de vie de la population locale grâce à l'amélioration de la productivité des pâturages et à la génération de revenus grâce aux activités du projet.
- Identifier les procédures respectueuses de l'environnement et les technologies appropriées pour lutter contre la désertification et réduire la dégradation des terres.
- Sensibiliser les communautés et les décideurs préoccupés par les dangers de la désertification dans les systèmes humains et environnementaux.
- Améliorer les ressources en eau et les bases de données sur la végétation.
- Identifier les voies et moyens et les technologies pour améliorer la productivité des pâturages.
- Déterminer les procédures appropriées pour la collecte de l'eau et de le publier à nouveau.
Leçon apprise:
Il s'avère que ce peut être la ré-réhabilitation des terres pastorales que le pourcentage de la végétation couvre plus de 32% pourrait élever ce pourcentage à 80% après la réhabilitation.
- La diversité topographique dans les zones réhabilitées aide à une large application des procédures de récolte de l'eau.
- Les meilleurs moyens de récolter l'eau étaient les départements semi-circulaires et la forme des bassins de Maanah.
- La détérioration légère ou modérée des terres peut être réhabilitée moyennant une protection et peu d'interventions directes pour la réhabilitation.
- Il peut atténuer les pertes dues à l'érosion du sol en appliquant des routes d'entretien appropriées et les terrasses de montagne sont considérées comme l'entretien de ces routes.
- Il a été observé que les visites sur le terrain et les ateliers étaient des outils de base pour accroître la sensibilisation.
- Il a été noté que la formation des cadres nationaux et permettre la participation des mesures nécessaires pour soutenir l'emploi et de maintenir les résultats positifs des projets de lutte contre la désertification.
Propriétaire: Centre international de recherche agricole dans les zones arides Programme ICARDA
Contacts:
ACSAD - Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
00963-11-2266250 / 2266251
Zone géographique: Brésil, Chine, Inde, Corée du Sud
Domaines d'intervention thématiques soutenus par le mécanisme:
OMD 8 sur les partenariats mondiaux pour le développement; Comme dans toute la région arabe, l'autonomisation des jeunes est un défi croissant en Arabie Saoudite, avec environ 60% de la population de moins de 30 ans. Alors que des efforts locaux sont en cours pour améliorer les systèmes éducatifs et développer l'industrie créatrice d'emplois non pétroliers, un autre besoin est de permettre aux jeunes Saoudiens de devenir des citoyens connectés en partageant leurs expériences de développement et leurs leçons avec les partenaires du Sud émergent.
Le PNUD s'est associé à un projet d'échange Sud-Sud de jeunes par lequel de jeunes saoudiens et femmes ont visité leurs homologues du Brésil, de la Chine, de l'Inde et de la Corée du Sud en 2012 pour explorer des modèles d'emploi et de développement urbain. , économie verte, TIC pour le développement et génération de l'économie du savoir.
Phases / étapes de l'application pratique du mécanisme:
Le mécanisme d'échange de jeunes Sud-Sud repose sur un processus d'identification des priorités thématiques pour autonomiser les jeunes Saoudiens et les pays d'échanges concernés par des thèmes spécifiques, l'identification des jeunes hommes et femmes des régions du pays, un programme de formation rigoureux entreprendre une évaluation et un suivi pour saisir les leçons apprises et les moyens d'intégrer ces leçons dans les activités locales d'autonomisation des jeunes en Arabie Saoudite. Il a également impliqué un processus pour continuer à impliquer les jeunes du Sud en tant qu'anciens de l'initiative. L'échange est supervisé par un conseil de projet avec divers partenaires du gouvernement et du secteur privé qui fournissent des conseils, de l'assurance de la qualité et du financement.
Résultats à ce jour:
L'établissement a été un succès avec des notes positives des institutions saoudiennes et des partenaires d'accueil au Brésil, en Chine, en Inde et en Corée du Sud.
Les jeunes Saoudiens ont grandement bénéficié de l'exposition aux modèles de développement dans d'autres économies émergentes et ont commencé à appliquer les leçons apprises dans leur travail dans le Royaume. Il a servi de base à une nouvelle coopération potentielle Sud-Sud sur des questions spécifiques d'intérêt bilatéral entre les pays. Par exemple, dans le processus d'échange de jeunes Arabie Saoudite, axé sur le rôle des TIC pour le développement, a été présentée une idée novatrice de la plate-forme Internet pour les contributions des citoyens au développement mondial pour le développement. PNUD et le gouvernement.
Budget annuel le plus récent (USD): 500 000
Budget total (USD): 1 000 000
Point focal et contact:
Haïfa Al Mogrin
Associé de programme
PNUD Arabie Saoudite
Sites de l'ONU, quartier diplomatique, Riyadh 11614
Arabie Saoudite
Tél: + 966-1-4885301
Email: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.