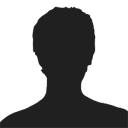Solutions SSDA
South-South Development Academy
Solutions SSDA
South-South Development Academy
Cartographier les solutions South-South Development Academy
Résumé
Mis en œuvre depuis 2007, le projet de coopération Sud-Sud en faveur du développement urbain au Mozambique vise à reproduire, de manière adaptée au contexte local, les politiques, méthodologies et pratiques brésiliennes élaborées par Caixa Econômica Federal (CAIXA) à l'intention des populations à faibles revenus. . Axé sur le thème du logement au sens large, le projet envisageait des activités de soutien dans différents domaines complémentaires, allant de la formulation de politiques et stratégies publiques à l’amélioration des techniques de construction traditionnelles.
Défi
L'un des principaux défis du Mozambique est de fournir des logements de qualité et en quantité à sa population (environ 26,5 millions d'habitants), d'autant plus que plus de 50% de cette population vit sous le seuil de pauvreté. En outre, 70% des Mozambicains vivent dans des zones rurales, avec un accès limité à des matériaux et technologies adéquats pour la construction de logements décents. Selon ONU-Habitat Mozambique, 84 000 nouveaux logements sont nécessaires chaque année dans les zones urbaines pour s'adapter à la croissance naturelle de la population et à l'exode rural, sans tenir compte qu'au moins 70% des logements urbains existants sont informels, avec des infrastructures d'accès précaires et des services de base.
Solution
Afin de réduire le déficit de logements au Mozambique, le projet d’appui au développement urbain couvrait des activités d’appui technique dans cinq domaines:
(1) Le développement d'une politique du logement visant les populations à faibles revenus (axe central de l'initiative);
(2) La production de matériaux de construction peu coûteux à base de matières premières disponibles localement, y compris la structuration de microentreprises associatives rurales (MERA) à cette fin;
(3) le développement de typologies constructives pour les logements d’intérêt social;
(4) la mise en place d'un système national d'indices et de coûts de construction; et
(5) L'élaboration de projets architecturaux pour la réforme d'un centre technologique dans le secteur de la construction civile.
Les activités se sont concentrées sur l'échange de professionnels pour le partage de connaissances entre les deux pays. Les visites techniques effectuées au Brésil ont été axées sur la connaissance des expériences et des principaux agents impliqués dans les cinq aspects du projet. Les visites au Mozambique comprenaient, entre autres, le diagnostic de la demande locale en logement (urbain et rural), les infrastructures et les ressources matérielles et technologiques existantes liées à la fourniture de logements, ainsi que la formation des techniciens responsables et du personnel rural. communautés concernées pour assurer la pérennité de l’initiative.
Les principaux résultats du projet incluent:
- L'approbation de la "Politique et stratégie du logement pour le Mozambique" en 2011 par le Conseil des ministres, dont les techniciens et les communautés ont assisté au développement, à travers des ateliers et des débats régionaux dans différentes provinces, ainsi qu'un séminaire national.
- Le transfert de connaissances (à travers deux sessions de formation et la préparation de manuels) sur la production de machines pour la fabrication de briques en terre-ciment et de tuiles en fibres végétales, des matériaux peu coûteux et adaptés à la réalité du Mozambique. Cette formation s’articule autour de l’installation d’un incubateur de coopératives populaires pour la production de matériaux de construction adaptés au Centre technologique de Namialo (province de Nampula), dont le personnel a également suivi une formation en gestion.
- La conception de cinq projets de logement à faible revenu: trois pour les zones rurales, un pour les zones urbaines et suburbaines et un pour les personnes ayant des besoins spéciaux.
- L’établissement de bases et de partenariats pour la création du système de suivi des coûts de la construction civile mozambicain (SINAGEC), reproduit à partir du Système brésilien d’enquête sur les coûts et les indices de la construction civile (SINAPI).
- L’élaboration des projets architecturaux de rénovation et d’agrandissement du Centre technologique de Namialo, qui seront orientés vers la recherche et la formation dans le domaine des technologies constructives adaptées à la réalité locale (en articulation avec les activités du Laboratoire d’ingénierie du Mozambique), cherchant à renforcer les MERA dans la province.
Ce projet de coopération Sud-Sud était l’une des initiatives récompensées dans le cadre de l’édition 2013/2014 du programme Meilleures pratiques de gestion locale CAIXA, qui reconnaît et diffuse tous les deux ans des expériences réussies dans le domaine social, menées avec financement, transfert de ressources ou soutien. de CAIXA.
Soutenu par: l'Agence de coopération brésilienne (ABC) et la Caixa Econômica Federal (CAIXA)
Agence de mise en œuvre:
Du côté brésilien: CAIXA, Université de São Paulo (USP), Université d'État de Campinas (UNICAMP), Université fédérale de Rio de Janeiro (UFRJ) et Université fédérale de Rio Grande do Sul (UFRGS)
Du côté mozambicain: Ministère des travaux publics et du logement
Contact:
Fernando Vieira do Nascimento,
Directeur exécutif, Gestion nationale de la stratégie des relations internationales,
Caixa Econômica Federal (CAIXA)
Courriel: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Résumé
Ce projet de coopération entre le Brésil et le Cap-Vert visait à élaborer conjointement une étude de faisabilité économique dans les domaines de l'artisanat et de la collecte et du recyclage des ordures ménagères dans la ville de Praia, afin de favoriser la génération de travail et de revenus, professionnalisation des segments défavorisés de la population capverdienne. Le travail a été développé sur la base des concepts et principes de l'économie solidaire et du coopérativisme, suivant une structure similaire aux entreprises brésiliennes liées à l'association UNISOL, afin de favoriser un développement à la fois durable sur le plan de l'environnement et socialement juste.
Défi
Cidade da Praia, qui concentre environ 30% de la population cap-verdienne, a identifié la collecte et le recyclage des ordures ménagères comme deux points stratégiques d'une organisation difficile. Les ordures ménagères ne sont pas triées et leur destination n’est pas planifiée, en raison de l’absence d’une chaîne de recyclage correctement mise en place. De même, les alternatives de survie décentes pour les personnes vivant dans des zones de décharge, dans des conditions insalubres et inhumaines, la collecte de restes de nourriture (pour nourrir les cochons) et de matériaux recyclables ne sont pas encouragées.
Une autre zone défavorisée du Cap-Vert est l'artisanat local. La ville de Praia n’a pas d’identité propre en matière de vêtements faits à la main (à base de céramique, de tissage, de pierres, de bois, de coquillages, de crochets et de broderies) et de nombreux produits importés sont maintenant commercialisés. L'artisanat peut être une source importante de préservation de la culture et de l'histoire locales, mais il est nécessaire d'améliorer la qualité et la valeur ajoutée de la production, notamment grâce à l'utilisation de matières premières locales.
Pour que les secteurs de l'artisanat local et du recyclage des ordures puissent se développer de manière cohérente et durable, tout en promouvant la création de travail et de revenus pour la population, ainsi que la préservation de l'environnement, il était nécessaire d'élaborer une étude spécifique. qui a énuméré des actions et des activités de structuration.
Solution
Organisé entre 2011 et 2015, le projet visait à préparer une étude de faisabilité pour les secteurs de l'artisanat et du recyclage des déchets dans la ville de Praia, fondée sur les principes de l'économie solidaire et du coopérativisme. L'étude s'est concentrée sur le développement d'une méthodologie de structuration des actions pour: (1) cartographier le formatage des chaînes de production dans les secteurs cibles; (2) évaluer l'application des technologies sociales; (3) identifier et encourager la participation des leaders de la communauté; et (4) soutenir les groupements de solidarité économique potentiels.
L'étude était basée sur des échanges entre les deux pays. Au début, une équipe d’UNISOL composée de représentants des secteurs du recyclage et de l’artisanat était à Praia pour des contacts et la collecte d’informations. Dans le domaine de l'artisanat, un diagnostic des artisans locaux (environ 50) a été réalisé de manière participative, identifiant leur profil socio-économique, leurs besoins et leurs priorités. Cette activité a abouti à la préparation conjointe d'une version préliminaire d'un projet de renforcement du secteur. Dans le domaine du recyclage, après une visite à la décharge de la ville de Praia, un diagnostic a été posé sur le potentiel de la chaîne de recyclage, avec des éboueurs (80 personnes au total), dans le but de développer des solutions pour transformer la réalité locale. . Une évaluation a également été réalisée sur les matériaux potentiellement recyclables et sur les produits à fabriquer et commercialiser, ainsi que sur l’investissement nécessaire et le retour financier de l’initiative.
À son tour, une délégation capverdienne a visité les expériences brésiliennes d'entreprises liées à UNISOL, telles que des coopératives d'artisanat et de recyclage des déchets (y compris des projets sociaux avec des éboueurs) et d'autres initiatives locales dans le contexte de l'économie solidaire. Les représentants du Cap-Vert ont également participé à la "FENÉARTE", ont participé à des réunions avec des artisans et se sont rendus dans une décharge et une usine à Osasco pour découvrir un exemple de transformation de matériau recyclable.
L'étude de faisabilité a été finalisée en 2015, indiquant les initiatives pouvant être mises en œuvre par l'administration locale de la ville de Praia, ainsi que les moyens et les étapes nécessaires pour le faire. Les propositions incluent, entre autres, une stratégie de commercialisation des produits d'artisanat impliquant le ministère de la Culture de Cap-Vert et le "Forum national de l'artisanat" ("FONARTES"), afin de permettre de meilleures conditions de commercialisation et de générer des revenus dans ce domaine. secteur. La mise en place d’une unité de traitement des bouteilles en PET prévoyant l’acquisition de matières premières recyclables, à des prix équitables, entre les mains des collecteurs, était également prévue pour la fabrication de balais et d’autres produits.
Supporté par:
Du côté brésilien: Agence de coopération brésilienne (ABC);
Du côté du Cap-Vert: ministère des Affaires étrangères
Agence d’exécution: Centrale des coopératives et entreprises de solidarité du Brésil (UNISOL Brésil) et mairie de Praia
Contact:
Isadora Candian dos Santos,
Directeur-trésorier,
UNISOL Brésil
Email: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Résumé
Entre 2009 et 2011, ce projet de coopération trilatérale (impliquant le Brésil, São Tomé e Príncipe et la Communauté des pays de langue portugaise - CPLP) visait à contribuer au développement socio-économique de São Tomé e Príncipe en créant des emplois et des revenus dans le secteur de l'artisanat. Axé sur la création de produits artisanaux de haute qualité inspirés de la culture locale et des caractéristiques naturelles du petit archipel africain, le projet a abouti à la création de la coopérative Uê Tela ("Regarde la terre"), qui réunit des artisans qualifiés et apprentis dans le cadre du projet.
Défi
La création d'emplois et de revenus et l'inclusion sociale, en particulier des jeunes et des femmes, constituent des défis importants pour le développement socio-économique de São Tomé et Príncipe. À l'instar d'autres petits États insulaires en développement, São Tomé e Príncipe a une économie fragile, limitée et peu diversifiée. actuellement, plus de 90% des dépenses d'investissement dans le pays proviennent de l'aide publique au développement. Le secteur tertiaire en grande partie informel représente environ 60% du PIB et emploie 60% de la population active (le secteur public étant le principal employeur du pays). Dans le même temps, le chômage, avec un taux de 14%, touche principalement les femmes et les jeunes (plus de 60% de la population a moins de 25 ans). Environ 50% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté et environ 15% dans une pauvreté extrême.
Par ailleurs, il a été constaté que la production d’artisanat de San Francisco, en plus de souffrir de sa faible valeur ajoutée et de son manque de professionnalisme, ne présentait pas de différence particulière par rapport à ce qui se faisait traditionnellement sur le continent africain et manquait de liens. aux marchés de consommation externes.
Solution
Les principaux objectifs du projet étaient de fournir une formation et des améliorations techniques pour la création et le développement de produits artisanaux représentatifs de l'identité culturelle du pays. Le projet, qui visait principalement les artisans et les apprentis (principalement des jeunes femmes et des femmes), visait à leur procurer de nouvelles sources de revenus, en redynamisant la production artisanale destinée à la consommation intérieure et à l’exportation.
Avec la participation de designers et d’artisans brésiliens et santoniens, le projet comportait trois phases:
(1) la formation d'artisans et d'apprentis à la fabrication d'objets d'artisanat, en particulier dans les domaines de la broderie, de la teinture de plantes, du papier, de la menuiserie, de la sculpture et de la couture. Cette étape a mis l'accent sur la qualité technique et l'originalité des pièces produites, en insistant sur l'utilisation de matières premières et de motifs locaux dans la conception des produits. Cela incluait également l'organisation de groupes d'artisans (également formés à l'entrepreneuriat social), en tenant compte de leurs vocations;
(2) formation aux axes complémentaires de gestion, marketing, communication et préservation de l'environnement. Cette étape comprenait également l’acquisition de machines et d’équipements pour les ateliers de formation (ainsi que la formation de techniciens pour leur entretien et leur réparation) et la formation d’instructeurs locaux aux diverses techniques mises au point, qui ont par la suite assumé le rôle de multiplicateurs; et
(3) l'élaboration de matériel promotionnel et d'activités de diffusion, principalement axées sur le marché étranger.
Les résultats concrets de l'initiative comprennent:
- la formation d'environ 150 artisans et apprentis de tout le pays à la production d'artisanat compétitif et de racines culturelles;
- la création d'une structure de gestion partagée associant les chefs d'atelier, les coordinateurs locaux, la coordination générale de la conception et la coordination des styles;
- l'élaboration d'un manuel de procédures relatif aux axes complémentaires du projet, soutenant la qualité de la production et la consolidation de l'initiative;
- la formation de la coopérative Uê Tela par les artisans formés, afin de poursuivre le projet et d'assurer sa durabilité. Installée à l'Institut de la jeunesse (dans la capitale, São Tomé), la coopérative disposait d'un support technique pour démarrer ses activités et travaille actuellement de manière autonome.
- le lancement de deux collections de produits artisanaux (objets de décoration, meubles, articles en papier fabriqués à partir de troncs de banane, tissus de coton teints à l'aide d'écorce, vêtements et accessoires de mode): "Fédu cu Món" à la main ") et" Modo Fenón "( «notre façon de faire»), publié au moyen de catalogues bilingues (en portugais et en anglais); et
- la mise en place de circuits de distribution et de marketing: un magasin social à São Tomé e Príncipe, ainsi que des ventes à l'étranger (certains produits sont commercialisés au Brésil).
L’activité artisanale favorisée par le projet est déjà devenue le principal moyen de subsistance de la plupart des artisans coopératifs (en particulier les femmes). Lors de son approbation par la CPLP en 2011, cette initiative était un projet pilote qui, en fonction de ses résultats, pourrait être étendu à d'autres pays lusophones. Ainsi, l'Angola et le Cap-Vert ont déjà manifesté leur intérêt pour la réplication de l'expérience de coopération Sud-Sud dans le domaine de la production artisanale.
Soutenu par: l'Agence de coopération brésilienne (ABC), la CPLP et le gouvernement de São Tomé et Príncipe
Agence d'exécution:
Du côté brésilien: Instituto Mazal
Du côté de santomense: Institut de la jeunesse (ministère de la Jeunesse et des Sports)
Contact:
Renato Imbroisi,
Associé, Instituto Mazal
Email: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Résumé
Exécuté entre 2010 et 2016, le projet de centre de formation professionnelle Brésil-São Tomé e Príncipe (CFP BRA-STP) est le fruit d'un partenariat entre l'Agence de coopération brésilienne (ABC) et le Service national de l'apprentissage en industrie (SENAI) pour la diffusion de Expérience réussie du SENAI au Brésil en matière de formation professionnelle pour jeunes et adultes et de gestion d'écoles professionnelles. Implanté dans la capitale de São Tomé, le CFP BRA-STP répond aux demandes de main-d'œuvre qualifiée de Santander.
Défi
À São Tomé et Príncipe, environ 50% de la population vit sous le seuil de pauvreté et environ 15% dans une pauvreté extrême. Le secteur tertiaire (principalement informel) représente environ 60% du PIB et emploie 60% de la population active. En revanche, avec un taux de 14%, le chômage touche particulièrement les jeunes, qui représentent plus de 60% de la population nationale. Les carences du pays en matière de formation professionnelle sont un facteur qui alimente un cercle vicieux entre pauvreté et inégalité sociale, défavorisant le développement socio-économique. La faible qualification de la population active de São Tomé est confrontée au manque d'offre de formation professionnelle, ce qui pourrait contribuer à accroître la compétitivité des entreprises locales et à générer davantage d'offres d'emploi. Afin de fournir une main-d'œuvre qualifiée dans le secteur des services et l'industrie naissante (principalement dans le secteur de la construction), le gouvernement de São Toméan s'est déclaré intéressé par la création d'un centre de formation professionnelle de référence permettant aux jeunes et aux adultes de recevoir une formation leur permettant de marché de l'emploi.
Solution
Le projet du Centre de formation professionnelle Brésil - São Tomé et Príncipe (CFP BRA-STP) avait pour objectif de contribuer au développement socioéconomique de São Tomé et Príncipe en offrant un enseignement professionnel, notamment aux jeunes en quête d'un premier emploi. Le projet comprenait la construction dans la ville de São Tomé du bâtiment abritant le BRP-STP, ainsi que sa structuration technico-pédagogique, en termes de définition de l'offre de formation, de formation des ressources humaines (instructeurs et gestionnaires du Centre) et la fourniture de matériel didactique, de mobilier et d’équipements nécessaires à son fonctionnement. Outre la formation dispensée par les instructeurs du SENAI à São Tomé et Príncipe, une partie de l'équipe SANTOMEN qui devait travailler au Centre a été formée dans les écoles techniques du SENAI Pernambuco, dans des domaines couverts par les cours du CFP BRA-STP. . Après avoir cédé le terrain et construit une partie des installations du Centre, le gouvernement de São Tomé-Tom s'est activement impliqué dans la définition des cours proposés: construction civile, électricité, travail des métaux, soudage, mécanique des automobiles et des motocycles, transformation des aliments et informatique.
Inauguré en 2014, le CFP BRA-STP est composé de 6 salles de classe (pouvant accueillir chacune 30 personnes), d'une salle polyvalente (jusqu'à 60 personnes), de 3 laboratoires (informatique, hydraulique et alimentaire), de 5 ateliers, de mécaniciens de motos, électricité, construction et soudure), un auditorium (jusqu’à 100 personnes) et une bibliothèque, ainsi que des installations administratives et de soutien. Au total, le CFP BRA-STP a la capacité de former jusqu'à 800 étudiants par jour. Les résultats du projet incluent également:
- l'élaboration du plan stratégique de la PCP BRA-STP;
- mise en œuvre de la gestion partagée de la PCP BRA-STP (dont la responsabilité incombait au gouvernement santoméen); et
- effectuer des missions d'évaluation et de suivi.
Depuis son inauguration, le CFP BRA-STP a déjà formé plus de 1 250 étudiants. Le succès de cette initiative a conduit le SENAI à être reconnu par les Nations Unies comme l'une des trois institutions les plus importantes qui promeuvent une éducation de qualité dans l'hémisphère sud. Outre São Tomé et Príncipe, le SENAI a participé (ou est toujours) impliqué avec ABC et les gouvernements locaux à la mise en place et / ou à la restructuration de centres de formation professionnelle en Angola, au Cap Vert, au Guatemala, en Guinée Bissau, en Jamaïque, au Paraguay, au Pérou et en Afrique. Timor-Leste.
Supporté par:
Du côté brésilien: Agence de coopération brésilienne (ABC);
Du côté de Santorin: Ministère de l'éducation, de la culture et des sciences
Agence de mise en œuvre: Service national d'apprentissage industriel (SENAI)
Contact:
Marconi Firmino da Silva,
Coordinateur de projet,
SENAI Pernambouc
Email: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Résumé
Le réseau des instituts nationaux de santé publique de la Communauté des pays de langue portugaise (RINSP-CPLP) a été officiellement constitué en 2011 à Bissau pour renforcer les instituts de santé nationale (INS) en tant qu'entités structurantes des systèmes de santé publique de ses États membres, en termes de capacité de réponse et de proposition de solutions stratégiques. Ancré dans la CPLP, le réseau a son secrétariat exécutif basé par la Fondation Oswaldo Cruz (Fiocruz / ministère brésilien de la Santé) et suit une approche de coopération structurelle entre pays en développement qui privilégie l'utilisation des capacités et des ressources endogènes de chaque pays (par opposition au transfert unidirectionnel). des connaissances et des technologies). Ainsi, des interventions concrètes pour générer des connaissances sont promues en même temps que le dialogue entre les partenaires impliqués, afin de permettre aux agents locaux de prendre la tête des processus du secteur de la santé de chaque pays et de formuler leurs propres agendas de manière indépendante. développement dans ce domaine.
Défi
Les instituts nationaux de santé, souvent issus d'anciens laboratoires nationaux de santé publique, sont des exemples de recherche, de formation, de suivi, d'évaluation et de génération de preuves en vue d'améliorer les politiques de santé publique (qui ont généralement un caractère plus permanent que les autorités de santé). Ainsi, la création et / ou la consolidation de ces instituts dans les pays africains est essentielle pour le renforcement de leurs systèmes de santé nationaux, d'autant plus qu'ils ont pour rôle de gérer les ressources allouées à la santé publique et d'appuyer la formulation de politiques dans ce secteur. Le défi consiste donc à bien former les SIN africains, notamment en ce qui concerne leur champ d’action et le développement des compétences humaines disponibles. Les institutions nationales sont en fait des organes techniques stratégiques considérés comme le principal moyen de surmonter les problèmes de santé publique à long terme de manière structurelle.
Solution
Suivant une approche intégrée des questions de santé publique, le RINSP-CPLP est l’un des réseaux d’institutions structurantes défini dans le "Plan stratégique de coopération en matière de santé" de la CPLP. Ce réseau a pour objectif de promouvoir la coopération technico-scientifique entre ses membres afin de: (1) améliorer la qualité des connaissances scientifiques sur les déterminants sociaux de la santé; (2) soutenir techniquement les ministères en matière de surveillance épidémiologique, sanitaire et environnementale; et (3) améliorer les politiques de santé publique basées sur les connaissances scientifiques. À cette fin, la coopération dans le cadre du RINSP-CPLP a été axée sur la formation des ressources humaines dans les domaines biomédical et de la santé publique, ainsi que sur le renforcement organisationnel et le développement institutionnel. Les activités menées dans ces domaines comprennent: des ateliers de planification stratégique, des visites de conseil et d'analyse comparative, des cours de troisième cycle, une formation en cours d'emploi et une formation polytechnique en santé. La mise en œuvre des SIN dans les États membres de la CPLP qui n'en disposent pas encore est l'un des domaines d'action prioritaires du réseau.
Dans le cadre de ses initiatives, RINSP-CPLP a promu au Mozambique la révision du plan stratégique de l’INS, le soutien à la construction du nouveau bâtiment institutionnel, les masters en sciences de la santé (déjà dans sa quatrième édition) et en systèmes (avec l’appui du Centre de recherches pour le développement international - CRDI), la reformulation de la revue scientifique INS et la mise en place de l’Observatoire national de la santé, entre autres. Il a également obtenu une maîtrise en santé publique pour la formation de professionnels de l'École de santé publique de l'Angola et a contribué à la réorganisation des écoles techniques de santé dans ce pays. Avec le soutien du RINSP-CPLP, l'INASA de Guinée-Bissau a été créé en 2010 (notamment en soutenant la formulation et l'évaluation de son plan stratégique et l'amélioration des laboratoires de référence dans le pays) et l'INSP du Cap-Vert en 2014 (après des missions au pays de Fiocruz et de l’Institut d’Hygiène et de Médecine Tropicale du Portugal, et d’une mission cap-verdienne auprès de l’INS du Pérou et de Fiocruz, qui a servi de référence à l’institution africaine). À son tour, l'INSP du Cap-Vert récemment créé fera partie d'une mission de Fiocruz à São Tomé e Príncipe visant à soutenir la création de l'INS de ce pays.
RINSP-CPLP mène également des actions liées à la collecte de fonds auprès d'entités internationales afin de tirer parti du développement de l'INS de ses membres. En raison de ses répercussions sur la visibilité des SIN africains, le réseau permet d'articuler des sources de financement externes avec la CPLP, par exemple l'Association internationale des instituts nationaux de la santé (IANPHI) et le CRDI. Le réseau encourage également l'articulation des SIN africains avec des agences similaires afin de mener des initiatives de recherche et de formation communes.
En général, les institutions nationales des pays africains du réseau ont acquis une plus grande importance stratégique et scientifique auprès de leurs ministères de la santé respectifs. Ainsi, reconnaissant le développement constaté à l'INS du Mozambique, il a reçu en 2016 des missions du Malawi et de la Sierra Leone souhaitant connaître son organisation.
Soutenu par: la CPLP, l'Agence de coopération brésilienne (ABC), la Banque mondiale, l'IANPHI, les ministères de la santé du Brésil et les pays participants du RINSP-CPLP
Agence d’exécution: Fiocruz / Ministère de la Santé du Brésil
Contact:
Felix Rosenberg,
Secrétaire exécutif du RINSP-CPLP,
Fondation Oswaldo Cruz (Fiocruz / Ministère de la Santé)
Email: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
La criminalité liée aux espèces sauvages, les conflits entre humains et espèces sauvages, la limitation des mouvements d'animaux sauvages, la gestion des incendies et l'utilisation erronée des terres font partie des problèmes les plus pressants en Namibie et dans ses quatre pays voisins: l'Angola, le Botswana, la Zambie et le Zimbabwe.
La Namibie a récemment lancé son cinquième plan de développement national (NDP 5) en 2017. Le NDP 5 encourage la collaboration avec les voisins de la région sur des défis environnementaux communs.
En réponse aux défis à relever, les 5 pays ont formellement convenu de créer une zone de conservation transfrontalière (TFCA), appelée zone de conservation transfrontalière Kavango-Zambezi (KAZA TFCA), qui vise à renforcer leurs capacités à traiter conjointement les problèmes actuels. problèmes.
D'une superficie de plus de 520 000 km2, la KAZA TFCA est la plus grande aire de conservation transfrontalière au niveau mondial. Elle regroupe cinq (5) pays partenaires: l'Angola, le Botswana, la Namibie, la Zambie et le Zimbabwe, qui visent à préserver l'intégrité écologique de plusieurs -utiliser le paysage. KAZA TFCA est riche en biodiversité et abrite la plus grande concentration d'éléphants au monde. Il comprend plus de 20 parcs nationaux, 85 réserves forestières, 22 réserves naturelles, 11 sanctuaires, 103 zones de gestion de la faune et 11 zones de gestion du gibier.
À l'heure actuelle, les principaux problèmes auxquels sont confrontés les TFCAs de KAZA, en particulier du côté namibien, sont les suivants: braconnage, conflit homme-faune, brûlages excessifs, circulation restreinte de la faune le long de la frontière entre le Botswana et la Namibie, manque d'informations précises et détaillées sur l'utilisation des terres pour la faune. Zones de dispersion (WDA) et infrastructure transfrontalière limitée.
De nombreuses communautés de la KAZA TFCA dépendent fortement des ressources naturelles (terres, rivières et forêts) et de leurs moyens de subsistance. L'accès à ces ressources est toutefois limité et, en Namibie en particulier, les communautés se sentent limitées par l'utilisation des terres. Cette situation exacerbe leur vulnérabilité aux impacts de la faune et menace le succès de la conservation, poussant souvent les gens à se tourner vers des activités illégales telles que le braconnage.
Les éléphants, en particulier, qui sont perçus comme l'une des plus grandes menaces pour la vie humaine, bien que des incidents se produisent rarement, sont menacés par des niveaux alarmants de braconnage. Cela est dû à la valeur élevée de l'ivoire, qui fait l'objet d'une forte demande dans les pays asiatiques. Le problème est encore exacerbé par le lien étroit qui unit les pays voisins au sein de la KAZA transfrontalière, car il y aurait des syndicats organisés associés à d'autres pays. Dans l’ensemble, le braconnage des éléphants constitue une menace assez grave pour la Namibie en tant que pays, notamment en raison du manque de sensibilisation à leur valeur, de la nécessité de les conserver et de l’impact que le braconnage a sur eux.
Cible (s) de SGD:
Le cinquième plan de développement national de la Namibie (NDP 5), récemment lancé, souligne l'interdépendance de tous les efforts en faveur de la progression économique, de la transformation sociale, de la durabilité environnementale et de la bonne gouvernance et encourage la collaboration avec les voisins de la région. Au cours des dernières années, plusieurs solutions transfrontalières ont amélioré l'attitude souvent négative des communautés à l'égard de la faune et de sa conservation:
Tournée KAZA Excellency: La tournée KAZA Excellency devrait constituer un important effort de collaboration en matière de croissance économique, de préservation de la culture, de création d'emplois et de durabilité de l'environnement dans la région, le continent et la communauté mondiale. En Namibie, les avantages de la visite pourraient avoir un impact positif sur les efforts de conservation, l’environnement et l’écotourisme dans le pays. Le circuit KAZA Excellency sera officiellement ouvert au public en février 2018.
La tournée a été officiellement lancée en novembre 2017:
Mme Kiki Gbeho, Coordonnatrice résidente des Nations Unies et Représentante résidente du PNUD en Namibie, accompagnait une délégation de 7 ambassadeurs accrédités en Namibie, accusations de l'Angola et de la Libye, la Directrice générale du Nord-Ouest, Mme Zelna Hengari et la vice-ministre des Relations internationales, Maureen Hinda, à participer à une excursion de six jours. Réalisée dans le cadre de la coopération Sud-Sud, la délégation a rencontré ses homologues sur le terrain transfrontalier. Ils ont échangé des idées sur l'utilisation durable de la biodiversité et de la culture afin de maximiser les avantages touristiques, en mettant l'accent sur l'accès et le partage des avantages, en particulier pour les régions éloignées de l'Afrique australe, et sur la manière de promouvoir des partenariats pour le développement du tourisme conformément aux ODD.
Le lancement a également complété les efforts visant à commémorer l'Année internationale du tourisme durable 2017 (Année 2017) et, grâce à ses personnalités féminines, a finalement constitué le cadre idéal, à la hauteur des 10 ambassadeurs spéciaux de l'année 2017, notamment de Son Excellence Ellen Johnson, ancienne Président du Libéria.
Plan directeur de développement intégré (MIDP) de KAZA TFCA: Mis en œuvre par les cinq pays de la région, ce plan fournit des orientations stratégiques pour le développement du KAZA TFCA au niveau régional, sur une période de 5 ans, à savoir de 2015 à 2020. atteint grâce à: 1) la conservation et la gestion durables des ressources naturelles transfrontalières; 2) promotion de l'harmonisation des politiques, stratégies et pratiques en matière de gestion des ressources naturelles partagées dans le paysage de la KAZA TFCA; 3) prévoir le développement d'infrastructures permettant l'intégration économique, notamment la promotion des produits touristiques régionaux transfrontaliers et des investissements du secteur privé; et; 4) fournir des avantages aux communautés locales à l'intérieur et à proximité des zones de conservation clés de la KAZA TFCA à travers le développement du tourisme et la protection des ressources naturelles et culturelles.
Projet de renforcement du système d'aires protégées (PASS): Le projet PASS est un projet du ministère de l'Environnement et du Tourisme (MET). Mis en œuvre par le PNUD, le projet a pour objectif d'aider la société à faire face aux nouveaux défis qui affectent la gestion des zones protégées (AP). L’objectif de ce projet est de veiller à ce que le système de zones protégées de la Namibie soit renforcé et financé de manière durable par le biais de l’amélioration des systèmes actuels d’accès aux parcs et des mécanismes de génération de revenus, des stratégies d’application de la loi et des mécanismes de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages (en particulier le braconnage ), ainsi que la gestion des incendies dans les zones protégées.
- Avec l’appui du projet PASS, MET a / a pris les mesures suivantes: • Protéger les espèces d’éléphants de grande valeur contre le braconnage dans le parc national de Bwabwata et ses environs grâce à des patrouilles anti-braconnage continues et à des activités de sensibilisation.
- S'associe à la police namibienne (NAMPOL) et au ministère de la Défense pour lutter contre le braconnage dans des endroits réputés pour le braconnage, notamment le parc national Bwabwata, qui abrite une importante population d'éléphants.
- Élaboration d'une stratégie nationale de gestion des incendies pour les zones protégées, en tant que cadre général pour la gestion des incendies dans les aires protégées de Namibie.
- Procédures opératoires normalisées (SOP) spécifiques à la zone protégée pour la gestion des feux. L'élaboration de SOP pour les deux (2) premiers PA a déjà commencé.
Gestion communautaire des ressources naturelles (CBNRM):
En Namibie, la gestion de la faune et de la flore sauvages n'est pas seulement une priorité dans les AP, mais aussi au-delà de ses limites. La proclamation des AP et la gestion de la faune en Namibie sont guidées par l'ordonnance n ° 4 de 1975 sur la conservation de la nature. Cette ordonnance a été modifiée en 1996, de sorte qu'elle transfère les droits des communautés sur la protection de la faune, tout en temps donnant des avantages économiques.
Conformément à l'ordonnance, une autorisation écrite est nécessaire pour chasser dans les zones protégées et sur les terres communales.
Bien que les dispositions de l'ordonnance soient souvent ignorées, en raison de la valeur économique de l'ivoire d'éléphant, les communautés s'efforcent de protéger les espèces sauvages dans leurs zones communales, y compris les éléphants, dans le cadre des systèmes de ressources naturelles à base communautaire (CBNRM).
Des rapports ont révélé que divers systèmes de gestion communautaire de la biodiversité et des ressources naturelles ont été couronnés de succès en Namibie, ce qui a conduit à l'enregistrement de davantage de conservances dans la région du Zambèze en Namibie, qui fait partie de la KAZA TFCA.
Résumé
Mis en œuvre entre 2014 et 2017, ce projet de coopération Sud-Sud visait à encourager l'augmentation de la production alimentaire au Botswana par le développement du coopérativisme et de l'associativisme rural. Financé par l'Agence brésilienne de coopération (ABC) et géré par l'Organisation des coopératives brésiliennes (OCB) avec l'appui technique de la Société brésilienne de recherche agricole (EMBRAPA), le projet avait un caractère pilote et était axé sur les producteurs de légumes.
Défi
Sur les deux millions d’habitants du Botswana, 39% vivent dans des zones rurales; Cependant, la grande majorité du territoire (85%) est couverte par le désert du Kalahari. Avec une économie fragile et une production agricole peu diversifiée, le pays est fortement dépendant des importations de produits alimentaires. Par exemple, les importations de légumes représentent 75% de tous les aliments consommés au niveau national, ce qui en fait un secteur stratégique pour la question de la sécurité alimentaire. En ce sens, le gouvernement du Botswana a cherché à encourager les producteurs locaux à s'organiser en coopératives afin de mieux gérer les problèmes rencontrés individuellement, tels que le stockage et le transport de la production. Les agriculteurs peuvent ainsi devenir plus compétitifs et coopérer pour faire baisser les prix des aliments de base au consommateur final.
Solution
Le projet de renforcement du coopérativisme et de l’associativisme rural au Botswana visait à diffuser le modèle coopératif de promotion du développement agricole dans le pays. La dimension coopérative comprend l'acquisition de connaissances appropriées pour la gestion partagée et participative des entreprises, l'orientation commerciale et la capacité organisationnelle des producteurs. Ces connaissances visent à donner aux agriculteurs une autonomie en matière de gestion et des possibilités de gestion créatives et durables, ainsi que la représentativité et la légitimité auprès du marché et du pays.
Le partage de l'expérience brésilienne en matière de coopérativisme impliquait des visites techniques et une formation selon deux axes principaux: l'autonomisation des producteurs familiaux et des dirigeants des communautés rurales pour qu'ils agissent en tant que multiplicateurs du modèle coopératif, et la sensibilisation des représentants des organismes de réglementation à la pratique de la le coopérativisme dans la formulation des politiques publiques. Avec la collaboration du gouvernement du Botswana, les producteurs ayant un profil de coopérative - c'est-à-dire les experts du marché et les principales difficultés rencontrées pour de telles entreprises - ont été identifiés et, après cette cartographie, des plans de travail et d'activité ont été élaborés pour le secteur de l'horticulture. Les réunions de travail ont également impliqué des organisations de la société civile telles que l'Association des coopératives du Botswana (BOCA), le Centre de formation des coopératives du Botswana et le Marché central de Gaborone.
Au Botswana et au Brésil, la formation a bénéficié à 43 personnes (y compris des agents de l’État et des producteurs de fruits et légumes) axées sur la planification, la formation et la gestion de coopératives, et menée en partenariat avec EMBRAPA Hortaliças). Également au cours de la période de formation, les agriculteurs de la communauté du Nord-Kweneng ont décidé de créer leur propre coopérative, qui servira de modèle à suivre dans d'autres régions du pays. Enregistrée en novembre 2015, la coopérative d'horticulture de North Kweneng, qui compte actuellement 14 familles, est soutenue par le ministère de l'Agriculture du Botswana et dispose déjà de toute la documentation nécessaire pour fournir de la nourriture aux programmes sociaux des gouvernements locaux.
Soutenu par: Agence de coopération brésilienne (ABC)
Agence d'exécution:
Du côté brésilien: Organisation des coopératives brésiliennes (OCB) et Société brésilienne de recherche agricole (EMBRAPA)
Du côté botsuanais: Ministère de l'agriculture
Contact:
João Marcos Silva Martins,
Analyste en relations institutionnelles,
Organisation des coopératives brésiliennes (OCB)
Email: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Résumé
Le projet Solidarity Literacy a soutenu les efforts de São Tomé e Príncipe visant à réduire l'analphabétisme et à élargir les possibilités d'éducation pour les jeunes et les adultes, en aidant à formuler des politiques et programmes publics d'alphabétisation initiale et à développer du matériel pédagogique adapté aux besoins et au contexte local. Cette initiative s’appuie sur l’expérience réussie de l’ONG AlfaSol au Brésil (où 5,6 millions d’étudiants ont été accueillis depuis 1997), désormais reconnue au niveau international (en particulier par l’UNESCO).
Défi
En 2001, environ 30% des habitants de São Tomé e Príncipe ne savaient ni lire ni écrire. En dépit des répercussions négatives individuelles et collectives de l’analphabétisme (en particulier en termes d’exclusion sociale, économique et politique), le pays n’a pas de politique officielle ni d’offre publique d’éducation pour les jeunes et les adultes (personnes du même âge ou plus que les hommes). 15 ans).
Solution
Le projet Solidarity Literacy a été mis en œuvre entre 2001 et 2011 à São Tomé et Príncipe, à partir d'une demande initiale du ministère de l'Éducation de São Tomé et Príncipe, dans le but de promouvoir l'éducation des jeunes et des adultes. Avec la réduction des taux d'analphabétisme et l'augmentation de la scolarisation mondiale, l'objectif était de contribuer à l'expansion de l'autonomie personnelle de la population jeune et adulte, en intégrant les compétences en mathématiques et la lecture et l'écriture du portugais aux personnes et aux communautés de la vie quotidienne.
Un premier diagnostic du contexte éducatif de la population jeune et adulte a été réalisé par les équipes techniques Santana et AlfaSol, sur la base d’indicateurs officiels, d’une enquête sur les actions préexistantes et d’une analyse de l’environnement socio-économique et culturel des localités. Sur la base de ce diagnostic, les équipes techniques ont élaboré une première proposition de travail mettant en avant des thèmes et des actions prioritaires pour la construction du processus de formation continue des jeunes et des adultes.
Tenu en étroite collaboration entre AlfaSol et la coordination technique de São Francisco, le projet a été articulé autour des principaux domaines d’activité suivants:
- soutien à la formulation de politiques publiques, de législations, de projets pilotes et de programmes d'alphabétisation initiale et d'éducation des jeunes et des adultes;
- sélection et formation initiale et continue des coordinateurs et des alphabétiseurs de Sant'Emencian;
- Identification au Brésil de spécialistes d'établissements d'enseignement supérieur, de centres de recherche et d'ONG, en vue de préparer une proposition initiale de processus de formation et d'agir en tant que formateurs;
- mobilisation et inscription des étudiants en alphabétisation dans l'ensemble de São Tomé e Príncipe;
- amélioration de la connaissance de l'équipe de gestion des programmes locaux, couvrant la formation sur site et les stages techniques au Brésil;
- des séminaires d'échange d'expériences et de discussions sur les politiques éducatives et le développement des possibilités d'éducation offertes aux jeunes et aux adultes;
- soutien à l'élaboration de cours et de matériels didactiques adaptés à la réalité du pays;
- formation à la méthodologie d'articulation des partenariats et de levée de fonds, mobilisation de la société, suivi et évaluation des processus éducatifs.
Entre 2001 et 2011, le projet a formé 110 enseignants et mis au service de plus de 21 000 jeunes et adultes illettrés ou peu instruits et a contribué à la réduction du taux d'analphabétisme dans le pays (estimé à 9%). En moyenne, 60% des participants au cours initial d'alphabétisation poursuivent leur scolarité dans les écoles publiques du pays, en particulier les plus jeunes. Afin de garantir la continuité des actions à long terme, le projet a aidé le gouvernement santoméen à créer un organe spécifique au sein du ministère de l'éducation: la direction de l'enseignement technique et professionnel et de l'éducation des jeunes et des adultes.
Outre São Tomé et Príncipe, le projet Solidarity Literacy a déjà été reproduit dans d'autres pays de langue portugaise (Cap Vert, Mozambique et Timor-Leste), ainsi que dans un pays hispanophone (Guatemala).
Soutenu par: Agence de coopération brésilienne (ABC)
Agence de mise en œuvre: AlfaSol
Contact:
Maristela Miranda Barbara,
Directeur, AlfaSol
Email: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Résumé
Alors que la Sierra Leone a fait des progrès considérables dans la consolidation de la paix, la démocratie et son développement socio-économique, le secteur des médias du pays reste confronté à un faible niveau de professionnalisme et à des difficultés pour fournir un contenu indépendant. Pour intensifier sa réforme des médias en cours, les plus importants acteurs des médias en Sierra Leone ont établi une coopération avec le Ghana en tant que pionnier de la liberté des médias sur le continent africain. La collaboration a permis d’élaborer un programme national d’études sur les médias et le journalisme à la principale université de Sierra Leone et de mettre en place un réseau de journalistes de la CEDEAO.
Défi
La Sierra Leone a réalisé des progrès considérables depuis la fin de la guerre civile en 2002, consolidant la paix et la démocratie et améliorant les indicateurs de développement dans un contexte de croissance croissante de la croissance économique. Son secteur des médias comprend un large éventail d’entités publiques et privées et est considéré comme relativement indépendant. Néanmoins, classés au classement 85 (sur 180) du World Press Freedom Index 2017, les journalistes sont confrontés à des défis importants en raison d'un marché hautement concurrentiel, où le financement dépend de la fidélité des intérêts politiques et économiques. De nombreux journalistes n'ont qu'une formation limitée et ne peuvent pas garantir un niveau adéquat d'éthique et de professionnalisme. Durant la récente crise du virus Ebola, les journalistes ont été de plus en plus confrontés à des accusations de diffamation.
Solution
Le groupe de coordination pour la réforme des médias en Sierra Leone (MCRG), qui réunit des représentants de haut niveau des principaux acteurs des médias dans le pays, a été créé en 2014 et est chargé de faciliter la réforme du paysage médiatique afin de garantir une indépendance accrue, une éthique supérieure et un professionnalisme reposant sur le droit à la liberté d'expression. Soutenu par le PNUD et l'UNESCO, le MCRG supervise et met en œuvre un programme ambitieux visant à renforcer le journalisme responsable. Parmi de nombreux objectifs, cela inclut l'adoption d'un projet de loi sur les médias et la reconnaissance accrue de la liberté de la presse dans la Constitution nationale. Il met également en œuvre une stratégie nationale de développement des médias, offre des formations aux journalistes, améliore les systèmes de médias alternatifs, tels que les réseaux de radio communautaires, et travaille à la création d'un centre d'excellence au sein du département de communication de masse de la Sierra Leone.
université ("Fourah Bay College"). Ceci est conforme à la stratégie de développement des médias du pays qui a été élaborée et lancée le 3 mai 2014 (Journée mondiale de la liberté de la presse). Pour intensifier cette réforme, les représentants ont établi une coopération avec le Ghana, classé n ° 26 au classement mondial de la liberté de la presse. 2017 (avant des pays comme la France et les États-Unis). Le Ghana dispose d'un cadre juridique stable pour garantir l'exercice indépendant et libre du journalisme. Son journalisme est caractérisé par un haut degré de professionnalisme et fonctionne sans restrictions significatives. L’évolution du paysage médiatique est le résultat de l’élargissement du paysage démocratique du Ghana depuis 1993. Les médias ont bénéficié des mouvements puissants de la société civile et des organisations qui ont profité de l’espace démocratique pour défendre l’appel à la libéralisation des ondes hertziennes. a conduit au pluralisme des médias. Là encore, les médias ont collaboré efficacement avec des acteurs étatiques et non étatiques pour s'acquitter de son rôle de quatrième pouvoir du royaume. Par exemple, lors des élections générales de 2016, la Commission nationale des médias, l'agence de réglementation des médias au Ghana, s'est associée au Conseil national pour la paix afin de sensibiliser le public à la nécessité d'élections pacifiques. De même, certains médias travaillent avec des agences anti-corruption pour lutter contre la menace de la corruption et contre l’exploitation minière illégale à petite échelle connue au Ghana sous le nom de «Galamsey». En mai 2014, une délégation de la presse sierra-léonaise s'est rendue au Ghana et a eu des entretiens avec les principales agences de presse telles que la Ghana Broadcasting Corporation, l'Institut ghanéen de journalisme, le Collège universitaire africain de la communication, l'UNESCO, le Réseau ghanéen de réseaux de radio communautaires et West Africa Media. Les échanges ont porté sur l'expérience du Ghana en matière de création d'un secteur des médias libre et de grande qualité et sur la manière dont ce secteur contribue au dialogue démocratique, à la responsabilisation, à la paix et au développement grâce à ses normes élevées en matière d'éthique professionnelle. Les délégués ont convenu de mettre en place des activités / projets communs et de renforcer la collaboration entre le département de communication de masse du Fourah Bay College et l'Université du Ghana, en particulier pour assurer la transformation en un centre d'excellence à part entière. Par conséquent, le programme de communication de masse du Fourah Bay College a été examiné et le développement de plus de 100 cours de premier cycle en journalisme et médias, dont trois masters
programmes, et un programme de doctorat en communication de masse (sous la direction d’un professeur résident) a été lancé. Des projets de recherche doctoraux sont menés dans les domaines suivants: gestion stratégique des médias, médias et genre, gouvernance des médias et démocratie, médias sociaux, systèmes de communication africains. En outre, une association d'éducateurs en communication, en journalisme et en médias (ACJEM SL) a été créée pour soutenir le déploiement du programme révisé en tant que programme national d'études sur les médias et le journalisme en Sierra Leone. L’échange a également abouti à la signature d’un mémorandum d’accord entre le Groupe de coordination pour la réforme des médias en Sierra Leone et la Fondation pour les médias en Afrique de l’Ouest (MFWA), basée à Accra, au Ghana. Entre-temps, les deux partenaires ont mené une enquête sur la couverture médiatique et les reportages sur la CEDEAO en Sierra Leone. À la suite de la formation d’un groupe représentatif de journalistes en Sierra Leone, le réseau de journalistes de la CEDEAO en Sierra Leone a été créé.
Soutenu par: PNUD
Mis en œuvre par: Groupe de coordination de la réforme des médias (MRCG
Résumé
L’économie éthiopienne subit une transformation importante avec des taux de croissance globaux positifs au cours de la dernière décennie (entre 8% et 13%), mais se heurte à des difficultés pour accroître sa productivité et son industrialisation. Le gouvernement met un accent particulier sur les industries à vocation exportatrice et le secteur industriel afin de permettre une croissance généralisée attirant les investissements étrangers directs et s'attaquant au problème de chômage massif des pays. Pour développer les capacités nationales de développement d'entreprises dans le secteur industriel, améliorer la planification industrielle et assurer la mise en place de cadres politiques incitant à l'exportation, le savoir-faire du secteur industriel en croissance rapide des pays asiatiques revêt une importance majeure.
Défi
L'économie éthiopienne connaît actuellement une transformation importante avec des taux de croissance globaux positifs au cours de la dernière décennie (entre 8 et 13%). Le pays accorde une importance particulière à la promotion de son industrialisation axée sur l'agriculture et les exportations. devrait représenter 18% du PIB d’ici 2025. Comme prévu dans le Plan de croissance et de transformation II, le développement du secteur industriel devrait permettre une croissance à base élargie attirant les investissements étrangers directs et devenant un levier pour l’élimination de la pauvreté le problème de chômage massif des pays, générant des revenus et une épargne adéquate. Le potentiel de déchaîner une industrialisation axée sur les exportations de la
textile et du cuir, est prometteur, mais nécessite une transformation stratégique et une systématisation des incitations. Actuellement, les exportations de l'Éthiopie sont largement dominées par les produits de base (environ 90% de toutes les exportations de marchandises; CNUCED PMA 2016). La part du secteur industriel dans le PIB a oscillé autour de 12% entre 2006 et 2016 et devra être intensifiée à grande échelle si l'on veut atteindre l'objectif visé. Actuellement, le secteur se caractérise par de faibles capacités techniques et technologiques et par un manque de compétitivité dans la qualité et les normes de ses produits. Le soutien institutionnel sera essentiel pour développer la recherche et le développement de produits, ainsi que les compétences en matière de productivité et de gestion du secteur.
Solution
Pour renforcer les capacités nationales de développement d'entreprises dans le secteur industriel conformément au plan de croissance et de transformation des pays, le ministère de l'Industrie, appuyé par le PNUD, a mis en place un programme pluriannuel de renforcement des capacités axé sur i) l'examen des politiques et des réglementations. capacités de développement industriel, ii) amélioration de la compétitivité des industries manufacturières et des services éthiopiens par le biais d’une productivité accrue, d’une analyse de la chaîne de valeur et du développement de grappes, et iii) amélioration des compétences, des connaissances et des capacités techniques des institutions du secteur privé fournissant des aides et des petites et moyennes entreprises . L’examen de la politique des ministères s’inspire des exemples réussis d’autres régions. En tant que tel, une étude réalisée en 2015 sur les résultats des exportations de produits manufacturés fournit un résumé des incitations à l'exportation existantes, en mettant un accent particulier sur les cadres politiques des pays asiatiques à vocation industrielle et sur les enseignements spécifiques partagés par le gouvernement indien. Il expose les programmes de promotion des exportations et les enseignements tirés d'interventions susceptibles de stimuler les exportations des investisseurs étrangers et nationaux. Sur la base de cet examen, l’Éthiopie a pu mettre au point un système standard simple de coefficients d’entrée-sortie (SIOC) facilement accessible et utilisable pour les produits d’exportation éthiopiens pour les bénéficiaires des programmes de promotion de l’exportation et des organisations d’exécution, à la place des systèmes existants. coefficient d’entrée-sortie auto-déclaré, ce qui est fastidieux et prend beaucoup de temps. Le système a permis à l'exportateur d'obtenir les matières premières / intrants ou composants nécessaires à la fabrication de produits exportables au prix international et exonère les biens d'équipement nécessaires à l'investissement des droits et taxes. Le développement du système a supprimé les informations auto-déclarées précédemment soumises par l'exportateur, qui étaient exposées à une mauvaise utilisation des matériaux et causaient une perte de revenus pour le gouvernement et une concurrence déloyale entre les citoyens. Le système est développé pour six catégories de produits d'exportation: le cuir et les articles en cuir, le textile et le vêtement, l'horticulture, l'agroalimentaire et l'agroalimentaire, les produits chimiques pharmaceutiques et les plastiques et les produits métalliques et d'ingénierie. Les connaissances acquises ont été appliquées pour pré-lancer une phase d'essai du système d'information éthiopien dans les secteurs du cuir et du textile.
Avec le soutien de: PNUD, représentation du gouvernement indien en Éthiopie (Ambassade de l'Inde)
Mis en œuvre par: Ministère de l'industrie
Coordonnées de contact: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Résumé
Le système fédéral éthiopien en est encore à ses balbutiements. Les systèmes et les institutions sont fragiles. L’un des principaux problèmes est l’absence ou la faiblesse de mécanismes et de systèmes formels de relations intergouvernementales (RIG), c’est-à-dire les relations horizontales et verticales entre les différents niveaux de gouvernement. En conséquence, il y a eu un déséquilibre entre le centre et les États. Pour consolider davantage le système fédéral, la Chambre de la fédération et le ministère des Affaires du développement fédéral et pastoral ont lancé le processus de renforcement des systèmes et des mécanismes d'un système formel de RIG. Dans le cadre de cette initiative, des experts de haut niveau et des décideurs d’institutions fédérales et régionales ont participé à une visite d’échange de données d’expérience de 10 jours en Inde, qui a permis de saisir les expériences et les enseignements tirés du processus d’élaboration des politiques en matière de relations intergouvernementales.
Défi
L’Éthiopie (République fédérale démocratique d’Éthiopie - FDRE), pays riche d’une histoire riche en sociétés et cultures diverses, a mis en place un gouvernement fédéral en 1994, après des décennies de guerre prolongée et de traditions gouvernementales fortement centristes. Le système fédéral a pour objectif de répondre à la quête d'autonomie des nations, nationalités et peuples du pays et de parvenir à une paix et à un développement durables. Neuf États régionaux et deux administrations municipales constituent les unités fédérales. La Constitution attribue des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire aux deux niveaux [art. 50 (2)]. Les pouvoirs sont répartis entre le gouvernement fédéral, d'une part, et neuf États régionaux et deux administrations municipales à charte. Ces arrangements gouvernementaux interdépendants, la répartition des pouvoirs et les caractéristiques uniques de la fédération sont essentiels pour harmoniser les politiques de développement, favoriser la bonne gouvernance et les relations fraternelles entre les diverses communautés. Bien que des progrès significatifs aient été accomplis au fil des ans, le système fédéral éthiopien est confronté à de multiples défis, notamment en raison de la faiblesse des relations intergouvernementales (RIG), qui est peut-être la dimension la moins développée et la moins comprise (ou la plus mal comprise) du fédéralisme en Éthiopie. Les principales questions relatives aux RIG en Éthiopie, essentielles à l'évolution du fédéralisme dans un avenir proche, sont les suivantes: * Le système de RIG en Éthiopie est peu développé et principalement géré par le biais de relations informelles incluant les canaux du parti au pouvoir. Sauf dans le but de résoudre les litiges liés aux changements de frontières entre les États régionaux et à l'exercice de pouvoirs fiscaux simultanés par les deux niveaux, ni la constitution ni un cadre politique ne fournissent la vision globale, les objectifs, les principes directeurs, les cadres et les procédures d'IGR. * Depuis 2005, le ministère des Affaires fédérales est chargé de servir de centre de bonnes relations entre le gouvernement fédéral et les États (Proclamation n ° 471/2005), mais il se limite à la gestion des branches exécutives du gouvernement fédéral. Le ministère n’est pas pleinement habilité à faciliter et à gérer les relations globales (qu’il s’agisse de relations verticales ou horizontales entre les structures gouvernementales) qui résultent des vastes domaines d’interdépendance. La réorganisation des organes exécutifs et la création d'une institution officielle chargée de superviser l'ensemble du système restent difficiles. Il est nécessaire de mieux comprendre les avantages, la structure et le mandat d'un système de RIG. * La Chambre de la fédération, également chargée de créer de bonnes relations et des relations fiscales verticales entre le gouvernement fédéral et les États, n'a pas encore mis au point de mécanismes et systèmes efficaces de RIG. . * Le besoin d'institutionnalisation des RIG est de plus en plus grand et est actuellement résolu par la mise en place de forums sectoriels qui ont été formés par la pratique entre hauts fonctionnaires et bureaucrates. Ces forums ne font pas partie d'un cadre politique harmonisé, travaillent souvent en silo et codifient leur propre protocole d'accord. Les états régionaux ne disposent pas de structures exclusivement consacrées aux relations intergouvernementales.
Solution
Bien que dans la plupart des systèmes fédéraux, l'exigence de coopération intergouvernementale soit plutôt implicite qu'explicite, les expressions de politique générale du mécanisme et des systèmes de relations intergouvernementales se sont toujours révélées utiles. Inspirés par le besoin croissant d'institutionnaliser et de renforcer les RIG formels, la Chambre de la fédération et le ministère du Développement fédéral et de la pastorale de la FDRE, avec l'appui financier et technique du PNUD, ont lancé le processus de développement d'un RIG formel qui aider à consolider davantage le système fédéral. Les efforts actuels impliquent des délibérations avec les parties prenantes sur les questions conceptuelles et pratiques liées au fédéralisme et aux RIG, dans le but de documenter les leçons et de formuler des cadres politiques et institutionnels pour l’Éthiopie. Cela comprend l'apprentissage des expériences d'autres fédérations sur la théorie de la pratique du fédéralisme et des relations intergouvernementales. En conséquence, le gouvernement éthiopien a organisé une mission de partage d'expérience en Inde en décembre 2016. Cette mission visait à obtenir des informations pertinentes et à apprendre de l'Inde sur la politique et les pratiques en matière de fédéralisme et de gestion des relations intergouvernementales en vue de les au contexte éthiopien. Le système fédéral éthiopien partage de nombreuses similitudes avec celui de l'Inde. Ce sont deux fédérations multiculturelles qui présentent d’énormes différences culturelles et linguistiques. L’Inde étant une fédération établie, il était particulièrement intéressant pour l’Éthiopie d’apprendre comment l’Inde gérait la diversité et les interactions entre le centre et les États.
Soutenu par: PNUD
Mis en œuvre par: House of Federation (Ethiopie)
Personne de contact: Dassa Bulcha; Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Résumé
La corruption et le favoritisme ont été les principaux obstacles au développement humain et économique en Gambie. Profitant des enseignements tirés du Rwanda, qui avait commencé il y a moins de 15 ans avec des niveaux de corruption aussi endémiques, le Gouvernement gambien intensifie ses mesures pour améliorer la prestation de services, lutter efficacement contre les problèmes de corruption et mener à bien les réformes institutionnelles nécessaires. accroître la responsabilité, l'accès à l'information et la primauté du droit.
Défi
La corruption et le favoritisme ont été les principaux obstacles au développement humain et économique en Gambie. Le pays est classé 45 sur 176 pays dans l'indice de perception de la corruption de Transparency International, avec une baisse globale de 34 points à 26 entre 2012 et 2016. S'agissant de l'indice Mo Ibrahim sur la gouvernance en Afrique, le pays a également affiché une détérioration de l'ensemble domaines, notamment en termes de sécurité et d’état de droit (33 pays africains sur 54 en 2015), où le déclin important était dû en particulier à la détérioration des mécanismes de responsabilisation. Une loi anti-corruption prévoyant la création d'une commission permanente anti-corruption a été mise en place en 2012, mais n'a pas été en mesure de renverser cette tendance négative. Cela est conforme à la Convention de l'UA sur la prévention et la lutte contre la corruption visant à lutter contre la corruption dans les secteurs public et privé, qui a été signée par la Gambie et 36 autres pays africains.
Solution
Pour profiter de l'expérience d'un pionnier africain dans la lutte contre la corruption, une délégation gambienne conduite par le ministre de la Justice a effectué un voyage d'étude au Rwanda en octobre 2015. Le Rwanda a adopté une politique de tolérance zéro en matière de corruption. des réformes institutionnelles depuis 2004, notamment la création d'un bureau national du médiateur, qui place le pays au 50ème rang de l'indice de corruption de Transparency International en 2016 (contre 102 au rang de 2008). Le bureau du médiateur relève du président de la République et dispose de pouvoirs étendus pour enquêter, poursuivre, suspendre temporairement les personnes soupçonnées de corruption, recouvrer des avoirs, demander tout document, témoignage, etc., ainsi que l'exécution d'un jugement (huissier). La délégation gambienne a rencontré des institutions du secteur de la justice, en particulier le ministère de la Justice, le
Ministère public, la police nationale du Rwanda, la commission de l'unité et de la réconciliation nationales et le bureau du médiateur. Les responsables rwandais ont partagé leur expérience des cadres juridiques et politiques en matière de lutte contre la corruption et de la manière dont ils sont mis en œuvre par les différentes institutions (police, système judiciaire, audits publics des dépenses de l'État, etc.) et de l'institutionnalisation des mesures anticorruption dans chaque secteur gouvernemental. Les mesures anti-corruption du Rwanda couvrent tous les aspects de la fonction publique et n'ont pas de frontières. Alors que les rapports d'audit annuels tiennent le gouvernement pour responsable de ses dépenses, la Commission nationale des droits de l'homme, dotée du pouvoir de police judiciaire, joue un rôle important dans la lutte contre la corruption par l'éducation et la sensibilisation. Les échanges ont porté sur un large éventail de questions allant des enseignements tirés de la mise en place d'une commission anticorruption dans les deux pays à d'autres réformes institutionnelles menées au Rwanda. La délégation gambienne a manifesté un vif intérêt pour les cadres institutionnels et juridiques mis en place par le Rwanda pour améliorer ses possibilités juridiques d'encourager les citoyens à signaler et à poursuivre immédiatement les cas de corruption. Suite à la transition démocratique de la Gambie en décembre 2016, le ministère de la Justice et l'UNODC ont organisé un atelier pour les parties prenantes en août 2017, qui a formulé des recommandations visant à garantir que le cadre juridique de la Gambie en matière de lutte contre la corruption soit conforme aux normes internationales. Un projet de loi révisé et renforcé est en cours de finalisation par le Ministère de la justice. Le nouveau gouvernement intensifie ses mesures pour améliorer la prestation de services, résoudre efficacement les problèmes de corruption et mener à bien les réformes institutionnelles nécessaires dans les domaines de la responsabilité, de l'accès à l'information et de l'état de droit.
Soutenu par: PNUD
Mis en œuvre par: Ministère de la justice
Personne de contact: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.